PRÉSENTATION
OBJET ET MÉTHODES
À la lecture du titre de notre travail, on peut se demander comment un mot, un seul mot, a pu devenir l’objet d’une si longue recherche. Et on peut aussi, dans un second temps, s’interroger sur l’identité du mot concerné... Je voudrais montrer, dans cette introduction, qu’un mot peut en cacher un autre, et comment j’ai été amenée, à partir d’un choix apparemment simple, à donner à l’étude du mot air une extension à la fois sémantique et temporelle, qui permet de poser le problème d’un double traitement, polysémique ou homonymique, de cette forme, à deux époques sensiblement éloignées l’une de l’autre.
Mais commençons par le commencement. C’est le mot air signifiant « manière d’être » au XVIIe siècle qui a constitué le point de départ de l’enquête. On sait que ce mot a connu un essor remarquable à cette époque, plus particulièrement dans la seconde moitié du siècle, où se sont développées, en relation avec le triomphe de la mondanité, les conceptions de l’honnête homme et les théories relatives au savoir-vivre et à la politesse. Ce mot, qu’on trouve à la fois dans les textes d’époque et dans ceux des commentateurs, apparaît comme aussi « incontournable » (si l’on peut oser ce terme fort peu classique, mais néanmoins reconnu) qu’indéfinissable, et donc tout à fait à même de susciter une légitime curiosité.
Mais quel est au juste ce mot qu’on se donne comme objet d’étude ? Nous allons voir qu’il n’est pas facile de répondre à cette question simple, comme le montre une première enquête lexicographique. Si son apparition, avec la signification « apparence extérieure », est généralement datée de la fin du XVIe siècle (1580), à partir d’attestations de Montaigne 1 , l’étymologie en est incertaine. Plusieurs hypothèses sont avancées. La plus fréquemment retenue est celle qui fait dériver air-manière d’être (ou apparence extérieure) d’air« atmosphère » (lui-même tiré du bas latin *area, métathèse de aera, acc. de aer 2 ). On trouve cette hypothèse dans les dictionnaires étymologiques de Bloch-Wartburg et de J. Picoche, dans le Dictionnaire historique de la langue française, et elle est reprise dans la plupart des dictionnaires de langue modernes, Le Nouveau Petit Robert (1993), Le Grand Robert (1985), le Grand Larousse de la langue française, le Trésor de la langue française. L’explication donnée par Bloch-Wartburg, et reprise par J. Picoche, est la suivante :
‘ air. Le sens « apparence extérieure » n’apparaît qu’au XVIe s. (Montaigne). — Il est né du sens premier à travers des étapes comme l’air d’une cour (où air est pris au sens de « atmosphère, ambiance ») [...] (Bloch-Wartburg)’L’influence de aire (du latin area« espace non construit », « aire à battre le grain », « aire d’oiseau » 3 ), au sens de « caractère », d’où est issu débonnaire (ancien français : de bonne aire« de bonne race ») et qui disparaît à cette époque, est parfois invoquée dans cette dérivation (Grand Larousse de la langue française) 4 . Elle est récusée par J. Picoche, qui considère que la signification de débonnaire, mot complètement mort au XVIIe siècle, n’a pu intervenir dans cette dérivation. Littré 5 , lui, est en désaccord avec la dérivation d’air« atmosphère » à air« manière d’être » :
‘Les dictionnaires confondent air, fluide gazeux, et air, manière, façon. Il est bien difficile de voir comment l’air atmosphérique aurait fini par signifier l’apparence, la manière. Diez 6 a senti la difficulté, et il tire air dans le second sens de l’allemand art, manière, façon. Mais on ne voit pas comment le t aurait disparu. Dans un travail subséquent, il est disposé à réunir air de l’atmosphère et air manière, par le sens de souffle, spiritus, qui, donnant esprit, conduirait à manière, caractère. ’Il pense que c’est le mot aire qui a glissé vers la signification « manière », puis que les deux mots air et aire se sont confondus 7 :
‘[...] aire existe, dans l’ancien français du moins, avec le sens de place et nid. Voici dès lors comment je conçois la filiation des sens : place et nid ; demeure, famille ; qualité, manière. Puis air et aire se seraient confondus dans les langues romanes. Air de vent et aire de vent est un exemple d’une confusion analogue. C’est, je crois, la fauconnerie qui, en signalant le faucon de bon aire, a permis le passage d’idée entre aire, nid, et extraction, famille, qualité. ’Les choses se compliquent encore quand on introduit le mot air-mélodie. L’apparition de cette signification est datée de 1578 par Le Nouveau Petit Robert et le Dictionnaire historique de la langue française, du milieu du XVIesiècle par Le Grand Robert (1985), de 1608 par le Grand Larousse de la langue française et le Trésor de la langue française, qui citent Régnier. Bloch-Wartburg et J. Picoche mentionnent le XVIIe siècle sans précision. Les dictionnaires s’accordent pour voir dans ce mot un emprunt à l’italien aria. Ce mot, de même origine qu’air-atmosphère, aurait développé le sens « mélodie » à partir du sens « manière ». C’est l’hypothèse de Bloch-Wartburg :
‘ air,« air chanté ». 1608. Empr. sémantique fait à l’it. aria, où le sens de « chant » est sorti de celui de « manière » par un développement comparable à celui de l’all. Weise« manière mélodie » [...]qui est reprise par Le Nouveau Petit Robert, Le Grand Robert (1985) 8 , le Dictionnaire historique de la langue française et par J. Picoche. Quant à Littré, il introduit, purement et simplement, la signification « mélodie » dans l’article air-manière d’être...’La filiation historique privilégiée nous conduirait donc à un étymon unique, area signifiant « atmosphère », sur lequel viendraient se greffer les significations « manière d’être » au XVIe siècle, puis, sous l’influence de l’italien, « mélodie », au XVIIe siècle – le mot aria ayant, semble-t-il, lui-même les trois significations, ainsi qu’il est dit dans le Dictionnaire général de la langue française de Hatzfeld et Darmesteter.
Si l’on se place maintenant au XVIIe siècle, dans une perspective synchronique, on retrouve certains aspects de la problématique précédente. En particulier, la filiation qui a été établie entre air« atmosphère » et air« manière d’être » trouve une illustration tout à fait éclairante dans l’ambiguïté d’emplois tels que :
‘L’air de cour est contagieux ; il se prend à Versailles, comme l’accent normand à Rouen ou à Falaise.La Bruyère, Les Caractères, « De la cour ».’ ‘L’air précieux n’a pas seulement infecté Paris, il s’est aussi répandu dans les provinces, et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part.
Molière, Les Précieuses ridicules.’
qui, selon les dictionnaires, passent d’un article à l’autre 9 . Dans Le Grand Robert 10 , ces deux citations, regroupées, figurent dans air-fluide gazeux, tandis que Littré place la citation de La Bruyère dans air-fluide gazeux, et celle de Molière dans air-manière d’être. Ajoutons que cette seconde citation est particulièrement tiraillée – rattachée à air-fluide gazeux par Hatzfeld et Darmesteter et Le Grand Robert, et à air-manière d’être par Littré et le Grand Larousse de la langue française. Ces occurrences, qui vont dans le sens de l’hypothèse avancée par Bloch-Wartburg au plan historique, pourraient ouvrir la voie à un traitement polysémique du mot air au XVIIe siècle, conjoignant les deux significations « élément » et « manière d’être ». On ne trouve pas, en revanche, dans les dictionnaires, d’exemples favorables au rapprochement d’air-manière d’être et d’air-mélodie. Et il n’est pas inintéressant de signaler que Furetière rattache explicitement la signification « mélodie », non à air-manière d’être, mais à air-élément :
‘ Air, se dit aussi en termes de musique, d’une conduite de la voix, ou des autres sons par de certains intervalles naturels ou artificiels qui frappent agréablement l’oreille, et qui témoignent de la joie, de la tristesse, ou de quelque autre passion. On les appelle ainsi, parce qu’ils proviennent des divers mouvements de l’air [...] Ce mot d’air vient du Grec ao, qui sign. je respire 11 .’La question se pose donc de savoir s’il est possible d’étudier le mot air-manière d’être au XVIIe siècle sans prendre en compte air-élément et air-mélodie.
Il convient aussi de s’interroger sur le type d’étude envisagée et sur le choix des méthodes appropriées. La consultation des dictionnaires susceptibles de nous instruire sur la (ou les) signification(s) du mot air-manière d’être au XVIIe siècle, qu’il s’agisse des dictionnaires d’époques (Furetière, Richelet, Dictionnaire de l’Académie) ou des dictionnaires ultérieurs (Dictionnaire de l’Académie et Dictionnaire de Trévoux pour le XVIIIe siècle, Bescherelle, Littré, Hatzfeld et Darmesteter pour le XIXe siècle), montre que ce mot est à la fois proche et distant de notre air moderne. Si l’on trouve des emplois qui nous paraissent familiers, comme ce choix de citations que j’extrais du début de l’article de Littré :
‘D’abord on ne l’avait point regardé, à cause de ses habits simples et négligés, de sa contenance modeste, de son silence presque continuel, de son air froid et réservé, Fénelon, Télémaque.’ ‘Ne vous y fiez pas, elle a, ma foi, les yeux fripons ; je lui trouve l’air bien coquet, Boileau, Héros de romans.’ ‘Mon Dieu ! qu’elle est jolie et qu’elle a l’air mignon ! Molière, l’Étourdi.’ ‘Votre père me regardait avec un air de compassion, Fénelon, Télémaque.’ ‘Protésilas reprenant son air sévère et hautain, Fénelon, Télémaque 12 . ’il semble bien que le mot air ait, au XVIIe siècle, une extension beaucoup plus grande que de nos jours, puisqu’il peut se dire aussi bien d’un comportement relativement abstrait que d’apparences plus physiques.
Citons Furetière :
‘ Air, signifie encore, manière d’agir, de parler, de vivre, soit en bonne, ou en mauvaise part. Il est des gens du bel air. il a l’air de pédant, de campagnard. il a bon air, bonne grâce à parler, à danser. il vit d’un air à se faire bien des amis, ou des ennemis. il a l’air bas, l’air dédaigneux, ce que vous me rapportez qu’il a dit, a bien de son air, de son style, il a bien l’air d’être du complot [...]Air, signifie aussi, la mine, les traits du visage. Ces deux personnes ont bien de l’air l’une de l’autre.’ ‘De plus, certains emplois nous sont vraiment étrangers, comme l’exemple ci-dessus de Furetière il vit d’un air à se faire bien des amis, ou des ennemis, auquel on peut ajouter les citations suivantes de Littré :’ ‘Parlez, Don Juan, et voyons de quel air vous saurez vous justifier, Molière, Fest. ’ ‘Et traitent du même air l’honnête homme et le fat, Molière, Mis.’ ‘Au contraire, j’agis d’un air tout différent, Molière, l’Étour.’
et quelques occurrences singulières de Mme de Sévigné, auxquelles Littré réserve des définitions spécifiques :
‘Accueil. « Elle nous fit un air honnête », Sévigné.’ ‘Sorte de manière affectée qui consiste à faire entendre ce qu’on ne témoigne pas. Faire une chose par air. « Tout cela était un air pour me faire savoir qu’elle a un équipage », Sévigné, « Quand je vous ai demandé si vous n’aviez point jeté mes lettres, c’était un air », id.’Or, si les dictionnaires font apparaître une polysémie relativement complexe de ce mot, ils n’en donnent pas véritablement la maîtrise à travers les définitions qu’ils proposent. On trouve des termes très généraux comme manière, façon, qui couvrent des exemples assez hétérogènes (comme dans Littré, à la sous-entrée 3). Et quand la manière est spécifiée, c’est à travers différents comportements dont l’assemblage produit un effet de disparate et de flou. Il en est ainsi dans Furetière :
‘ Air, signifie encore, manière d’agir, de parler, de vivre, soit en bonne, ou en mauvaise part.’et dans le Dictionnaire de l’Académie :
‘ Air, signifie aussi, Une certaine manière que l’on a dans les exercices du corps, dans la façon d’agir 13 . ’et, plus encore, dans Bescherelle 14 , qui entend ne rien laisser échapper des manières d’une personne :
‘Manière, façon d’agir, de parler, de marcher, de se tenir, de s’habiller, de se conduire dans le monde. Se dit, en général, de tout ce qui regarde le maintien, la tenue, la mine, la grâce, toutes les façons de faire, toutes les apparences.’Quand on se rapproche de l’apparence physique, on rencontre des synonymes tels que mine (Furetière, Richelet, Dictionnaire de l’Académie), physionomie (Richelet), contenance (Dictionnaire de l’Académie), qui sont pauvres en information, dans la mesure où ils demanderaient à être eux-mêmes définis. On notera que Bescherelle et Littré consacrent les dernières lignes de leur article à essayer de démêler les fils de ce micro-champ...
Cette approche lexicographique semble montrer que le mot air-manière d’être au XVIIe siècle présente une polysémie étendue, qui dépasse assez largement le cadre de notre compétence moderne et offre des contenus de signification aux contours mal définis. Mot vague s’il en est, comme le souligne F. Brunot, qui décline le paradigme air, bon air, bel air, air de la cour, en le faisant suivre de mots et expressions tels que mine et je ne scay quoy 15 ... La tâche à entreprendre est vaste et difficile. La signification de ce mot est en quelque sorte à construire, puisqu’on ne peut s’appuyer sur des acceptions plus ou moins établies. Et cette construction ne peut s’aider du sentiment linguistique, qui intervient naturellement dans les études portant sur le lexique contemporain. Certes, certains emplois nous semblent connus. Mais rien ne garantit, à trois siècles d’intervalle, que cette reconnaissance soit fiable, et que nous ne soyons pas en présence, au plan sémantique, de faux-amis. Ces affinités constituent même un obstacle, dans la mesure où la projection de structures lexicales modernes viendrait en quelque sorte brouiller la réception des occurrences et des contextes de l’époque. Le choix des méthodes doit donc tenir compte du double obstacle que présente un mot sémantiquement flou et éloigné dans le temps. D’abord, le recours à un corpus de textes s’impose, dans la mesure où les dictionnaires d’époque ne fournissent évidemment pas un matériau suffisamment élaboré. D’autre part, l’approche sémasiologique (étude des significations d’un mot donné) prend le pas sur l’approche onomasiologique (étude des champs lexicaux), puisqu’il s’agit de construire la polysémie d’un mot. Il serait en effet difficile d’introduire et d’étudier à l’intérieur d’un champ lexical un mot dont on méconnaîtrait la structuration sémantique interne. De plus, comme on l’a vu plus haut, la petite moisson de synonymes que rapporte l’enquête lexicographique ne fait que déplacer le problème sur des mots qui, même s’ils ont une moindre notoriété, présentent des résistances de même nature que le mot air 16 .
La délimitation du champ d’étude constitue la dernière préoccupation. Quels sont les auteurs susceptibles de répondre aux exigences à la fois quantitatives et qualitatives de constitution d’un corpus d’occurrences du mot air-manière d’être ? On peut penser que ce sont ceux qui ont à voir avec la vie sociale et mondaine, soit parce qu’ils font partie des gens du monde et qu’ils en possèdent le langage, soit parce qu’ils traitent des usages sociaux et mondains dans leurs écrits – ces deux aspects n’étant évidemment pas exclusifs l’un de l’autre. En tout bien tout honneur, on citera d’abord les grands auteurs. Parmi les gens du monde, on placera Mme de La Fayette et Mme de Sévigné, La Rochefoucauld et le cardinal de Retz, homme d’église et homme du monde en même temps. Ces auteurs furent d’ailleurs en relation pendant leur vie. De leur côté, les moralistes – aux côtés de La Rochefoucauld, La Fontaine et La Bruyère – s’intéressent aux mœurs de leurs contemporains, et des prédicateurs et écrivains religieux comme Bossuet et Fénelon n’y sont pas indifférents. Plus difficile à classer, en raison d’un génie aux multiples facettes, Pascal allie la qualité d’homme de science à celle d’auteur religieux, mais il eut aussi des fréquentations mondaines, et on peut dire de lui qu’il fut un observateur de divers milieux de son temps. Boileau, en tant qu’homme de lettres et arbitre du bon goût, prône le bon usage dans la manière de parler. Plus en retrait, on trouve des gens du monde qui représentent le libertinage mondain, le chevalier de Méré, théoricien de l’honnête homme, Bussy-Rabutin, en disgrâce mais gardant des relations avec les beaux esprits de son temps, et en particulier avec sa cousine Mme de Sévigné, Saint-Évremond, exilé à Londres où il fréquenta le salon d’Hortense Mancini, l’une des nièces de Mazarin, et développa, en particulier dans sa volumineuse correspondance, ses vues en matière d’art et de littérature. Avec le Père Bouhours, c’est un autre arbitre du bon goût, à la recherche de la définition des règles d’expression exacte, qui prend place aux côtés de Boileau dont il partageait les goûts esthétiques. Il faudrait enfin citer les auteurs, plus ou moins connus, qui ont produit des traités de savoir-vivre. Le rythme de parution de ce type d’ouvrages s’accélère sensiblement dans la seconde moitié du XVIIe siècle, comme le montre un recensement récent 17 , qui, pour l’époque qui nous intéresse, mentionne, aux côtés de Méré, Saint-Évremond, le Père Bouhours, et même La Bruyère, de très nombreux autres noms, parmi lesquels on peut retenir Guez de Balzac, Somaize, Sorel, Bary, Nicole, Lamy, Mlle de Scudéry, le Père Rapin, Cureau de La Chambre, Callières, Jean Pic, Ortigue de Vaumorière, Morvan de Bellegarde...
La problématique de notre recherche étant ainsi posée, au plan de l’objet, de la finalité et des moyens, il convient maintenant de présenter et de justifier les orientations que nous avons prises.
Nous ne nous attacherons pas à l’étymologie de ce mot, qui demanderait une longue remontée diachronique et des outils d’investigation spécifiques qui n’entrent (malheureusement) pas dans le cadre de nos compétences. De plus, ce travail constituerait en soi une partie importante de la recherche, réduisant d’autant le projet initial d’étude du mot air-manière d’être au XVIIe siècle. Ma perspective est donc résolument synchronique, mais elle ne peut pour autant ignorer le problème que pose, à cette époque, la relation d’air-manière d’être avec air-élément et, éventuellement, avec air-mélodie. Une approche succincte des textes ayant rapidement confirmé la présence, sinon massive, du moins significative, de métaphores d’air-élément dénotant la manière d’être d’un groupe dans la seconde moitié du XVIIe siècle, j’ai décidé d’explorer de manière approfondie cette piste de recherche, d’autant plus intéressante qu’elle n’a guère été exploitée à ce jour. Mais l’air qu’on respire au XVIIe siècle n’est pas le même que de nos jours. Nul n’ignore que l’air-élément, hérité de l’ancienne physique, a fait place à un corps composé, possédant des propriétés physiques et chimiques spécifiques. La signification d’air-élément au XVIIe siècle se présente donc, elle aussi, comme une signification à construire – le recours aux textes s’avérant d’autant plus nécessaire que les dictionnaires se font l’écho des changements dus aux découvertes scientifiques. Furetière mentionne déjà les expériences et les connaissances de son temps. Quant aux dictionnaires des XVIIIe et XIXe siècles, ils jettent les bases de notre définition moderne de l’air 18 . L’enquête textuelle ne fournit, en revanche, aucun indice intéressant en ce qui concerne air-mélodie, qui, à première vue, ne présente pas d’interférence sémantique avec air-manière d’être, non plus d’ailleurs qu’avec air-élément. Une recherche plus approfondie sur ce mot conduirait à le situer dans son contexte historique, et, donc, à s’intéresser au domaine musical au XVIIe siècle. On sait l’importance de la danse, des ballets, du rythme et de la mesure, à cette époque qui vit aussi la naissance de l’opéra. Dans ces conditions, il ne m’a pas paru raisonnable de m’engager dans deux voies, l’une conduisant à air-élément et l’autre à air-mélodie, aussi différentes qu’exigeantes dans leur domaine respectif – l’étude sémantique d’air-élément reposant, quant à elle, sur un arrière-plan de connaissances relatives à l’ancienne physique, et, comme on le verra, à la médecine. De ces deux voies, je n’ai donc retenu que la première, qui m’a paru impossible à contourner, et aussi, dans la mesure où les emplois métaphoriques d’air-élément impliquent la notion de groupe, plus immédiatement en rapport avec la composante sociale que véhicule le mot air-manière d’être.
Cette orientation a en grande partie conditionné le choix de notre corpus. Il fallait en effet trouver une double mine d’occurrences, relatives à air-manière d’être et à air-élément. Après divers sondages dans les textes de la seconde moitié du XVIIe siècle, il est apparu qu’un auteur et une œuvre répondaient parfaitement à nos besoins. Il s’agit des Lettres de Mme de Sévigné. Le mot air-manière d’être s’y trouve massivement représenté, avec plus de 200 occurrences, et l’on observe des emplois tels que ceux que nous avons précédemment cités, particulièrement éloignés des nôtres et dont la singularité n’a pas échappé à Littré. Mais surtout, le mot air-élément présente un nombre égal d’occurrences, ce qui est tout à fait remarquable 19 . On tient là un corpus imposant, homogène, et qui illustre à part égale les deux significations que nous souhaitons étudier et mettre en relation. Ce ne sont pas ses seules qualités. Mme de Sévigné, tout en restant en retrait de la vie de la cour, fait partie de ces gens du monde qui en possèdent les usages et le langage, ce qui laisse à penser qu’elle nous offre un échantillonnage représentatif des significations du mot air-manière d’être. Il y a plus. Ces lettres, qui, on le sait, n’ont pas été écrites en vue de la publication, relèvent, dans le fond et la forme, de la conversation, d’échanges familiers, et qui réitèrent, sans mesure, de maternelles préoccupations. Et c’est peut-être là la plus grande chance que nous ayons, car, au fil de la plume, en parlant d’un voyage, d’un séjour, du lieu où l’on se trouve, et de celui où (hélas) on ne se trouve pas, de santé et de maladies, Mme de Sévigné évoque naturellement l’air qu’on respire au XVIIe siècle... Ce sont des emplois courants de ce mot qu’on peut recueillir, et non des considérations savantes, comme on les trouverait dans certains écrits de Pascal, par exemple. Enfin, du point de vue chronologique, ces lettres, qui s’échelonnent de 1648 à 1696, couvrent l’intégralité de la seconde moitié du XVIIe siècle, qui constitue la période de temps privilégiée pour notre objet d’étude. Cette dimension temporelle a, de plus, l’avantage d’entrer dans les limites (inférieures) de ce que J. Rey-Debove appelle « une synchronie pratique liée aux relations de l’individu et de sa langue, dans le cours d’une vie humaine » (1971, p. 95). Nous avons choisi de travailler sur l’édition la plus complète de cette correspondance, établie par R. Duchêne dans la collection La Pléiade 20 , et qui rassemble, non seulement les lettres de Mme de Sévigné à sa fille, ainsi qu’à quelques autres destinataires, mais aussi la totalité des lettres conservées de ceux qui lui ont écrit 21 . C’est sur l’intégralité de cette correspondance que je travaillerai 22 .
Ce choix principal étant fait, comment mener à bien notre projet de recherche ? Devions-nous nous limiter à ce corpus, ou élargir notre champ d’investigation ? Quel type d’approche et quelles méthodes mettre en œuvre ? Certes, nous n’avions plus, comme autrefois, l’obstacle matériel du dépouillement, la base de données FRANTEXT mettant à notre disposition une masse considérable de documents. Il nous est toutefois rapidement apparu que la multiplication des occurrences n’en facilitait pas l’interprétation, et que, pour un mot aussi difficile à cerner que le mot air, l’exigence d’un travail en profondeur devait l’emporter sur l’éventualité d’un gain en extension. La correspondance de Mme de Sévigné offrait déjà, à elle seule, une quantité assez impressionnante d’occurrences de ce mot, auxquelles, rappelons-le, nous avions l’intention d’ajouter les occurrences d’air-élément. D’un autre côté, s’interdire toute incursion et toute recherche en dehors du corpus établi apparaissait comme une position quelque peu dogmatique et frustrante. Nous avons donc tenté de concilier deux types d’approches. On part de la correspondance de Mme de Sévigné, considérée, en raison des caractéristiques qui l’ont fait choisir, comme un corpus témoin, dont l’étude exhaustive et systématique doit permettre de construire la signification du mot air au XVIIe siècle. Le principe d’exhaustivité est là pour réduire la part de l’arbitraire au niveau de la sélection des exemples. Étudier toutes les occurrences de la correspondance de Mme de Sévigné, c’est prendre le corpus qu’on a et non se donner le corpus qu’on souhaite. C’est échapper ainsi aux stratégies, plus ou moins conscientes, de contournement ou d’évitement des emplois qui pourraient poser problème. Cette règle me semble particulièrement opportune quand on travaille sur un mot distant de trois siècles, à la fois connu et inconnu, et que les choix à faire risquent d’être soumis à l’influence de notre compétence actuelle. L’étude exhaustive et approfondie de la correspondance de Mme de Sévigné sera donc au centre de notre recherche sur le XVIIe siècle. Mais elle n’exclura pas, quoique secondairement, le recours à d’autres textes. Dans une perspective complémentaire, l’enquête sera menée cette fois selon le double principe de l’extension et de la sélection. Nos lectures personnelles et la base de données FRANTEXT fourniront une documentation importante. Sans souci d’exhaustivité ni d’approfondissement, on retiendra alors les occurrences qui présentent un intérêt par rapport à la structuration proposée, selon qu’elles confirment, précisent, éclairent ou enrichissent les significations proposées et le fonctionnement polysémique du mot air.
Mais notre approche ne se limitera pas au XVIIe siècle, et c’est cette extension quelque peu inattendue qu’il convient maintenant de justifier. En voici l’historique. La fréquentation assidue d’occurrences du XVIIe siècle s’est accompagnée, de façon non moins continue, d’un phénomène gênant. Nous avions trop souvent l’impression désagréable au cours de nos lectures – un peu comme quand on a une mouche devant l’œil – que le sens moderne du mot air venait en surimpression de la signification qui pouvait se dégager du contexte, et que nous ne parvenions pas à nous défaire de notre propre compétence lexicale. Cela montrait que l’air du XVIIe siècle était sémantiquement assez proche de notre air actuel pour que se produisent des interférences et que le second vienne en quelque sorte obstruer la réception du premier – ce phénomène étant assez fréquent pour qu’on le prenne au sérieux. Une seconde impression désagréable est alors venue s’ajouter à la première. C’est qu’au fond, nous n’avions pas non plus une représentation claire de la signification moderne du mot air. Et – ô ultime désagrément – les dictionnaires, consultés en renfort, furent, par leur embarras et leurs divergences, loin d’apporter les lumières attendues, au point qu’on pouvait se demander si la difficulté principale ne résidait pas dans l’élucidation du contenu de ce mot lui-même... J’ai donc décidé d’ouvrir un second chantier, qui aurait pour objet le mot air au XXe siècle. Dans les dictionnaires modernes, le mot air, pris dans le sens d’« apparence » est disjoint de ses deux homonymes air-fluide gazeux et air-mélodie, même s’il est fait mention des considérations étymologiques évoquées plus haut. Notre recherche a donc consisté à essayer de construire le signifié du mot air-apparence. Pour plusieurs raisons, ce matériau lexicographique fournissait un corpus acceptable. On peut dire d’abord, de façon générale, qu’en raison des avancées récentes de la discipline, de la mise en place des concepts et des méthodes de la lexicologie, dont la pratique lexicographique a su tirer parti, nos dictionnaires modernes offrent en principe des articles dont la présentation structurée et hiérarchisée n’a plus rien à voir avec celle des dictionnaires antérieurs, ceux du XVIIe siècle en particulier. Comme le montrent de nombreuses recherches, ils constituent une base de travail précieuse pour le lexicologue. De surcroît, quand il s’agit du lexique moderne et contemporain, le sentiment linguistique devient un allié, qui permet de mieux comprendre et maîtriser les données lexicographiques. D’autre part, dans la perspective qui était la nôtre, cette recherche était conçue comme une grille de lecture favorisant un meilleur accès au thème principal, le mot air au XVIIe siècle, ce qui incitait à prendre, en ce qui concerne le XXe siècle, des chemins de traverse déjà balisés. Certes, les dictionnaires apportaient sur le mot air-apparence, qu’il s’agisse de la structuration propre à chaque article ou de la mise en relation des articles entre eux, des témoignages perplexifiants. Mais d’une part, ils offraient un choix d’exemples permettant de couper court aux enquêtes de corpus et de contextes. Et d’autre part, on pouvait penser que cette confusion dans la présentation était à la mesure des difficultés que présentait la saisie sémantique de ce mot. Nous avons donc engagé ce travail de clarification à partir de la confrontation de quatre dictionnaires modernes, Le Nouveau Petit Robert, Le Grand Robert (1985), le Grand Larousse de la Langue Française, et le Trésor de la langue française 23 – ce qui nous donnait un champ d’exploration largement ouvert. Ce travail a été long, dans la mesure où seule une étude approfondie pouvait permettre de démêler les fils ténus de cette polysémie, et de dégager, à travers un matériau lexicographique à première vue hétérogène, une structuration sémantique (à peu près) cohérente. Et les résultats ont pris une telle ampleur que cette étude, outrepassant les limites et le but qui lui étaient assignés, est devenue un second thème de recherche, à part entière, qui nous a conduite à établir une comparaison fructueuse entre les airs des deux époques. Mais ce n’est pas tout. S’il y avait comparaison, elle devait être équilibrée. Dans la mesure où l’étude du mot air au XVIIe siècle associait air-manière d’être et air-élément, il était nécessaire de prendre en compte les deux mots air-apparence et air-fluide gazeux au XXe siècle, afin de statuer sur le bien-fondé de la disjonction homonymique proposée par les dictionnaires, et de situer, dans cette éventualité, le point de rupture entre les deux significations. C’est naturellement après avoir compris le principe de la dérivation sémantique d’air-élément à air-manière d’être au XVIIe siècle qu’il a été possible de poser correctement la problématique d’air-fluide gazeux et air-apparence au XXe siècle.
Dernier point, et non des moindres. Il fallait choisir nos outils et nos méthodes de travail. La polysémie est au centre de nombreux débats théoriques qu’on ne peut ignorer mais dans lesquels je n’entrerai pas ici 24 , ayant à effectuer un travail de terrain de grande ampleur à partir de mots dont la signification est à construire, qu’il s’agisse d’air-manière d’être au XVIIe, et même d’air-apparence au XXe siècle. Je me contenterai donc de dégager très succinctement les grandes lignes de la problématique de la polysémie, afin de préciser ma modeste position.
On sait que deux grandes tendances ont orienté la réflexion dans ce domaine, dont l’opposition tient à la nature même de l’objet de recherche. La polysémie pose en effet le problème de l’un et du multiple dans l’étude du sens lexical. Dire qu’un mot est polysémique, c’est lui reconnaître à la fois une pluralité de significations et une unité de fonctionnement (c’est-à-dire une possibilité de relier entre elles ces significations). Une telle problématique suscite deux orientations opposées : d’un côté, il y a ceux qui tendent à disjoindre les significations jusqu’à l’éclatement homonymique, de l’autre, ceux qui cherchent à les conjoindre dans une visée unique. On sait que la linguistique structurale a favorisé, dans un premier temps, la première option, à partir de l’approche distributionnelle – le Dictionnaire du français contemporain, 1967, étant l’« ouvrage pionnier en ce domaine » (A. Lehmann, F. Martin-Berthet, 1998, p. 69), suivi en 1979par le Lexis – tandis que J. Picoche a résolument défendu, à travers une application originale du concept guillaumien de signifié de puissance, le principe du traitement unitaire des polysèmes (on peut considérer son ouvrage de 1986, Structures sémantiques du lexique français, comme le « manifeste » de cette théorie). C’est cette seconde voie que je suivrai dans la présente recherche.
Il semble toutefois qu’il y ait actuellement quelque ringardise à poser le problème en termes d’homonymie / polysémie, et que les choses aient pris plus de hauteur. Je cite G. Kleiber, 1999a, p. 55 (note 8) :
Vieux débat que celui de la distinction homonymie / polysémie, qui a fait les délices technico-rhétoriques des lexicographes et lexicologues, mais qui, avec le changement d’orientation des analyses polysémiques actuelles, a perdu une grande partie de son acuité.
Je dirai donc un mot de ces nouvelles orientations, en m’appuyant sur l’ouvrage de G. Kleiber, 1999a 25 , ainsi que sur le numéro 113 de Langue française, 1997, consacré à la polysémie nominale. On prendra d’abord acte du fait que la polysémie est reconnue comme un phénomène à la fois régulier et incontournable. Ce qui est apparemment plus nouveau, ce sont les partis pris théoriques et les modes de traitement de la polysémie qui en découlent. Pour le dire de manière très simplifiée, la tendance actuelle est de récuser l’existence en langue de significations dénotatives qui s’attacheraient à un lexème donné – le contexte n’ayant pour rôle que de sélectionner la signification appropriée. À cette conception référentielle et conventionnelle du sens s’opposent les courants constructivistes qui considèrent que les significations dénotatives n’ont pas d’existence a priori, mais qu’elles résultent de l’interaction du mot et du contexte. Le problème est alors de savoir ce qu’il y a au plan de la langue. Si la position est radicale, il n’y a... rien. Sinon, on postule et on cherche à atteindre, par des voies différentes, qu’il s’agisse de traits subjectifs, de traits adescriptifs, ou de schèmes sémantiques abstraits, un sens fondamentalement aréférentiel, qui constitue la matrice commune des divers effets de sens en discours. Je prendrai un des exemples donnés par G. Kleiber, celui du mot boîte, décrit par P. Cadiot :
Le mot boîte ne sera pas décrit chez P. Cadiot (1994) en termes directement choséistes comme “ récipient de matière rigide (carton, bois, métal, plastique) facilement transportable, généralement muni d’un couvercle ” et n’aura donc pas comme sens premier celui de renvoyer à une catégorie d’un certain type d’objets matériels. Il se trouve défini par « un modèle mental flexible » (P. Cadiot, 1994) qui lui assigne la définition fonctionnelle de X contenir Y pour produire / fournir Z, où X marque la place de boîte. Une telle saisie intensionnelle a pour but de rendre compte des différentes « boîtes » possibles : boîte (entreprise, lycée, etc), boîte de vitesse, boîte de nuit, boîte à lettres, etc. (G. Kleiber, 1999a, p. 42).
Certaines modélisations sont plus sophistiquées. Celle de B. Victorri 26 , assez longuement commentée par G. Kleiber, dégage, entre la forme schématique abstraite, éminemment instable et déformable, et les effets de sens, un niveau intermédiaire où commenceraient à s’effectuer les premières opérations de stabilisation du sens. On pourrait alors récupérer à ce niveau la notion même de polysémie, mise à mal dans les autres modèles.
Si je traverse à grandes enjambées toutes ces constructions savantes et les débats auxquels elles donnent lieu, c’est que je ne peux en tirer de réel bénéfice en raison de la nature même de mon objet de recherche. Pour plusieurs raisons, ce sont les significations référentielles des mots qui m’intéressent. D’abord, parce que je travaille sur des mots du XVIIe siècledont les significations ne sont pas (air-manière d’être) ou sont insuffisamment (air-élément) établies. On a vu que le mot air-apparence, quoique relevant de notre compétence moderne, était à peine mieux loti. D’autre part, il est évident que si j’engage une comparaison entre le XVIIe et le XXe siècle, ce ne peut être que sur la base de ces significations, et plus largement encore comme nous le verrons, des représentations qu’elles véhiculent. Je ne me sens guère de vocation à confectionner et à transporter d’une époque à l’autre des « chapeaux abstractifs », pour reprendre le terme de G. Kleiber 27 ... Il est également dans la nature de ce projet de comparer des significations représentatives de leur époque, et donc de postuler que ces significations référentielles ont un statut plus ou moins stable en langue. Ce postulat n’est pas scandaleux, si l’on admet qu’on va des discours à la langue, et que les mots s’inscrivent dans la conscience collective comme des « discours miniaturisés », en quelque sorte, avec leurs virtualités combinatoires 28 . De ce point de vue, il me semble que le statut du contexte demanderait à être nuancé. Loin de s’opposer à la langue, je crois que, d’une certaine manière, il la constitue, si l’on considère que celle-ci résulte de l’accumulation et de la sédimentation des régularités contextuelles 29 . Enfin, il faut reconnaître que les conceptions plus traditionnelles du sens (dites maintenant « fixistes » 30 ) offrent, au plan méthodologique, un outillage structuré et structurant, qui a largement fait ses preuves 31 . En revanche, les théories actuelles, si elles rivalisent d’invention pour atteindre les sommets de l’abstraction, ne facilitent pas la « descente interprétative » (G. Kleiber, 1999a, p. 47) qui conduit aux significations référentielles. Or, paradoxalement, puisqu’il est question de l’air dans tous ses états, c’est précisément ce retour... sur terre qui m’intéresse. Le recours aux études de cas n’est pas d’un grand secours. Elles portent sur des mots du lexique moderne (souvent des noms concrets), dont les significations de départ sont parfaitement établies, et qui, d’autre part, excluent toute tentation de traitement homonymique. Certaines d’entre elles s’intéressent même à des différences de sens si ténues qu’elles mènent à la frontière de la polysémie et de la variation de sens, qu’on parle de livre ou de roman, de veau ou de lapin, de bronzage ou de maquillage, de commencer à lire un livre ou de commencer un livre, c’est-à-dire qu’on convoque ou qu’on révoque, en termes d’experts, les facettes, la métonymie intégrée, les zones actives, ou la coercition de type 32 ... La question qui se pose n’est plus alors « Y a-t-il polysémie ou homonymie ? », mais plutôt « Y a-t-il ou non polysémie ? ». Or le problème crucial que j’aurai à aborder sera précisément celui de la disjonction homonymique du / des mot(s) air d’une époque à l’autre.
C’est dire que je ne m’attarderai pas davantage sur les savantissimes considérations que je viens d’esquisser, pour revenir sur le terrain de la stricte méthodologie, en proposant une réflexion sur les moyens que je compte mettre en œuvre 33 .
La structuration de la polysémie d’un mot peut donner lieu à une double approche – que j’appellerai approche externe et approche interne – permettant de différencier les significations. L’approche externe prend en compte la combinatoire du mot et s’inscrit dans le cadre de l’analyse distributionnelle. L’approche interne, elle, s’attache aux variations de sens qu’on observe à l’intérieur du mot 34 . Voyons les choses de plus près, à partir de quelques exemples simples.
L’approche externe peut se faire à deux niveaux. Au niveau syntaxique, la fonction et la nature des constituants (ou l’absence même de constituants) peuvent être prises en compte, comme dans les exemples suivants :
‘passer (sans complément) / passer quelque chose (COD)’ ‘regarder quelque chose (COD) / regarder à quelque chose (COI)’ ‘manquer quelque chose (COD) / manquer de quelque chose (COI)’ ‘toucher quelque chose (COD) / toucher à quelque chose (COI)’ ‘tenir quelqu’un, quelque chose (COD) / tenir à quelqu’un, à quelque chose (COI)’ ‘considérer quelque chose (SN / pronom) / considérer que (proposition subordonnée)’Au niveau sémantique, plusieurs facteurs interviennent. D’abord, la combinatoire syntaxique peut faire l’objet d’une interprétation actancielle (en termes d’agent, siège, patient, lieu, temps, etc.). Ainsi, dans l’énoncé :
‘Cette personne séduit tout le monde. ’la personne peut être agentive (elle cherche à séduire), comme elle peut être seulement le siège d’un processus (elle attire, elle est séduisante) 35 . Ensuite, les constituants peuvent être considérés en eux-mêmes, dans leur signification propre, à travers des traits très généraux, tels que « animé » / « non animé », « humain » / « non humain », « concret » / « abstrait », etc. :
‘confondre quelqu’un / confondre quelque chose’ ‘exécuter quelqu’un / exécuter quelque chose’ ‘desservir quelqu’un / desservir quelque chose’ou à travers des traits plus spécifiques les rattachant à un paradigme lexical (« objet mobile », etc.).
Ainsi le verbe marcher peut se dire, avec des significations différentes, soit de moyens de transport, soit d’appareils :
‘Train qui marche à 250 km à l’heure (PR).’ ‘Appareil qui marche automatiquement, à l’électricité. Faire marcher une machine, une radio. Montre, pendule qui marche mal (PR).’De même le verbe connaître varie selon que le complément d’objet direct renvoie à un objet intellectuel (langue) ou à une expérience (physique ou morale) :
‘Connaître l’allemand (PR) / Connaître la faim, l’humiliation (PR).’et le verbe toucher prend une signification particulière quand son complément d’objet direct représente une somme d’argent :
‘Toucher un traitement, des mensualités (PR) 36 . ’Voyons maintenant l’approche interne. Les variations de sens qu’on observe à l’intérieur d’un mot sont de deux sortes, selon qu’elles reposent ou non sur des figures. Dans le premier cas, le passage d’une signification à l’autre peut s’effectuer par métaphore, métonymie ou synecdoque. Dans le second cas, il peut y avoir suppression, addition ou substitution d’un trait de sens. C’est la suppression et l’addition qu’illustrent respectivement les relations bien connues d’extension et de restriction. On trouve, dans les manuels ou les travaux de sémantique lexicale, assez d’exemples illustrant ce double processus de dérivation sémantique, pour qu’il ne soit pas nécessaire que j’en donne ici un échantillonnage. Il est intéressant toutefois de remarquer que, selon les auteurs, l’une ou l’autre voie peut se trouver privilégiée. Ainsi, pour R. Martin, 1992, p. 75 et suiv., la procédure d’addition et / ou de soustraction des sèmes joue un rôle dominant dans la structuration de la polysémie au point de couvrir et d’expliquer le mécanisme des figures elles-mêmes 37 . Pour J. Picoche, ce sont les deux figures, métaphore et métonymie, qui sont au premier plan (voir, en particulier, J. Picoche, 1993, p. 103 et suiv., J. Picoche, M.-L. Honeste, 1994 / 1995a 38 ), et conditionnent deux grands types de polysémie. Avec la métaphore, on a à faire à un type de polysémie dynamique, dans laquelle un mouvement de pensée va d’une acception plus riche (plénière) à une acception plus pauvre (subduite), le long d’un cinétisme qui peut comporter des saisies intermédiaires. La métaphore s’inscrit alors dans le phénomène plus général de la subduction, conçue comme un processus d’abstraction et d’appauvrissement du sens (sur ce concept guillaumien de subduction interne ou ésotérique, on se reportera à G. Moignet, 1981). La métonymie détermine, elle, un type de polysémie statique, dans laquelle tout ou partie d’une signification se transporte (d’où le terme de transduction qui est proposé) dans une autre signification, aussi – sinon plus – riche que la première, cette opération pouvant se reproduire en chaîne, et conduire éventuellement à la disjonction homonymique.
Les deux approches, externe et interne, sont en principe complémentaires, si l’on admet que toute variation du signifié d’un mot s’accompagne, d’une manière ou d’une autre, d’un changement de combinatoire. Ainsi les métaphores verbales procèdent souvent d’une modification sémantique qui affecte le sujet ou l’objet.
Voici des exemples dans lesquels on passe d’un sujet humain à une chose :
‘Sa générosité ne connaît pas de bornes. La Bourse a connu plusieurs crises. (PR)’ ‘Cette position commande la plaine. (PR) Ce mécanisme commande l’ouverture des portes. (PR)’ ‘Ce reproche l’a touché. (PR) Sa mort nous a cruellement touchés. (PR)’et d’autres qui illustrent le passage d’un objet concret à un objet abstrait :
‘Voyons un peu cette affaire. (PR)’ ‘Regarder le péril en face (PR).’Si l’on parvient, au moyen de ces critères, externes et internes, à différencier les significations d’un mot, il faut ensuite les ordonner. Quand le mot est faiblement polysémique, on peut se contenter d’une succession raisonnée de significations, comme le fait le PR pour le mot récolte, par exemple :
- Action de recueillir (les produits de la terre).
- Les produits recueillis.
- fig. Ce qu’on recueille à la suite d’une quête, d’une recherche [...] Faire une ample récolte d’observations.
en faisant dériver du sens premier deux acceptions, l’une métonymique (il y a passage de l’action à son résultat en 2), et l’autre métaphorique (en 3). La signification métonymique, qui est en affinité référentielle avec la signification de base, a été placée avant la signification métaphorique, qui implique un changement de domaine d’expérience. Mais, le plus souvent, on adopte une présentation hiérarchisée (ou arborescente) 39 , comme l’illustre, toujours dans le PR, cet article du mot robe :
- Vêtement qui entoure le corps.
-
- Dans l’Antiquité, en Orient, vêtement d’homme d’un seul tenant descendant aux genoux ou aux pieds.
-
- Vêtement d’homme distinctif de certains états ou professions.
- Vêtement d’enfant en bas âge.
- robe de chambre : long vêtement d’intérieur, pour homme ou femme, à manches, non ajusté.
- Vêtement féminin de dessus, couvrant le buste et les jambes.
- par anal. 1. Enveloppe (de fruits ou légumes).
-
- Pelage (de certains animaux).
- Feuille de tabac qui constitue l’enveloppe extérieure du cigare.
- Couleur (du vin rouge).
Les significations sont réparties en sous-ensembles, selon les affinités qu’elles présentent. Ces sous-ensembles viennent se placer sous des nœuds qui représentent les significations plus générales qui les subsument, ou les traits sémantiques (ou syntaxiques) qu’elles ont en commun – ces nœuds n’étant d’ailleurs pas toujours explicites (IA). On notera que l’opération peut se répéter, produisant plusieurs niveaux de profondeur (comme en I, par exemple), et que certains sous-ensembles se réduisent à une seule signification (comme en IB). Ce type de présentation implique le choix de critères de structuration permettant de constituer et de hiérarchiser les sous-ensembles. Dans le cas présent, c’est la distinction entre les sens propres et les sens figurés qui commande le premier niveau de structuration (en I et II). En ce qui concerne les verbes, le PR tend à privilégier, à ce niveau, le critère syntaxique, selon le type de constructions verbales (intransitivité, transitivité directe ou indirecte) mises en jeu.
Cette problématique de la polysémie, telle que je viens de l’exposer très succinctement, appelle plusieurs remarques.
Sur l’approche externe, d’abord, qui, dans les faits, ne peut être appliquée de façon uniforme, sans que soient prises en compte les différences d’aptitude combinatoire des lexèmes. Si cette approche est particulièrement bien adaptée au verbe, riche en constructions syntaxiques et en structures actancielles, elle est plus limitée en ce qui concerne l’adjectif, et elle n’est guère utilisée pour le nom, qui n’a pas, en principe, la même vocation à régir des compléments 40 . Mais cette distinction elle-même doit être nuancée, en raison de la très grande hétérogénéité de la classe nominale. Si les noms concrets n’offrent que peu de prise à l’étude distributionnelle, on ne peut en dire autant des noms abstraits. C’est le cas, en particulier, des noms d’action et de qualité, qui peuvent transposer des constructions verbales ou adjectivales dans le cadre syntaxique qui leur est propre 41 . Plus savamment, on opposera les noms catégorématiques et les noms syncatégorématiques (G. Kleiber, 1981, p. 39 et suiv.), ou encore les noms arguments élémentaires (non susceptibles d’avoir eux-mêmes des arguments) aux noms arguments non élémentaires (voir, par exemple, J. Giry-Schneider, 1994). Il convient donc d’ajuster le point de vue à l’objet de recherche concerné.
D’autre part, si cette approche, qui s’inscrit dans le cadre particulièrement prisé du distributionnalisme, impressionne favorablement au premier abord, il convient aussi d’en voir les limites. Elle comporte, en effet, comme on l’a vu plus haut, plusieurs niveaux de description, qui ne présentent pas tous les mêmes garanties méthodologiques.
La combinatoire morphosyntaxique représente, lorsque le mot s’y prête, le niveau le mieux structuré et le plus sûr. La combinatoire verbale, en particulier, peut être décrite de façon systématique, à partir d’un nombre limité de fonctions et de constituants. Ainsi le PR utilise (indépendamment de la fonction sujet 42 ) la notion de transitivité, quand le verbe se construit avec un complément d’objet, direct ou indirect, et celle d’intransitivité, en l’absence de tout complément d’objet 43 . Il convient d’ajouter la construction attributive, et de préciser que le cumul de compléments est autorisé (complément d’objet direct et complément d’objet indirect, complément d’objet direct et attribut, par exemple). Mais cette grille ne permet pas toujours de rendre compte de la complexité des aptitudes combinatoires du verbe. Les notions de transitivité et d’intransitivité sont loin d’être transparentes. Que dire, par exemple, de ces emplois du verbe parler :
‘Parler français, italien, russe.’ ‘Parler affaires, politique, chiffons.’placés dans la rubrique V. tr. dir. par le PR ? Et comment peut-on avoir une idée claire de l’intransitivité, à partir d’une définition seulement négative, qui peutcouvrir aussi bien l’absence de complément d’objet que l’extrême diversité des constructions prépositionnelles ? Une mise au point récente de ces notions a été faite par J. Dubois, F. Dubois-Charlier (1997, p. 60) 44 . Selon ces auteurs, le type transitif indirect est défini par « l’emploi sans complément direct mais avec complément prépositionnel quelle que soit la préposition », les exemples donnés étant :
‘jouir de, nuire à, capituler devant, combattre contre, foncer sur, parler de’tandis que le type intransitif regroupe les emplois « sans complément ou avec un complément dit circonstant, quantitatif, locatif, temporel, causal, instrumental, manière », les exemples donnés étant :
‘éternuer, mourir, frémir de colère, durer longtemps, camper quelque part, peser lourd’On voit que la frontière entre les deux types suppose une identification claire de la notion de circonstant – ce qui est loin d’être acquis 45 !
Le niveau morphologique est apparemment plus rassurant. L’identification de la nature des constituants apparaît comme moins discutable que celle de leur fonction. Mais il n’a pas toujours de pertinence en lui-même, dans la mesure où les traits sémantiques tendent à transcender les oppositions formelles. Ainsi le trait « abstrait » peut couvrir indifféremment un syntagme nominal et une proposition subordonnée complétive. Quelle différence établir, par exemple, entre :
‘Dire son avis, son idée, sa pensée, son opinion (PR) / Pierre dit qu’il est d’accord avec ce projet.’ ‘Nous savions tous la venue de Pierre / Nous savions tous que Pierre devait venir.’Plus précisément, j’ai pu montrer (S. Rémi-Giraud, 1986) que la diversité des constituants qu’admet le verbe savoir, qu’il s’agisse de propositions subordonnées (complétive, interrogative indirecte, infinitive) ou de syntagmes nominaux 46 , se laisse ramener au seul trait sémantique spécifique « acte de discours » (symbolisé par P), et que c’est la modulation de ce trait qui est pertinente dans l’étude de la polysémie de ce verbe, et dans la comparaison qu’on peut établir avec le verbe connaître.
Si l’on passe maintenant au niveau sémantique proprement dit, on rencontre d’abord le petit groupe des traits généraux, qui s’organisent en oppositions binaires apparemment rassurantes. Mais si la liste de ces oppositions s’ouvre assez aisément, elle est difficile à fermer 47 , et, plus encore, à appliquer. On sait que la frontière entre le concret et l’abstrait est une des plus difficiles à tracer dans le lexique 48 . De plus, la légitimité de cette distinction fait l’objet d’avis contrastés. Reconnue par les uns (A. Balibar-Mrabti, 1997, p. 33), elle est relativisée par d’autres. Ainsi, pour G. Gross (1994, p. 16), un bruit ou un nuage est au moins autant un événement qu’une chose concrète. On remarquera également qu’une opposition du type « animé (humain) » / « non animé » perd de sa pertinence dans un contexte tel que Elle portait son enfant dans ses bras et une valise à la main, où c’est la personne physique qui est prise en compte. L’enfant et la valise sont alors considérés, indépendamment de cette opposition, comme des choses concrètes. Cet exemple a l’avantage d’attirer l’attention sur une autre difficulté, liée à l’existence dans le lexique de noms sémantiquement « composites », présentant des aspects ou des « facettes » différentes. Ce sont, en particulier, les noms de personne, les noms de pays ou encore les noms de choses représentant des objets intellectuels (livre, journal, etc.). Les linguistes de tout bord ont bien mis en évidence l’instabilité d’interprétation qui s’attache à ces lexèmes, selon qu’on prend en compte l’aspect physique ou psychologique de la personne, l’aspect géographique ou humain des noms de pays, ou encore l’aspect matériel ou intellectuel du livre et du journal 49 . Il est évident que, si l’on se place dans le cadre de cette problématique, le sémantisme des noms, qui dépend lui-même du contexte, n’a plus rien à apporter à l’approche distributionnelle...
Enfin, avec les traits plus spécifiques, on entre dans le domaine du non fini et de l’informel. Or la prise en compte de ces traits s’avère souvent indispensable dans la structuration de la polysémie d’un mot.
Je prendrai d’abord l’exemple simple du verbe courir, pris dans les deux emplois suivants :
‘Courir les honneurs.’ ‘Courir un danger.’qui font l’objet d’une même description distributionnelle :
‘Courir + COD / SN / abstrait.’alors qu’ils correspondent à deux significations différentes :
‘Rechercher avec ardeur, empressement (PR).’ ‘Aller au-devant de, s’exposer à (PR).’Si le trait « abstrait » du constituant nominal COD est à l’origine, dans les deux cas, d’une dérivation métaphorique du verbe, qui dénote un mouvement non physique vers quelque chose, il ne peut expliquer la différence qui existe entre ces deux significations. Pour cela, il faut tenir compte des traits « attractif » / « répulsif », qui opposent les deux noms honneurs et danger. Dans le premier cas, la personne tend activement (rechercher) vers l’objet qu’elle désire (avec ardeur, empressement), tandis que dans l’autre, elle s’approche involontairement d’un danger 50 . Le trait « rapidité » de la signification physique première de ce verbe sert à exprimer, dans ces acceptions métaphoriques, soit l’intensité du désir, soit l’imminence de l’événement.
Le verbe passer fournit une illustration plus développée de notre propos. Le critère syntaxique, qui oppose l’intransitivité à la transitivité directe, ne mène pas très loin dans l’affinement du sens, si l’on considère le nombre de significations que ces deux traits recouvrent respectivement. Quant à la transitivité directe, si on la prend telle quelle, elle mêle indifféremment des emplois de sens causatif ou non causatif, tels que :
‘Passer une rivière / Passer des marchandises en transit.’qu’il conviendrait de distinguer au plan actanciel. Dans un cas, la personne (exprimée dans le constituant sujet) effectue le mouvement, dans l’autre elle fait effectuer le mouvement par l’objet (exprimé par le constituant COD). De fait, le PR propose pour le trait « transitivité directe » deux sous-entrées (respectivement II et III), qui regroupent les exemples suivants 51 :
‘Passer une rivière, les mers.’ ‘Passer un examen.’ ‘Passer la soirée chez qqn.’ ‘Passer son envie. Passer sa colère sur qqn.’ ‘Passer un mot, une ligne en copiant un texte. ’ ‘Passer à qqn tous ses caprices. ’ ‘Quand vous aurez passé la gare...’ ‘Il a passé la limite d’âge pour ce concours. ’ ‘Passer des marchandises en transit, en contrebande.’ ‘Passer la main dans les cheveux.’ ‘Passer une couche de peinture sur une porte.’ ‘Passer qqn par les armes.’ ‘Passer un bouillon, une sauce. ’ ‘Je vais vous passer le film de nos vacances. ’ ‘Passer une robe de chambre à la hâte. ’ ‘Passer ses vitesses. ’ ‘Passer une chose à qqn. Passez-moi le sel. ’ ‘Passer une commande.’Les compléments d’objet direct du verbe passer sont tous des syntagmes nominaux. On ne peut donc compter ici ni sur la fonction ni sur la nature des constituants pour différencier les significations 52 . Et si l’on s’appuie sur les traits sémantiques généraux, on obtiendra des regroupements hétérogènes, sans grande pertinence sémantique.
Ainsi, avec la formule :
‘verbe + SN / abstrait’seraient sélectionnés les exemples suivants :
‘Passer un examen.’ ‘Passer la soirée chez qqn.’ ‘Passer son envie. Passer sa colère sur qqn.’ ‘Passer à qqn tous ses caprices. ’ ‘Il a passé la limite d’âge pour ce concours. ’ ‘Passer une commande.’Il faut donc en venir aux traits spécifiques des constituants nominaux pour comprendre les variations de sens qui affectent le verbe. Ceux-ci déterminent d’abord l’interprétation actancielle de la structure, selon que la personne (exprimée par le constituant sujet) met ou non en action l’objet (exprimé par le constituant COD). Sans entrer dans le détail de toutes les occurrences, je noterai que l’interprétation causative intervient quand l’objet remplit deux conditions. Il faut que l’entité qu’il représente, concrète ou abstraite, puisse être soumise au contrôle de la personne (ce qui exclut, par exemple, des réalités naturelles, comme la rivière, la mer, des unités temporelles comme une soirée), et, d’autre part, qu’elle puisse effectuer un mouvement, qu’il soit physique pour les choses concrètes (une gare en est incapable) ou figuré, pour les choses abstraites. À partir de là, ces entités peuvent être diverses, et chacune conditionne l’apparition d’une signification particulière du verbe passer. Ainsi, on peut trouver une partie du corps qu’on mobilise facilement (main), une chose qu’on transporte (marchandises) ou qu’on déplace pour la donner à quelqu’un (le sel), un vêtement qu’on met sur soi (robe de chambre), un film qu’on déroule dans un projecteur, un mécanisme qu’on enclenche (vitesses), un liquide qu’on fait couler à travers un filtre, un tamis (bouillon, sauce), ou un semi-liquide qu’on étend sur une surface (couche de peinture). Au plan abstrait, on peut passer une commande, c’est-à-dire faire qu’une demande d’achat soit transmise à un destinataire. Je mets à part l’action qu’on exerce sur un humain quand on le passe par les armes, et que, par un renversement de perspective, le malheureux traverse en quelque sorte les projectiles qui le tuent. Du côté de la lecture non causative, la diversité des constituants nominaux COD détermine également les variations de signification du verbe passer. Quand l’objet appartient au monde physique, ce verbe dénote un mouvement dans l’espace. Plus précisément, il signifie « franchir, traverser » (PR), si l’on est en présence de l’élément liquide (rivière, mers), et « dépasser [...], aller au-delà de » (PR), quand on a à faire à un bâtiment (gare). Avec passer un mot, une ligne en recopiant un texte, on est à la fois dans le concret et dans l’abstrait, puisqu’il s’agit du mouvement de l’esprit et de l’écriture, qui va au-delà du mot ou de la ligne concernée. Le verbe passer signifie alors « omettre, oublier, sauter » (PR). Venons-en aux choses abstraites. Si l’objet est une unité de temps ayant une durée (la soirée), passer dénote l’accomplissement, libre, d’une action ou d’un état de la personne dans cette durée, soit :
‘Employer (un temps), se trouver dans telle situation pendant (une durée) (PR).’S’il s’agit d’un acte d’évaluation (un examen), passer dénote l’accomplissement des épreuves relatives à cet acte, qui met d’une certaine façon la personne en position de sujétion. D’où la définition :
‘Passer un examen : [...] en subir les épreuves (bien ou mal). (PR)’Quand on passe une limite d’âge, on franchit un point dans le temps, considéré comme un repère, et le dépassement fait l’objet d’une évaluation négative. Enfin, les deux contextes suivants :
‘Passer son envie. Passer sa colère sur qqn.’ ‘Passer à qqn tous ses caprices.’me posent problème. Le PR les classe parmi les emplois non causatifs du verbe passer, alors que je les verrais très bien figurer parmi les emplois causatifs. Le verbe passer est suivi de constituants nominaux exprimant certains états psychologiques (envie, caprices, colère). Ces états évoquent un mouvement, un besoin d’expansion, qu’il s’agisse du désir ou de la colère, et la personne (exprimée par le sujet) en a le contrôle, soit parce qu’ils lui appartiennent et qu’elle fait en sorte de les exprimer (passer son envie, sa colère sur qqn), soit parce qu’elle en autorise l’expression chez une autre personne (passer à qqn tous ses caprices). Dans ce contexte psychologique, le verbe passer signifie, me semble-t-il, « faire, laisser s’exprimer un état (de soi-même ou d’un autre) ».
L’exemple des deux verbes courir et passer montre assez bien comment les significations de ces verbes sont conditionnées par les traits spécifiques des noms qui entrent en combinaison avec eux. Les vertus de l’approche distributionnelle doivent donc être nuancées selon le niveau de description qu’on adopte. Si le niveau morphosyntaxique présente le maximum de garanties formelles, malgré l’insuffisance de certains concepts, le niveau sémantique, plus ou moins structurable quand on en reste aux traits généraux, n’a plus rien de systématique si l’on doit en venir, comme c’est souvent le cas, aux traits spécifiques. L’intuition de sens reprend alors pleinement ses droits, et la prise en compte de la distribution du mot n’est guère plus « objective » que la saisie directe des significations de ce mot... Sans compter que le risque de circularité n’est pas loin. Ainsi, quand l’interprétation actancielle pose problème, comme dans les exemples qui viennent d’être examinés, on peut se demander si c’est vraiment le complément qui conduit à accorder une signification causative au verbe, ou si ce n’est pas plutôt à partir de la saisie plus ou moins intuitive de ce signifié verbal qu’on dégage dans le complément les traits sémantiques susceptibles de justifier ce signifié ! Et dans l’exemple que nous avions donné plus haut :
Cette personne séduit tout le monde.
il est évident qu’aucune variation distributionnelle n’est en cause, et que c’est de l’interprétation du verbe seul que dépend l’affectation de tel ou tel rôle à la personne exprimée par le sujet.
Dans ce relativisme ambiant, on ne peut toutefois passer sous silence les tentatives récentes de codage du sens des unités nominales, menées par G. Gross (1994) à des fins notamment de traduction automatique, et dont les résultats ne manquent pas d’impressionner, que ce soit au plan quantitatif ou qualitatif. À partir d’une liste de traits généraux (syntactico-sémantiques) qui comprend les unités suivantes :
‘humain, animal, végétal, inanimé concret, inanimé abstrait, locatif, temps, événement 53 ’on détermine des sous-ensembles appelés « classes d’objets », par recherche des traits spécifiques permettant d’affiner les séries lexicales. Il convient de préciser que ces traits spécifiques sont obtenus uniquement à partir de l’observation du comportement syntaxique des unités nominales (c’est-à-dire de leur mise en relation avec une ou plusieurs classes de verbes appelés opérateurs appropriés). Pour ce qui est des humains, par exemple, 54 classes d’objets ont pu être dégagées. Une étude des compléments nominaux du verbe lire, faite par D. Le Pesant, 1994, fait entrer dans un dédale de subdivisions sémantiques près de 1500 noms environ. Cette expérience appelle deux remarques. D’abord, elle met en évidence la circularité de la procédure distributionnelle, qui fait appel aux noms pour structurer les verbes, et aux verbes pour structurer les noms – même si ce ne sont pas les mêmes unités qui sont sollicitées dans l’une et l’autre procédure 54 . D’autre part, l’affinement des traits spécifiques peut atteindre un tel niveau de profondeur que la question se pose des limites qu’on doit assigner à ce type de structuration. Cela dit, la constitution de ces classes d’objets, en raison du caractère systématique et exhaustif de la procédure, pourrait bien représenter une avancée considérable pour la structuration du lexique, mais l’application qu’on pourrait en faire à l’échelle du mot isolé, en vue d’une étude polysémique, ne s’impose pas avec évidence.
J’en viens à une dernière réserve. C’est que l’approche distributionnelle ne peut faire l’objet d’une application systématique, à partir d’un modèle unique qui permettrait de structurer de façon homogène la polysémie des lexèmes.
On pourrait imaginer, dans le cas du verbe qui se prête le mieux à ce type d’approche, un protocole selon lequel la prise en compte des différents niveaux de description se ferait dans un ordre déterminé allant du formel au moins formel – fonction, nature, sens (rôle actanciel, traits généraux, traits spécifiques) des constituants –, et qui produirait une structuration hiérarchisée des significations. Ainsi le critère syntaxique, constituant le premier axe de structuration, donnerait une répartition d’ensemble des significations, que les autres critères, appliqués successivement, viendraient différencier et affiner, à l’intérieur des groupes ainsi formés. Cette perspective est illusoire, dans la mesure où le rôle que peuvent jouer les différents critères dans la structuration de la polysémie est imprévisible, et se négocie, pour ainsi dire, au cas par cas, selon le lexème auquel on a à faire.
Quelques exemples.
Le critère syntaxique, appliqué au verbe tenir, permet au PR de disjoindre trois grands groupes de significations 55 :
‘I.V. tr. [...] Avoir (un objet) avec soi en le serrant afin qu’il ne tombe pas, ne s’échappe pas.’ ‘II.V. intr. [...] Être attaché, fixé, se maintenir dans la même position.’ ‘III. V. tr. ind.[...] tenir à qqn, à qqch. , y être attaché par un sentiment durable.’On peut dire que cette tripartition est pertinente. Elle disjoint des groupes qui présentent entre eux un écart de sens tout à fait perceptible, et elle rassemble dans chacun des groupes des significations qui présentent une assez forte unité. Sans entrer dans le détail, je me contenterai de citer, pour chaque définition de l’article, un exemple représentatif :
- Tenir son chapeau à la main.
- « Les rouleaux des amarres qui le tenaient [le chalut] » (Maupassant)
- Il lui a tenu la tête sous l’eau.
- Nous tenons les voleurs.
- Un navire qui tient bien la mer.
- « À mon avis, vous tenez un filon » (Romains)
- « Tu tiens ces nouvelles de mon oncle » (Molière)
- « La fosse à fumier, qui tenait un tiers de la cour » (Zola)
- Conducteur qui tient sa droite.
- Tenir une charge, un emploi, un poste.
- Tenir un fait pour assuré, certain.
- Tenir [...] sa parole, ses engagements, ses promesses.
- « Des lunettes qui tiennent sur le bout des narines » (Balzac)
- Faites un double nœud, cela tiendra mieux.
- Tenir ferme contre l’ennemi.
- Tous mes livres tiennent dans cette armoire.
- « Il doit tenir à cette femme-là » (Balzac)
- « Cette médiocrité ne tenait pas au genre, elle tenait au talent insuffisant des auteurs » (Caillois)
- « Il tenait de sa mère et de sa grand-mère » (Ste-Beuve) 56 .
En revanche, les mêmes critères syntaxiques peuvent n’avoir qu’un faible rendement avec d’autres verbes. Je prendrai l’exemple de commander que le PR présente ainsi 57 :
‘I. V. tr. dir. [...] commander (qqn) : exercer son autorité sur (qqn) en lui dictant sa conduite [...] Il n’aime pas qu’on le commande.’ ‘II. V. tr. ind. commander À (qqn). [...] Avoir, exercer une autorité sur (qqn). Il leur commande durement.’ ‘III. V. intr. Exercer son autorité ; donner des ordres et les faire exécuter. Il ne sait pas commander.’Commander signifie de toute façon « exercer son autorité », et implique un schéma actanciel qui comporte un agent, un objet et un destinataire. Chaque construction module ce schéma à sa façon. Avec la première, l’agent exerce directement l’action sur le destinataire, qu’il mène, qu’il dirige avec autorité. Dans le second cas, le destinataire est visé à travers les ordres que donne l’agent (on peut aussi trouver une construction double du type commander qqch. à qqn). Enfin, avec la construction intransitive qui efface objet et destinataire, c’est l’attitude d’autorité de l’agent qui est considérée en elle-même. Deux options se présentent alors. Soit on se contente de parler de nuances d’emplois à l’intérieur d’une seule et même signification, soit on considère ces variantes comme des significations distinctes. Dans le second cas, le critère syntaxique est pertinent, mais, dans la mesure où les significations sont très proches les unes des autres, il ne me paraît pas judicieux d’en faire le premier axe de structuration. Tout au plus pourrait-on le faire intervenir pour différencier et affiner les significations faisant partie d’un groupe relatif à l’« exercice de l’autorité » 58 .
Cet exemple, relativement simple, me permet d’attirer l’attention sur la notion d’actant, reprise de L. Tesnière, et que J. Picoche a su introduire et exploiter en sémantique lexicale 59 . Comme on peut s’y attendre, les structures actancielles sont au centre de nombreuses études de polysèmes verbaux, dont elles éclairent le fonctionnement, et, éventuellement, la comparaison, quand il s’agit de verbes synonymes ou sémantiquement apparentés 60 . Mais il convient de souligner que cette notion fait merveille, également, dans la structuration des champs lexicaux. Appliqué à un certain niveau de profondeur 61 , un schéma actanciel donné permet, en effet, d’engendrer tout un champ générique (par exemple, le schéma « A est cause que B fait ce qu’il n’a pas naturellement tendance à faire » conduit aux verbes astreindre, contraindre, forcer, obliger), en même temps qu’il fait proliférer des paradigmes d’actants (par exemple, les dénominations de A, telles que chef, patron, maître, etc.), qui peuvent entrer dans de nouvelles structures (ainsi, on dira de A qu’il est autoritaire, fort, puissant, ou de B, qu’il est contraint et forcé, qu’il obéit ou se révolte, qu’il agit de force, obligatoirement, malgré lui, de mauvais gré). Et il suffit de nier le schéma actanciel de base pour que se développe le vaste champ de la « liberté » 62 . Ainsi, en gagnant de proche en proche, on peut grignoter des pans entiers du lexique, selon un processus dont la productivité est si riche qu’il devient plus problématique de l’arrêter que de le poursuivre 63 !
Mais revenons aux dimensions plus modestes de notre problématique, avec l’exemple, cette fois, de compter. L’article consacré à ce verbe présente les deux rubriques suivantes, correspondant respectivement à la construction transitive (I) et à la construction intransitive (II) 64 :
- Compter les spectateurs d’un théâtre, les habitants d’une ville.
- Compter l’argent que l’on dépense.
- Compter une somme à qqn.
- Compter les jours, les heures.
- Il compte déjà deux ans de règne, de service.
- Il faut compter deux jours de voyage.
- Ils étaient quatre, sans compter les enfants.
- Paris compte deux millions d’habitants.
- Il compte cela pour beaucoup.
- Il compte pouvoir partir demain.
- Sans compter que [...]
- Cet enfant sait lire, écrire et compter.
- Il a de l’influence et il faut compter avec lui.
- Comptez sur moi.
- Cela compte peu, ne compte pas.
- Une année qui compte double.
- Cet auteur compte parmi les plus grands.
- À compter de [...]
Il apparaît clairement que le critère syntaxique contrarie certaines affinités naturelles. Au plan sémantique, on peut en effet distinguer deux grands groupes de significations, celles qui, d’une manière ou d’une autre, impliquent une opération numérique et contiennent le trait « calcul », et celles qui dérivent vers les traits « importance, considération ». Les références seraient, pour le premier groupe :
- I – 1 à 8.
- II – 1 et 7.
et pour le second :
- I – 9 à 11.
- II – 2 à 6.
Au plan morphologique, les choses ne sont guère plus prévisibles. Souvent, comme on l’a vu plus haut, les oppositions formelles se trouvent couvertes par un trait sémantique qui les neutralise. Ainsi un verbe de sensation peut être suivi indifféremment d’un syntagme nominal ou d’une proposition infinitive qui expriment une réalité concrète ou physique :
‘« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue » (Racine) (PR) / « Il croyait voir quelqu’un venir à lui » (Hugo) (PR)’ ‘Regarder la pluie / Regarder la pluie tomber, tomber la pluie 65 (PR).’ ‘Entendre du bruit / J’ai entendu bouger. (PR)’ ‘Écouter la pluie / Il écoutait tomber la pluie. (PR)’alors que le verbe laisser est sensible à l’alternance formelle :
‘Laisser quelqu’un / Laisser les enfants crier.’et signifie, soit « se séparer de, abandonner » (PR), soit « ne pas empêcher de » (PR). La proposition subordonnée complétive peut donner lieu à des variations plus subtiles. Avec entendre, elle peut remplacer l’une des deux constructions précédentes sans que le sens du verbe en soit changé :
‘Entendre du bruit / Entendre quelqu’un faire du bruit / Entendre que quelqu’un fait du bruit.’Mais, avec voir, elle introduit, même quand elle renvoie à quelque chose de concret, le trait « activité mentale » dans la signification verbale. On comparera :
‘J’ai vu Pierre / J’ai vu Pierre tomber / J’ai vu que Pierre tombait. ’Dans la dernière phrase, la perception visuelle s’accompagne, me semble-t-il, d’une interprétation du fait, et le verbe voir tend à signifier aussi « saisir, comprendre ». Enfin, avec un verbe comme estimer, syntagme nominal (estimer quelque chose) et proposition subordonnée complétive (estimer que) produisent des effets de sens différents. Dans le premier cas, on détermine la valeur d’une chose, alors que dans le second on donne son avis, son opinion 66 .
La combinatoire sémantique n’offre pas non plus de véritable régularité. Certes, les oppositions de traits généraux déterminent souvent des variations de signification, qu’elles portent sur le constituant sujet ou le complément du verbe. L’opposition « concret ou physique » / « abstrait », dont je ne donne ici qu’un exemple type pour chaque fonction (sujet et COD) :
‘La Seine coule à Paris. (PR) / Le temps coule. (PR)’ ‘Trancher une corde (PR) / Trancher un différend (PR).’est particulièrement productive, dans la mesure où elle met en jeu deux sortes d’expérience du monde, en principe inconciliables. L’opposition « personne » / « chose » obtient aussi de bons résultats, en ce qui concerne le constituant sujet :
‘quelqu’un marche / quelque chose marche’ ‘quelqu’un comprend (un problème) / quelque chose comprend (quelque chose) (ex. : Le concours comprend trois épreuves) (PR))’ ‘quelqu’un travaille / quelque chose (le vin, la pâte) travaille’ ‘quelqu’un réfléchit / quelque chose réfléchit’et surtout quand elle porte sur le COD, comme le montre cette sélection rapide :
‘convertir quelqu’un / convertir quelque chose’ ‘croquer quelqu’un / croquer quelque chose’ ‘décider quelqu’un / décider quelque chose’ ‘dispenser quelqu’un / dispenser quelque chose’ ‘ébranler quelqu’un / ébranler quelque chose’ ‘embrasser quelqu’un / embrasser quelque chose ’ ‘éprouver quelqu’un / éprouver quelque chose’ ‘épuiser quelqu’un / épuiser quelque chose’ ‘instruire quelqu’un / instruire quelque chose’ ‘noter quelqu’un / noter quelque chose’ ‘pendre quelqu’un / pendre quelque chose’ ‘prévenir quelqu’un / prévenir quelque chose’Mais elle peut aussi rester inopérante, qu’il s’agisse, là encore, du sujet :
‘quelqu’un convient / quelque chose convient’ ‘quelqu’un m’exaspère / quelque chose m’exaspère’ ‘quelqu’un me fatigue / quelque chose me fatigue’ou du COD :
‘cogner quelqu’un / cogner quelque chose’ ‘dévaloriser quelqu’un / dévaloriser quelque chose’ ‘enfermer quelqu’un / enfermer quelque chose’ ‘éviter quelqu’un / éviter quelque chose’ ‘garder quelqu’un / garder quelque chose’ ‘louer quelqu’un / louer quelque chose’ ‘observer quelqu’un / observer quelque chose’ ‘préférer quelqu’un / préférer quelque chose’ ‘reconnaître quelqu’un / reconnaître quelque chose’ ‘remarquer quelqu’un / remarquer quelque chose’notamment avec les verbes de sensation, relatifs à la vue et à l’ouïe :
‘voir, regarder, discerner, apercevoir, entrevoir, entendre, écouter quelqu’un, quelque chose.’D’autre part, les variations de signification peuvent être plus ou moins perceptibles. Dans les exemples donnés ci-dessous :
‘aimer quelqu’un / aimer quelque chose’ ‘défendre quelqu’un / défendre quelque chose’ ‘démentir quelqu’un / démentir quelque chose’ ‘détester quelqu’un / détester quelque chose’ ‘embarquer quelqu’un / embarquer quelque chose’ ‘encourager quelqu’un / encourager quelque chose’ ‘interrompre quelqu’un / interrompre quelque chose’ ‘laver quelqu’un / laver quelque chose’ ‘négliger quelqu’un / négliger quelque chose’ ‘présenter quelqu’un / présenter quelque chose’ ‘préserver quelqu’un / préserver quelque chose’ ‘protéger quelqu’un / protéger quelque chose’ ‘recommander quelqu’un / recommander quelque chose’ ‘renverser quelqu’un / renverser quelque chose’ ‘sauver quelqu’un / sauver quelque chose’ ‘soigner quelqu’un / soigner quelque chose’ ‘soulager quelqu’un / soulager quelque chose’ ‘surveiller quelqu’un / surveiller quelque chose’les significations verbales ne sont que faiblement différenciées par l’alternance « personne » / « chose » que présente le COD.
Quant aux traits spécifiques, il est aussi difficile de s’en passer que de déterminer à l’avance leur rôle et leur place dans la structuration de la polysémie. Ainsi, le verbe toucher, pris dans une distribution du type :
‘quelqu’un touche quelqu’un / quelque chose (concret)’signifie :
‘Entrer en contact avec (qqn, qqch.) en éprouvant les sensations du toucher (PR).’Mais, dans le paradigme des choses concrètes, il convient de mettre à part les cartes à jouer et les instruments de musique :
‘Je n’ai jamais touché une carte. (PR)’ ‘Voilà des années que je n’ai pas touché un piano. (PR)’Ceux-ci déterminent l’apparition d’une autre signification, « jouer », qui donne lieu elle-même à deux applications différentes selon l’objet en question. Il est évident que les cartes et les instruments de musique laisseront dans l’indifférence un verbe comme déplacer, par exemple, même si l’effort déployé dans l’un et l’autre cas n’a rien de commun ! Par ailleurs, le mot carte conditionnera les variations sémantiques de verbes comme battre et couper, tandis que piano donnera à accorder une signification technique tout à fait à part dans la structuration polysémique de ce verbe – même si elle permet de renouer avec son sens premier. D’autre part, les traits spécifiques ont en principe vocation à nous faire entrer dans les combinatoires particulières, et à différencier plus finement les significations que les traits morphosyntaxiques et les traits sémantiques généraux. Mais ils peuvent parfois intervenir au plus haut niveau de la structuration, au détriment du trait syntaxique, comme on l’a vu avec le verbe commander. J’ai proposé ci-dessus de distinguer le groupe des significations relatives à l’« exercice de l’autorité » de la signification « demander à un fabricant, un fournisseur par une commande » (PR). Or cette dernière signification se dégage de contextes dans lesquels on peut dire que le COD exprime une « réalité monnayable (marchandise, service) ».
Une grille systématique d’approche de la polysémie, qui présenterait un ordre prédéfini des critères, apparaît donc comme improbable. C’est pourquoi on ne peut que tourner un regard envieux vers le protocole raffiné qui a été mis au point par J. Dubois et F. Dubois-Charlier (1997) pour la classification des verbes français.
Je résume les trois étapes fondamentales de la structuration. Dans un premier temps, les verbes sont répartis en classes génériques (assimilables, me semble-t-il, aux champs génériques), qui sont au nombre de 14. À l’intérieur de ces classes génériques, on établit des classes sémantico-syntaxiques, selon un double jeu d’oppositions : « être vivant / non animé » d’une part, « sens propre / sens figuré (métaphorique) », d’autre part. Ces classes sont au nombre de 54. Les classes sémantico-syntaxiques se subdivisent, à leur tour, en sous-classes syntaxiques (il y en a 248) en fonction de leur schème syntaxique et de leur paradigme lexical. Enfin, les sous-types syntaxiques représentent les diverses formes que peut prendre le schème syntaxique, et ils sont eux-mêmes susceptibles de variantes syntaxiques et lexicales.
Par exemple, on distinguera :
- la classe générique E, qui contient les verbes de « déplacement d’un lieu ou vers un lieu » ; elle comporte quatre classes sémantico-syntaxiques ;
- la classe sémantico-syntaxique E1, qui contient les verbes du type « sortir, faire sortir quelqu’un d’un lieu », « aller, faire aller quelqu’un quelque part », avec sujet / objet humain, au sens propre et figuré ; elle comporte sept sous-classes syntaxiques ;
- la sous-classe syntaxique E1a, qui contient les verbes du type « sortir d’un lieu » ; elle contient trois sous-types syntaxiques ;
- le sous-type intransitif, qui comporte trois variantes selon que le sujet est humain / animal / pluriel collectif.
Cette présentation sommaire ne rend pas compte de l’extrême affinement des paramètres mis en jeu (relations entre phrases, dérivations, types de compléments et de prépositions) – le tout donnant lieu à un codage minutieux qui permet des « tris croisés » extrêmement révélateurs (par exemple, on peut dégager les constructions dominantes d’un domaine comme la géologie). Ce que je retiendrai de cette expérience, là encore très impressionnante, c’est que les critères qui dominent la structuration sont des critères sémantiques, et non syntaxiques – à la différence des travaux de M. Gross, 1975, par exemple, qui avait construit ses tables « de manière purement syntaxique » (p. 218), obtenant tantôt des champs sémantiquement homogènes, tantôt d’autres qui l’étaient moins... C’est quand même le découpage en champs lexicaux qui ouvre la structuration (au niveau des classes génériques), tandis que prennent le relais (au niveau des classes sémantico-syntaxiques) des oppositions fondées sur les traits génériques et la distinction entre sens propre et sens figuré. Ceci n’enlève quasiment rien à l’objectivité (sinon au formalisme) de la procédure, dans la mesure où les critères sémantiques utilisés sont d’une telle généralité que, dans la pratique, ils ne peuvent guère prêter à discussion. Il n’empêche que la procédure montre que la syntaxe est d’autant plus rentable qu’on l’enferme dans un périmètre sémantique (même délimité à grands traits) – ce qui implique, malgré tout, une relative subordination de la forme au sens. Il convient d’ajouter que ce classement, s’il permet de dégager des degrés hiérarchiques de synonymie très convaincants, conduit naturellement à la disjonction des entrées d’un polysème. Le problème reste entier de savoir si une transposition de ce type de structuration à la polysémie est ou non possible. Par exemple, pourrait-on appliquer à tout polysème, de manière systématique, d’abord des critères sémantiques (tels que les traits génériques et la distinction sens propre / figuré), puis des critères syntaxiques ? Les quelques exemples donnés ci-dessus conduisent à en douter.
Tout ce qu’on peut dire, c’est que l’approche distributionnelle occupe une place de choix dans l’étude de la polysémie, mais qu’elle n’est pas pour autant une panacée, capable de résoudre tous les maux... Certes, il faut en user, mais sans la surestimer. Elle ne peut être systématique, et n’a qu’une objectivité limitée, les aspects les plus formels (ou les moins discutables) qu’elle présente n’étant pas toujours les plus rentables sémantiquement.
Deux autres critères peuvent être utilisés secondairement. On peut faire appel au champ morphosémantique du mot pour justifier certaines différences de signification 67 . Le verbe commander est exemplaire de cette démarche, dans la mesure où il produit deux dérivés nominaux, commandement et commande. Si ces noms ne sont pas d’un grand secours en ce qui concerne une structuration fine de la polysémie de commander, ils peuvent toutefois venir à l’appui de certains choix relatifs à la présentation de cette polysémie. En l’occurrence, ils pourraient légitimer le fait d’accorder la première place, comme nous l’avons proposé, à la disjonction entre les significations relatives à l’« exercice de l’autorité » et la signification « commerciale ». Le verbe fonder présente un cas similaire, avec ses deux dérivés fondation et fondement. Mais, là encore, on ne trouvera rien de systématique, et il faudra procéder au cas par cas. Ainsi les deux noms vue et vision, qui sont, dans certains emplois, synonymes, ne permettent pas d’opérer de tels dégroupements de sens. D’autre part, il n’y a évidemment (et heureusement) pas de correspondance systématique entre les significations du mot de base et de son dérivé. Le dérivé possède ses propres acceptions, par exemple pour le nom vue :
‘Le fait de considérer (un but, une fin) (PR).’qui n’ont pas (à première vue !) de corrélat dans le mot de base – sans parler de celles qui, dénotant autre chose qu’un processus :
‘Étendue de ce qu’on peut voir en un lieu (PR).’ ‘Ce qui représente (un lieu, une étendue de pays) (PR).’ ‘Ouverture (PR).’n’ont pas non plus de pertinence immédiate. Le mot de base a, lui aussi, ses aires de sens réservées. Ainsi, en ce qui concerne voir, la signification :
‘Être, se trouver en présence de (qqn) (PR).’ne se trouve pas transposée dans les dérivés nominaux. Mais surtout cette démarche est menacée de circularité. Les polysémies des dérivés peuvent être complexes, et elles demandent à être élucidées. Est-ce alors le dérivé qui doit servir à la structuration du mot de base, ou l’inverse ? Ou convient-il de faire une navette entre les deux ?
Le second critère consiste à rechercher les mots synonymes des significations qu’on dégage. On met en place une grille lexicale formée de plusieurs sous-ensembles (micro-champs), qui correspondent aux différentes significations du mot polysémique. Les dictionnaires utilisent souvent ce critère dans le cours des articles. Prenons comme illustration un exemple simple, l’adjectif aigu dans le PR 68 :
- Terminé en pointe ou en tranchant. =>acéré, coupant, pointu. Une flèche aiguë [...]
- D’une fréquence élevée, en haut de l’échelle des sons [...] « des voix aiguës ou graves » (Maupass.). => aigre, criard, perçant, strident [...]
- Intense et pénétrant (douleur). => vif, violent [...]
- fig.Particulièrement vif et pénétrant dans le domaine de l’esprit. => incisif, perçant, subtil ; acuité [...] L’intelligence parisienne « aiguë, [...] toujours en mouvement » (R. Rolland) [...]
Les synonymes sont donnés après les définitions ou les exemples 69 , et ils s’ajoutent parfois à ceux qui apparaissent dans les définitions elles-mêmes (intense et pénétrant, en 3, vif et pénétrant en 4). On obtient ainsi une sorte de ronde de synonymes pour chaque définition.
Cette procédure appelle plusieurs remarques. On note d’abord qu’elle vient cautionner la structuration polysémique plus qu’elle ne permet de la fonder. C’est en effet une fois que les significations du mot sont établies qu’on peut partir à la recherche de synonymes correspondant à chacune. Se pose ensuite le problème de la sélection des synonymes – ceux-ci ne s’imposant pas de façon aussi immédiate que la distribution d’un mot. C’est en principe par l’opération de substitution en contexte, implicitement présente dans les dictionnaires, que la synonymie peut être établie. Mais on s’engage là sur un terrain qui n’est pas toujours facile à délimiter. Si l’adjectif aigu, qui peut s’appliquer à un objet concret (1), à un son (2), à une sensation (la douleur, en 3), ou à une faculté intellectuelle (4), présente une combinatoire bien balisée par des changements de domaines, qui conduit à des séries synonymiques peu discutables, il n’en est pas de même d’un mot comme peur, pour lequel le PR distingue un sens fort et un sens faible, illustrés respectivement par les exemples suivants :
‘Être en proie à la peur [...] Inspirer de la peur à qqn. La peur s’empare de qqn, l’étreint. (PR)« Ils avaient une peur maladive de gêner leurs voisins » (R. Rolland) (PR).’
Dans le premier cas, les contextes sont très divers, la peur pouvant aller, dans certaines citations, jusqu’à son paroxysme :
‘« La peur [...] c’est quelque chose d’effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de l’âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d’angoisse » (Maupassant).’ce qui conduit le PR à faire suivre la définition d’une abondante série de synonymes :
‘affolement, alarme, alerte, angoisse, appréhension, crainte, effroi, épouvante, frayeur, inquiétude, panique, terreur 70 (PR).’On voit qu’il est difficile de constituer une telle liste. Doit-elle comporter un mot comme appréhension ? Pourquoi ne pas adjoindre horreur à épouvante et terreur, ou anxiété à angoisse ? Pour le sens faible, le PR ne propose pas de synonymes – sinon le mot appréhension, présent dans la définition même. On peut se demander pourquoi les mots crainte ou inquiétude n’auraient pas ici leur place. En fait, le critère synonymique nous renvoie l’image de la polysémie du mot. Quand celle-ci est clairement structurée, les séries synonymiques se mettent en place facilement. Quand elle est plus floue, l’incertitude gagne aussi les synonymes... Ce phénomène s’explique par le fait qu’on part du mot pour aller à ses équivalents de sens. Il n’empêche qu’il limite singulièrement la rentabilité de la procédure. Celle-ci ne peut, pour plusieurs raisons, être systématique. Il faudrait, pour cela, qu’on puisse établir des listes de synonymes fermées et distinctes, correspondant à chaque signification. On vient de voir que la première condition ne peut être remplie. La seconde ne l’est pas non plus, à plus d’un titre. D’abord rien ne dit qu’il existe des synonymes pour chaque signification d’un mot donné. Pour le mot dossier, par exemple, pris dans les deux sens suivants :
‘I. Partie d’un siège sur laquelle on appuie le dos (PR).II. [...] Ensemble de pièces relatives à une affaire et placées dans une chemise (PR).’
je n’ai trouvé de synonyme, ni à la suite de la définition, ni dans la définition elle-même. D’autre part, il n’y a pas toujours – loin s’en faut – d’équivalence stricte entre une signification et un synonyme. Le synonyme peut être trop étroit ou trop large, ou il est lui-même polysémique. Pour illustrer le premier cas, je reprendrai l’exemple de dossier. On trouve, dans le corps de l’article, les équivalences suivantes :
‘ Dossier d’un lit, la partie qui soutient le chevet. => tête (de lit) (PR).Dossier de presse. => press-book (PR).’
On voit qu’ici, les synonymes ne valent pas pour les significations concernées, mais uniquement pour un emploi particulier à l’intérieur de ces significations. À l’inverse, le synonyme est trop large quand il couvre plus d’une signification. Je prendrai l’exemple du verbe brailler, défini ainsi, en tant que mot monosémique, par le PR :
‘Crier fort, parler ou chanter de façon assourdissante. Il ne parle pas, il braille [...]’Ce mot figure, parmi d’autres, comme synonyme de crier, dont il couvre les deux significations suivantes :
‘Jeter un ou plusieurs cris [...] Crier de douleur [...]Parler fort, élever la voix au cours d’une conversation, d’une discussion [...] « On peut discuter sans hurler. D’ordinaire on ne crie que quand on a tort » (Gide).’
dans la mesure où il n’est pas sensible à l’opposition de traits « absence de la parole » / « présence de la parole ». Enfin – le cas est évidemment très fréquent – le synonyme est lui-même polysémique, et il se trouve légitimement convoqué à chaque fois qu’il peut correspondre à une signification. Ainsi l’adjectif lumineux vient s’associer aux deux significations suivantes de clair :
‘Qui a l’éclat du jour (PR).Aisé, facile à comprendre (PR).’
dans la mesure où il possède une différence de sens similaire. On voit poindre une nouvelle fois le risque de circularité, le synonyme devenant à son tour le polysème qu’on doit structurer au moyen de synonymes... dont fait éventuellement partie le mot donné au départ !
On ajoutera que la recherche des synonymes peut s’accompagner de celle des antonymes, qui pose des problèmes spécifiques en ce qui concerne la procédure de substitution (ainsi, les antonymes émoussé, grave, sourd de l’adjectif aigu accepteront la procédure, qui sera refusée par les antonymes audace, bravoure, courage, intrépidité, du mot peur) et qui rencontre en principe les mêmes limites que celles évoquées précédemment. Mais beaucoup moins nombreux, et regroupés discrètement en fin d’article dans les dictionnaires, ils ne font généralement pas l’objet d’une recherche aussi attentionnée que les synonymes 71 .
Enfin, on trouve parfois, à la suite des définitions ou des exemples, des mots associés. Ainsi, dans le cas du verbe marcher :
‘Avancer (en parlant des êtres animés) [...] – Animaux qui marchent sur les doigts (=> digitigrade), sur la plante des pieds (=> plantigrade) (PR).Aller à pied (=> pédestre, piéton) (PR).’
Ces mots contiennent des traits – « avancer » pour digitigrade, plantigrade, « aller à pied » pour piéton, pédestre – qui correspondent à telle ou telle signification du verbe marcher. Mais ils dénotent autre chose que l’action concernée. Les adjectifs digitigrade et plantigrade expriment la propriété des espèces qui avancent de telle ou telle manière (ou même dénotent ces espèces) et piéton dénomme le marcheur à pied. Ces mots se disent donc de l’agent qui fait l’action d’avancer ou d’aller à pied. Quant à l’adjectif pédestre, il exprime la propriété d’une action (randonnée) qu’on fait au moyen de la marche à pied. Ces rapprochements se font par recours à l’intuition, et ils posent des problèmes similaires à ceux que nous avons rencontrés. Ainsi, si l’on retrouve telle quelle la signification « aller à pied » dans pédestre et piéton, les adjectifs digitigrade et plantigrade restreignent par des traits spécifiques (« en appuyant sur les doigts », « sur la plante des pieds ») la signification « avancer ».
Venons-en maintenant à l’approche interne.
Celle-ci rencontre sur le terrain une telle diversité de variations sémantiques qu’on est contraint d’enrichir et d’affiner sans cesse le petit lot de règles simples posées au départ. On sait bien que, si l’on sort des exemples plus ou moins ad hoc destinés à illustrer et à promouvoir les constructions théoriques (et il faut bien en passer par là à un certain niveau de conceptualisation), et si l’on prend les mots comme ils viennent et comme ils sont, les traits sémantiques ne sont pas aussi stables et bien définis qu’on le voudrait, qu’ils ne se distinguent ni ne s’opposent de manière tranchée et définitive, et que les opérations et manipulations portant sur le sens ne peuvent avoir la rigueur de procédures mathématiques – l’approche structuraliste ne pouvant tenir la route sur de longues distances.
Je donnerai deux exemples simples. Le verbe marcher possède plusieurs significations en rapport avec cette forme de déplacement qui caractérise l’être humain. J’emprunte les définitions et quelques exemples du PR :
‘Se déplacer par mouvements et appuis successifs des jambes et des pieds sans quitter le sol [...] « Je ne puis méditer qu’en marchant » (Rouss.). Marcher à petits pas rapides [...] Marcher d’un pas ferme, lent, tranquille. Marcher bon train, vite [...] Marcher avec peine [...]Aller à pied [...] marcher sans but, à l’aventure [...] Enfant qui marche à côté de sa mère. Marcher devant, derrière qqn [...]
Mettre le pied (sur qqch.) tout en avançant. Défense de marcher sur les pelouses [...]
Poser le pied (sur qqch.), sans idée d’autre mouvement. Marcher dans une flaque d’eau [...] ’
Comment différencier ces significations ? Il n’est guère possible de procéder par addition ou retranchement de traits. L’action reste fondamentalement la même et l’on retrouve dans les quatre significations les deux traits « déplacement » et « modalité du déplacement (par appui des pieds) ». Mais de l’une à l’autre, la perception varie, mettant l’accent sur tel ou tel aspect de l’action, ce qui entraîne une pondération différente des deux traits. Dans la première signification, on peut dire que les deux traits s’équilibrent. La personne est vue à la fois dans un déplacement continu, et à travers la modalité du déplacement (mouvements et appuis successifs des jambes et des pieds sans quitter le sol). Les exemples tendent à souligner cette modalité, au moyen de caractérisations diverses. La seconde signification privilégie le déplacement, la modalité du déplacement étant présente sans être saillante. C’est ce que traduit la définition du PR, qui emploie le verbe aller, plus directionnel, et réduit l’expression de la modalité (à pied). À l’inverse, avec les deux significations suivantes, c’est la modalité qui l’emporte, tandis que le déplacement est mis au second plan. Les définitions donnent en premier le mouvement du pied (mettre le pied, poser le pied sur), la construction du verbe indiquant le point d’appui (sur qqch.), tandis que le déplacement est contenu dans un segment subordonné, qu’il s’agisse du gérondif tout en avançant, ou du commentaire métalinguistique sans idée d’autre mouvement. Mais, là encore, intervient une différence de saillance. Dans le premier cas, le mouvement du pied se répète, il est pris dans le cours de la marche, dans la continuité du déplacement, comme le montre le gérondif tout en avançant. Dans le second cas, le mouvement du pied est saisi dans l’instant même où il se pose – on a à faire à un mouvement-occurrence – ce qui suspend la perspective du déplacement. On voit donc que, plus le trait « modalité » prend du relief, avec cette sorte d’arrêt sur image que suggère la dernière définition, plus le trait « déplacement » s’affaiblit. Ce trait ne disparaît toutefois pas complètement, comme pourrait le faire croire le commentaire métalinguistique sans idée d’autre mouvement, car il va de soi que ce mouvement du pied s’effectue au cours d’un déplacement, et non de façon isolée (comme par exemple, dans Il pose le pied sur un tabouret) 72 , mais il n’est pas associé, comme précédemment, à la représentation de ce mouvement. On voit, par cet exemple, comment un schéma sémantique de base peut produire une pluralité de significations, par modulation des traits qui le composent. Les deux traits peuvent s’équilibrer, comme ils peuvent s’affirmer tour à tour, l’un devenant plus saillant que l’autre 73 .
Le verbe crier illustre un autre phénomène. Je partirai, cette fois, d’un choix d’exemples que propose le PR, que je réorganise à ma façon – les regroupements et les définitions de l’article ne reflétant pas assez fidèlement les variations de sens que je souhaite mettre en évidence :
- « Des camelots traversaient le carrefour en criant des éditions spéciales » (Mart. du G.).
- « Je l’ai vu courir comme un fou. Il a crié qu’il allait manquer son train » (Chardonne).
- « On peut discuter sans hurler. D’ordinaire on ne crie que quand on a tort » (Gide).
- Crier des injures à qqn. Crier un ordre. Il lui cria de se taire.
- Crier contre qqn, (pop.) après qqn. Tes parents vont crier.
Dans ce corpus, le verbe crier dénote une émission de parole marquée par une forte intensité de la voix. Une thèse récente 74 a montré que ce trait « intensité » traduit un écart par rapport à la norme vocale, qui se trouve souvent corrélé avec un écart par rapport à la norme émotionnelle. En d’autres termes, on crie, au lieu de parler, quand on éprouve un sentiment violent, et plus particulièrement de l’agressivité envers son destinataire. Ce n’est pas le cas en 1, où il s’agit, pour des marchands ambulants, de se faire entendre à distance, et où, seule, la situation est à l’origine de cette amplification sonore. La composante émotionnelle s’introduit, me semble-t-il, dès l’exemple 2. Certes, le personnage crie parce qu’il s’éloigne d’un destinataire dont il veut se faire entendre. Mais il est pris aussi dans une situation d’urgence (il allait manquer son train), qui l’oblige à réagir rapidement (courir) et provoque son affolement (comme un fou) 75 . On peut donc penser que l’intensité de la voix témoigne de l’état d’excitation où il se trouve. En 3, il est dit que celui qui élève la voix le fait parce qu’il est à court d’argument (quand on a tort). L’intensité vocale (qu’expriment les deux verbes crier et hurler) est alors une manière de rétablir la situation à son avantage, en prenant le dessus sur l’autre. Le verbe crier traduit l’autorité, voire l’agressivité du locuteur, même s’il ne les dirige pas explicitement contre le destinataire. On retrouve ces composantes en 4, dans des situations où l’objet de parole traduit un rapport de force (crier un ordre, Il lui cria de se taire) ou de violence (crier des injures à qqn), et où le destinataire est clairement visé. C’est en 5 que le ton monte le plus haut, le verbe crier dénotant un acte de parole ouvertement dirigé contre l’autre. On notera d’ailleurs, dans ces exemples, la présence de prépositions comme contre, après, qui traduisent, de façon quasi spatiale, la relation d’opposition à l’autre. On voit, à travers ce corpus, que les variations de signification dépendent de l’interprétation qu’on fait de la situation affective du sujet, corrélée à l’acte de parole : de l’absence à la présence de sentiment, on assiste à la montée progressive de l’affect 76 . Nous sommes là dans un domaine particulièrement flou, où les oppositions binaires ne sont guère pertinentes et où le principe de gradualité tend à s’imposer.
On voit, par l’exemple de ces deux verbes, que les termes de saillance et de gradualité (entre autres choses !) doivent s’ajouter à ceux d’addition et de suppression – l’approche structuraliste devant céder la place à des formes plus souples de modélisation, qui mettent en évidence la présence d’un véritable continuum dans la langue – ce principe valant au plan de la description générale des faits linguistiques. Cette notion est tout à fait centrale dans les approches constructivistes du sens que j’évoquais précédemment 77 . Elle n’est pas neuve pour autant. B. Pottier, pionner en matière de sémantique structurale, ne s’est pas fait faute d’affirmer parallèlement, de manière répétée et... continue, que « le discontinu est le résultat d’une opération sur le continu » 78 :
L’expression discontinue (discrète) de la langue recouvre une continuité d’intention sémantique. On fige ce qui est dynamique. D’où la nécessité d’abandonner une représentation logique binaire, exclusive, au profit d’une logique « floue », où tous les degrés sont envisageables [...] (B. Pottier, 1992b, p. 17) prônant l’application de ce principe en sémantique lexicale, que ce soit en synchronie ou en diachronie 79 . Nul doute que nous aurons l’occasion, dans notre travail de terrain, d’expérimenter ces voies multiples et moins balisées...
De ce rappel succinct de la problématique de la polysémie et de l’évaluation critique des outils méthodologiques qui la concernent, je ne tire pas un bilan pessimiste – mais simplement réaliste. Je crois en effet que l’étude du sens ne peut être systématique, au sens fort de ce terme, mais qu’elle peut consister en un bricolage méthodique, ce qui n’est déjà pas si mal... J’entends par là qu’il faut se servir des critères que la linguistique met à notre disposition, mais en les ajustant à chaque fois au mot qu’on étudie. Et il ne faut pas craindre de reconnaître que, dans cette adaptation constante de l’outil à l’objet, l’intuition intervient inévitablement, et qu’il convient peut-être de la considérer, non comme une intruse qui disqualifie la fin qu’elle sert, mais comme une procédure de découverte à part entière 80 . Après tout, dire qu’on peut (ou doit) être linguiste en se passant de l’intuition, n’est-ce pas un peu comme si l’on prétendait qu’on peut (ou doit) être musicien sans avoir d’oreille musicale... L’important est que cette intuition soit constamment régulée, cautionnée, par des critères moins subjectifs, et que la démarche d’ensemble résulte d’un équilibre entre ces différentes composantes. C’est dans cet esprit que je souhaite aborder l’objet de recherche que je me suis donné 81 .
Voyons de plus près dans quelle mesure le cadre méthodologique que j’ai posé, et qui reprend, en grande partie, des notions communes concernant la polysémie, peut convenir à cet objet de recherche. Les études menées généralement portent sur des mots du lexique contemporain, dont les significations sont plus ou moins établies, et pour lesquels on peut, en principe, faire appel à l’intuition immédiate. D’autre part, elles ont souvent pour objectif de servir une théorie qu’elles illustrent, qu’il s’agisse de mettre en évidence les mécanismes généraux de la polysémie, ou d’interroger sur tel ou tel de ses aspects – je pense en particulier aux concepts de métaphore et de métonymie, qui constituent des hauts lieux de l’interrogation savante pour les sémanticiens cognitivistes. Enfin, si l’approche interne est au cœur de toute étude de polysémie, l’approche externe trouve un champ privilégié dans les mots qui, par nature, appellent les constructions qui constituent leur distribution immédiate, le verbe et l’adjectif en particulier.
Mon objet de recherche est composite. Il compte des mots du lexique moderne et contemporain (air-fluide gazeux et air-apparence) et des mots du XVIIesiècle (air-élément et air-manière d’être) 82 . Comme on l’a déjà dit, ces derniers ne possèdent pas de significations établies, et celles du mot air-manière d’être se présentent d’emblée comme particulièrement difficiles à saisir. Plus proche de nous, la signification air-apparence possède aussi ses zones d’ombre. Les vertus de l’intuition immédiate s’en trouvent d’autant diminuées. D’autre part, ces mots sont des noms, qui se répartissent sémantiquement en deux types, selon qu’ils dénotent une réalité physique (l’air qu’on respire) ou abstraite (l’apparence et la manière d’être), et l’approche distributionnelle doit tenir compte, à la fois de ce passage à la catégorie nominale, et de l’hétérogénéité sémantique qui s’y manifeste. De plus, la procédure elle-même demande à être précisée. Quand on considère, dans le sillage de N. Chomsky, que seuls les verbes et les adjectifs possèdent des traits de sélection, c’est qu’on prend en compte les contraintes de construction qui sont liées à ces catégories. On se place donc dans le cadre de ce que j’appellerai un distributionnalisme étroit (ou strict). Dans cette logique même, l’hypothèse de N. Chomsky doit être nuancée dans la mesure où les noms (nominalisations, en particulier) peuvent connaître ce type de contraintes. Mais l’analyse peut prendre une autre dimension, si l’on considère que, de toute façon, toute unité lexicale entre en combinatoire avec d’autres unités. De ce point de vue, le nom relève, lui aussi, de l’approche distributionnelle (au sens large), même si celle-ci ne présente pas le même degré de contrainte et de systématicité que dans le cas du verbe et de l’adjectif. Je serai naturellement amenée à exploiter ces deux aspects du distributionnalisme (réservant le terme d’approche externe au distributionnalisme étroit), et à reconnaître d’ailleurs, au cours de cette expérience, que la frontière entre les deux n’est pas toujours évidente. On ne cherchera pas toutefois à résoudre ce problème, plus théorique que pratique, et qui n’est pas crucial pour notre recherche.
Enfin mon objectif est d’atteindre, à travers les significations, le monde des représentations. Notre objet de recherche nous y invite, et notre projet de recherche nous y oblige. L’objet, ce sont les différents mots air du XVIIe et du XXe siècles. Or ces mots occupent, pour des raisons différentes, une place de choix dans le lexique. L’air qu’on respire est une donnée fondamentale de l’expérience physique de l’homme, à toutes les époques. Quant à l’air abstrait, il touche à l’image que la personne donne d’elle-même, et il semble avoir une place privilégiée dans la société et les discours du XVIIe siècle. L’un et l’autre ne peuvent que mobiliser fortement imaginaire et point de vue collectifs. Quant au projet de recherche, il est de mettre en évidence la dérivation qui s’établit entre air-élément et air-manière d’être au XVIIe siècle, puis d’établir une comparaison avec le XXe siècle. On ne voit guère comment on pourrait mener à bien la première entreprise à partir de significations purement dénotatives, renvoyant à l’objet sans prendre en considération la dimension subjective. Quant à la seconde, elle n’a d’intérêt que si l’on met en regard, à travers les mots, les différences de mentalité qu’ils révèlent. Ce disant, nous n’affirmons rien d’original par rapport aux recherches actuelles, qu’il s’agisse de l’approche psychomécanique de J. Picoche, qui a su remplacer les (anciennes) équations sémiques déshydratées du type Cheval : [+ nom] [+ Masc] [+ mâle] [+ équidé] [- hybride] par des significations riches en représentations symboliques et culturelles (voir J. Picoche, 1992c / 1995a, article n°35), ou de la sémantique cognitive pour qui le rapport entre le sens d’un mot et l’objet passe par l’expérience humaine (on se reportera, bien sûr, au « mythe expérientialiste » de G. Lakoff, M. Johnson, 1985). Notre but n’est pas de faire ou de refaire des articles de dictionnaires, mais de nous mettre à l’écoute des mots et à l’affût de toutes leurs résonances. Sans ouvrir le large débat qui porte sur la frontière entre définition linguistique et définition encyclopédique (on se reportera à G. Kleiber, 1990a), nous pouvons dire que nos définitions, dans leurs résultats, se rapprocheront plutôt des « stéréotypes », au sens de H. Putnam, ayant pour visée « la représentation effective » des choses (R. Martin, 1990, p. 89).
Il se confirme donc que j’ai à mener un important travail de terrain, dans la mesure où je dois, d’une part, construire les significations qui ne sont pas (ou pas suffisamment) établies, et d’autre part, dégager les représentations qui se trouvent associées aux significations. C’est pourquoi, comme je le disais précédemment, ce travail de terrain ne pourra guère laisser place au débat théorique pris en lui-même. On ne trouvera donc pas, dans les pages qui suivent, de considérations abstraites et savantes destinées à exposer, confronter et évaluer les théories en cours relatives à la polysémie... Je me contenterai de mettre en œuvre aussi rigoureusement que possible les critères que je viens de présenter, à des fins de structuration référentielle de la polysémie des mots concernés. Tout au plus, dans la phase de récapitulation propre à chaque étude, j’essaierai de dégager tel ou tel « type » de polysémie 83 .
Voyons maintenant les possibilités et les limites d’application que présente notre cadre méthodologique, en fonction des données que je viens de préciser. Il ne s’agit que d’ouvrir des pistes, à partir des éléments de base dont on dispose (je m’en tiendrai avant tout aux informations fournies par le PR), étant entendu qu’un bilan méthodologique précis sera établi par la suite pour chacun des mots étudiés.
Je commence par les mots air-fluide gazeux et air-apparence du XXe siècle, plus proches de nous et pour lesquels on dispose d’un matériau lexicographique plus exploitable.
Le premier, en tant qu’il dénote une réalité physique, est, à première vue, plus saisissable sémantiquement que le second. Il possède un certain nombre de significations établies dont font état les dictionnaires. Si on se reporte à l’article du PR :
- cour.Fluide gazeux constituant l’atmosphère, que respirent les êtres vivants.
- Ce fluide en mouvement.
- Espace rempli par ce fluide au-dessus de la terre.
- loc. adv.en l’air : en haut, vers le ciel.
- fig. Atmosphère, ambiance.
on constate, comme on pouvait s’y attendre, que la structuration de sa polysémie relève plus de l’approche interne que de l’approche externe – un nom concret ou dénotant une réalité physique n’ayant pas, en principe, vocation à régir des compléments. Dans la présentation non hiérarchisée proposée par le PR, on constate que les définitions illustrent assez bien les concepts de l’approche interne. À partir de la première définition, posée comme signification de base, les autres définitions procèdent implicitement par restriction de sens en 2, dérivation métonymique en 3 et 4 (avec l’expression en l’air), métaphorique en 5. Ajoutons que l’expression en l’air est elle-même source de métaphores. Nous verrons comment on peut élaborer cette présentation, en confrontant les dictionnaires, en travaillant sur les définitions et les exemples, et en analysant de près les variations sémantiques. Mais comment entrer plus avant dans les représentations que véhicule ce mot ? Certes, les variations sémantiques, par elles-mêmes, en particulier les significations figurées, apportent des informations instructives sur la manière dont on se représente l’air qu’on respire. Mais cette approche n’est pas suffisante. Pour mener à bien l’enquête, il convient de prendre très largement en compte les contextes d’emploi du mot, qu’il s’agisse de contextes libres, ou plus ou moins contraints (collocations, expressions) 84 .Comment étudier méthodiquement ces contextes, en particulier quand il s’agit de contextes libres ? Si le mot air-fluide gazeux ne possède pas de constructions spécifiques, il n’en est pas moins soumis, en tant que nom, à la combinatoire propre à sa catégorie. Cette combinatoire comporte deux niveaux, selon qu’on considère la structure du syntagme nominal, puis les modalités d’insertion de ce syntagme nominal dans l’énoncé. Au premier niveau, on peut prendre en compte l’actualisation et les expansions du nom – complément prépositionnel (l’air des villes) et adjectif (ou constituant adjectival) (air humide, moite, sec). Au second niveau, les contextes sont, en principe, plus diversifiés, dans la mesure où le syntagme nominal peut entrer dans de multiples structures syntaxiques et actancielles. Notons que l’adjectif, selon les fonctions qu’il occupe, peut jouer sur les deux niveaux. L’étude du corpus permettra de dégager les structures privilégiées, comme, par exemple, des constructions verbales telles que respirer, aspirer, expirer, humer (l’air), se griser d’(air). Conformément à la mise au point faite précédemment, on retrouvera donc, à ce niveau d’analyse, les procédures de l’approche distributionnelle. Ces procédures seront, là encore, exploitées sans esprit de système, en fonction de leur rendement, et d’un point de vue sémantique, dans la mesure où les structures formelles, relevant de la catégorie nominale en général et non du mot air en particulier, n’ont de pertinence qu’en tant qu’elles constituent des voies d’accès au sens. Ainsi, on s’attachera aux qualités et propriétés présentes dans les adjectifs, aux indications de lieux contenues dans les compléments prépositionnels, aux relations sémantiques et actancielles exprimées par les constructions verbales (l’air étant mis en relation avec la personne qui respire). Comme on le voit, il sera difficile de ne pas faire intervenir une intuition, si minimale soit-elle, dans cette étude contextuelle.
Le mot air-apparence fait l’objet, dans le PR, de la présentation suivante :
- Apparence générale habituelle à une personne.
- Apparence expressive plus ou moins durable, manifestée par le visage, la voix, les gestes, etc.
- avoir l’air : présenter tel aspect.
Cette présentation soulève d’emblée un problème syntaxique, à travers la mention de la séquence avoir l’air. On sait que cette séquence, lorsqu’elle est suivie d’un adjectif, donne lieu à des variations formelles :
‘« Tous ont l’air triste » (Flaubert) (PR)Elle avait l’air surprise. (PR)’
selon que l’adjectif s’accorde avec le mot air ou avec le sujet. Ces variations entraînent un découpage différent de la séquence, et, partant, deux analyses distinctes du mot air. Pour le dire en termes simples, dans le premier cas, on a à faire à un syntagme nominal (l’air) autonome, COD du verbe avoir, tandis que, dans le second cas, ce syntagme perd son autonomie et devient élément de la locution verbale avoir l’air. Dans la mesure où cette différence syntaxique entraîne un changement de signification (intuitivement perceptible, comme c’est le cas), elle peut être considérée comme un critère de structuration externe, permettant de distinguer les emplois pleins du mot air de ses emplois locutionnels. Nous verrons par la suite que les choses sont beaucoup plus complexes, dans la mesure où la séquence avoir l’air est susceptible d’emplois que l’absence de marques rend fortement ambigus. C’est ce qui explique d’ailleurs le fait que le PR ait ouvert une rubrique fourre-tout, où il regroupe indifféremment, sous une même définition, toutes les occurrences de la séquence avoir l’air, sans pousser plus loin l’analyse. Il n’empêche que nous pouvons d’ores et déjà retenir le principe d’une distinction entre ces deux grands types d’emplois. Voyons maintenant les emplois pleins du mot air. Peut-on exploiter, en ce qui les concerne, l’approche externe, telle que nous l’avons définie précédemment ? Nous avons vu que, d’une part, cette approche ne convenait pas nécessairement à toutes les catégories de mots, et que, d’autre part, elle servait plus à structurer la polysémie d’un mot à partir de significations (à peu près) établies, qu’à construire le contenu de ces significations. Voyons ce qu’il en est de notre air-apparence. Ce nom, à la différence d’air-fluide gazeux, présente une contrainte de construction, dans la mesure où il se dit nécessairement de quelque chose (plus exactement, de quelqu’un), et met donc en appel un support nominal. D’une manière ou d’une autre, il est toujours question de l’air de quelqu’un, et, là encore, on peut avoir recours à la notion de nom syncatégorématique. En tant que telle, cette structure ne constitue pas un critère de différenciation sémantique, puisqu’elle se retrouve, en principe, dans tous les emplois de ce mot. En revanche, ce qu’on peut prendre en compte, ce sont les diverses modalités d’insertion syntaxique du mot air. Une lecture rapide de l’article du PR livre, aux côtés du syntagme nominal l’air de quelqu’un (qui exprime le plus naturellement la structure dont il vient d’être question), la phrase avec avoir, du type avoir un air étonné (PR), la construction avec l’attribut du COD mentionnée ci-dessus, etc. La question se pose de savoir si ces variations de construction peuvent être exploitées de façon pertinente dans l’étude de la polysémie du mot air. Certes, cette pertinence ne saute pas aux yeux. Ainsi, d’une définition à l’autre, on peut retrouver, dans le PR, la même construction. Par exemple, la phrase avec avoir permet d’illustrer aussi bien la première :
‘Apparence générale habituelle à une personne [...] Il a un drôle d’air. ’que la seconde définition :
‘Apparence générale expressive plus ou moins durable, manifestée par le visage, la voix, les gestes, etc. [...] Avoir, prendre un air étonné.’Il ne s’agit toutefois que d’une première approche des faits, qui ne doit pas préjuger des résultats d’une étude plus approfondie, ces modalités d’insertion du mot air pouvant être retenues comme une piste de recherche possible. Nous aurons évidemment l’occasion de revenir en détail, à partir de l’étude des dictionnaires, sur la problématique relationnelle (en tant que nom syncatégorématique) et syntaxique de ce mot. Ajoutons que, dans le cadre de la structure précédemment posée (l’air de), on peut introduire une variation sémantique du type « quelqu’un » / « quelque chose », dans la mesure où certains dictionnaires mentionnent des contextes dans lesquels le mot air se trouve appliqué à des choses :
‘Quant à ces petits diamants, ils vous ont un air de vérité (France). (GLLF) ’Même si ces emplois sont peu nombreux par rapport à ceux qui touchent à la personne, cette opposition doit être prise en compte, car elle signale à l’évidence un changement de signification et pose le problème de l’éventualité d’une transposition métaphorique du mot air de l’humain au non animé. Elle se situe toutefois à un niveau très général de structuration, qui ne nous apprend pas grand-chose sur les significations particulières. Certes, on peut, en ce qui concerne les supports non animés, pousser l’analyse plus avant en essayant de dégager leurs traits spécifiques. Mais cette analyse n’a d’intérêt que si on la mène à partir des significations relatives à la personne, majoritaires et prioritaires dans le fonctionnement du mot air. On en revient donc au point de départ. À première vue, l’approche externe n’apporte donc pas grand-chose à la structuration de la polysémie de ce mot. Et, par ailleurs, comme on l’a dit, elle n’a pas particulièrement vocation à établir les significations. Or c’est en grande partie la tâche qui nous attend avec le mot air-apparence, dont les significations restent relativement floues. Telles qu’elles se présentent dans le PR 85 , les deux significations relatives à la personne peuvent être, dans un premier temps, soumises à l’approche interne, qui mettra en évidence les variations de traits de l’une à l’autre. On remarque, par exemple, que le trait « physique » varie en extension, selon que l’apparence est « générale » (PR) ou locale, limitée au « visage », à la « voix », aux « gestes », etc. (PR). Il en est de même du trait « temps », puisqu’on passe d’une apparence « habituelle » (PR) à une apparence « plus ou moins durable » (PR). Il va de soi que ces remarques sont insuffisantes, et que nous serons amenée à faire un travail en profondeur sur les définitions des dictionnaires – travail d’autant plus exigeant que celles-ci contiennent d’autres mots abstraits, eux-mêmes difficiles à définir, comme apparence, par exemple. On ne négligera pas non plus de recourir aux synonymes extérieurs aux définitions, assez nombreux en l’occurrence. Par exemple, pour les deux significations que nous avons relevées, le PR propose, respectivement, les synonymes allure, façon, genre et expression, mine. Mais, là encore, nous aurons besoin, à la fois pour élaborer les significations et pour préciser les représentations qui s’y attachent, de recourir, comme précédemment, aux contextes d’emploi du mot – expressions, collocations, contextes libres. La caractérisation du mot air sera très largement mise à contribution, à travers les contenus de signification qu’elle véhicule. On peut s’attendre à ce qu’elle joue un rôle dominant dans la différenciation des significations relatives à la personne, comme tend à le montrer la lecture de l’article du PR. Les exemples qui illustrent la première définition offrent plutôt des caractérisations de type « social », tandis que ceux qui se rattachent à la seconde définition contiennent des caractérisations psychologiques. Nous verrons d’ailleurs, à cette occasion, que le statut de la caractérisation d’air-apparence est beaucoup plus complexe qu’il ne l’était avec air-fluide gazeux. D’abord, parce qu’elle est susceptible de prendre des formes multiples et subtilement diversifiées, mais aussi parce qu’elle pourrait bien avoir, par rapport au mot air, une fonction beaucoup moins « contextuelle » qu’il n’y paraît. Mais n’anticipons pas sur nos (longues et laborieuses) analyses à venir. Les constructions verbales seront également prises en compte (prendre un air, changer d’air, regarder avec / d’un air, par exemple). Là encore, l’approche sera non systématique et, avant tout, sémantique. Mais il y a pire... En raison du caractère très évanescent d’air-apparence, il nous faudra aller au-delà de ces contextes proches et ratisser plus largement les énoncés, à la recherche d’indices susceptibles de contribuer à l’élaboration du sens. C’est dire que nous nous engagerons dans des voies moins balisées encore que celles que nous avons essayé de tracer jusque-là, et que, selon la nécessité du moment, il nous arrivera de prendre en compte, sans ordre et sans méthode, une marque de pluriel, le temps d’un verbe, la présence d’une préposition, l’ordre des constituants, un procédé de juxtaposition, telle synonymie ou opposition contextuelle, la situation de référence, etc. – l’approche, à ce niveau, étant plus que jamais interprétative et intuitive. Péché avoué, dit le proverbe...
C’est donc dans un cadre méthodologique élargi que nous situons notre étude sémantique des mots air-fluide gazeux et air-apparence. Si répréhensible soit-elle, cette ouverture répond à la double tâche que nous nous sommes assignée, de construire les significations (d’air-apparence, en particulier) et d’accéder aux représentations qu’elles impliquent. Dans cette perspective, la double approche, externe et interne, que nous avions posée au départ, s’avère insuffisante. On constate, en effet, que, plus la saisie des contenus présente d’exigences ou de difficultés, plus il convient d’élargir le cadre de l’étude. On passe ainsi d’une approche distributionnelle stricte, qui s’attache aux constructions spécifiques du mot, à l’étude plus diversifiée des contextes étroits dans lesquels le mot peut se trouver (expressions, collocations, formes d’intégration dans l’énoncé), puis à une recherche d’indices, plus ou moins informelle, dans un contexte plus large.
C’est cette même progression que nous allons appliquer à l’étude des mots air-élément et air-manière d’être au XVIIe siècle. Il est plus difficile, en l’absence d’une compétence immédiate et d’un matériau lexicographique établi, de poser, même sommairement, comme nous l’avons fait pour air-fluide gazeux et air-apparence, la problématique de ces deux mots. En prenant appui sur Furetière et Littré, je m’en tiendrai donc à quelques remarques, plus proches de l’impression première que d’observations fondées.
Air-élément semble, comme air-fluide gazeux, relever davantage de l’approche interne que de l’approche externe. Si l’on se reporte à Furetière et à Littré, on retrouve, d’un mot à l’autre, les dérivations de sens, qui procèdent par restriction, quand air signifie « vent » (Littré) ou par métonymie, quand ce mot (de préférence au pluriel) dénote « l’espace au-dessus de nos têtes » (Littré) ou entre dans l’expression en l’air. La dérivation métaphorique est moins apparente. Furetière n’en fait pas mention. Quant à Littré, il fournit des expressions qui relèvent de cette interprétation (Cela est dans l’air, l’air du bureau), mais dont l’absence de datation rend l’exploitation incertaine. Ajoutons que l’expression en l’air semble faire preuve, à cette époque, d’une assez bonne productivité métaphorique. Ces similitudes ne suffiront certes pas à construire la polysémie d’air-élément au XVIIe siècle... Pour établir les significations et les représentations propres à ce mot, nous mettrons également en œuvre, comme précédemment, l’étude méthodique du contexte proche, à travers les expressions, les collocations, et les apports de la combinatoire nominale.
Venons-en à air-manière d’être. Je commencerai par l’approche interne, sur laquelle il y a peu de choses à dire. Si je ne fais pas cas des acceptions restreintes ou spécialisées, les principales significations que je relève dans Littré sont :
‘Apparence extérieure.Manière, façon.
Le bel air, les manières élégantes.
Le grand air, le ton du grand monde.
Bon air, manière élégante, distinguée ; mauvais air, les manières de la mauvaise compagnie.’
la plus grande partie des exemples correspondant à la définition la plus générale manière, façon. On ne voit guère comment on pourrait travailler sur un matériau aussi peu explicite, qui a obstinément recours à un synonymeaussi abstrait et flou que manière(s). Quant aux synonymes extérieurs aux définitions, il n’y en pas. Et si l’on en trouvait, il y a fort à parier qu’ils ne feraient que déplacer le problème, et qu’ils donneraient au lexicologue autant de fil à retordre que le mot air... Qu’en est-il de l’approche externe ? D’abord, la séquence avoir l’air n’est pas signalée en tant que telle dans les dictionnaires, et l’on ne trouve aucune trace d’exemple du type Elle avait l’air surprise, marqué par l’accord de l’adjectif avec le sujet. D’autre part, si l’on est tenté de faire l’hypothèse d’une contrainte de construction (du type l’air de quelqu’un), comme pour le mot air-apparence, il faut reconnaître que celle-ci ne permet pas de couvrir la totalité des constructions rencontrées. Certes, dans les exemples de Littré 86 , on retrouve :
‘D’abord on ne l’avait point regardé, à cause de ses habits simples et négligés, de sa contenance modeste, de son silence presque continuel, de son air froid et réservé, Fénelon, Télémaque.Mon Dieu ! qu’elle est jolie et qu’elle a l’air mignon ! Molière, l’Étourdi.
Un inconnu qui avait un air majestueux, Fénelon, Télémaque.’
les constructions (son air froid et réservé, elle a l’air mignon, qui avait un air majestueux) observées précédemment, mais on en rencontre aussi d’autres, qui n’ont plus cours de nos jours :
‘J’ai vu les personnes du bel air, Molière, Pourc.Votre frère est dans le bel air, Sévigné.
Elle nous fit un air honnête, Sévigné.
Tout cela était un air pour me faire savoir qu’elle a un équipage, Sévigné.’
et qui rendent problématique la mise en place d’une structure unique. Et je ne compte pas les emplois, déjà relevés, du type :
‘L’air de cour est contagieux ; il se prend à Versailles, comme l’accent normand à Rouen ou à Falaise, La Bruyère.L’air précieux n’a pas seulement infecté Paris ; il s’est aussi répandu dans les provinces, Molière, Les Précieuses ridicules.’
qui illustrent une (possible) dérivation métaphorique d’air-élément à air-manière d’être. On peut alors se demander si cette diversité de constructions a quelque pertinence pour l’étude sémantique, sans compter qu’il est difficile de statuer sur le caractère contraint ou non de certaines de ces constructions. À lire l’article de Littré, une exploitation syntaxique systématique semble bien hasardeuse. En dehors de la construction faire un air à quelqu’un, qu’on trouve dans la citation de Mme de Sévigné, et qui semble spécifiquement affectée à la signification « accueil », on ne voit guère se dégager de corrélations syntaxico-sémantiques dans le cours de l’article. Et quand ce serait le cas, n’oublions pas que, si le critère syntaxique permet de structurer la polysémie à partir de significations à peu près établies, il n’a pas vocation à construire ces significations. Or c’est bien, comme nous l’avons déjà dit, la tâche prioritaire qui nous attend. On ajoutera que le mot air-manière d’être peut s’appliquer aux choses :
‘Un château qui a le meilleur air du monde, Sévigné.Votre dernière lettre a un air de gaieté, Sévigné.’
ce qui pose, comme de nos jours, le problème de la transposition métaphorique de l’humain au non animé. Mais, là encore, ce critère de combinatoire sémantique ne donne qu’une indication de structuration très générale, et on ne pourra tirer profit d’une étude plus fine en traits spécifiques qu’une fois établies les significations relatives à la personne. Il ne faut donc pas trop fonder d’espérance sur l’approche externe...
Je le dis avec d’autant plus de conviction résignée que j’ai mené sur le mot air-manière d’être une expérience de cette nature, bien avant d’engager la présente recherche 87 . Je crois qu’il ne sera pas inutile d’en exposer brièvement ici le contenu et les résultats, dans un but de clarification (sinon de justification) méthodologique. Je m’étais donné comme objectif, dans une perspective structuraliste, de procéder à l’analyse en traits de sens du mot air-manière d’être, à partir d’un champ générique, sur le modèle du champ des sièges de B. Pottier. Et d’autre part, j’avais comme ambition d’essayer de constituer ce champ à partir de procédures (quasi) entièrement objectives, en prenant comme référence théorique et méthodologique le champ distributionnel que J. Apresjan (1966) avait établi pour les verbes anglais. La démarche comportait trois temps : construire le modèle syntaxique du mot air, obtenir par commutation les mots qui acceptent d’entrer dans ce modèle, extraire les traits de sens communs à tous les mots du champ ainsi obtenu. L’enquête syntaxique, qui demandait une observation particulièrement minutieuse des faits, devait se faire à partir d’un corpus restreint. J’avais choisi La Princesse de Clèves, qui fournit un corpus homogène et occupe une place centrale dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Ce corpus offrait deux types de structure grammaticale. La première, illustrée par l’exemple suivant :
‘Je n’ai rien de fâcheux dans l’esprit, répondit-elle avec un air embarrassé 88 .’était du type :
‘verbe de parole + avec / d’un air + adjectif.’La seconde structure grammaticale, élaborée à partir d’exemples tels que :
‘l’air brillant qui était dans sa personneelle avait un air qui inspirait un si grand respect
l’air de sa personne / votre air’
constituait un modèle syntaxique à trois étages, qu’on pouvait formuler ainsi :
‘un air est dans XX a un air
l’air de X.’
Je m’attacherai ici à cette seconde structure, plus représentative du fonctionnement du mot air-manière d’être, me réservant de revenir sur la première par la suite. Dans ce modèle, X représente une variable sémantique, qui se laisse interpréter selon l’opposition « personne » / « chose », puisqu’on peut trouver, à côté des mots se rapportant à des personnes, comme dans les exemples ci-dessus, des lexèmes, tels que réponse, parole, action, dénotant des choses abstraites. De plus, il convient de préciser que la personne est vue dans son aspect physique, dans son extériorité. On le voit, ce modèle, qui met en jeu des traits syntaxiques, des traits sémantiques généraux, et des traits spécifiques bien identifiés, répond aux exigences d’objectivité posées au départ. La procédure de commutation, qui devait se faire autant que possible à partir d’exemples attestés (dans La Princesse de Clèves et, éventuellement, dans Littré), ne fut pas sans résultats.
On a pu dégager quatre séries de mots :
- Les mots qui acceptent la totalité des conditions, syntaxiques et sémantiques, du modèle, c’est-à-dire les trois constructions et l’ensemble du paradigme de X. Ce sont agrément, charme, douceur, grâce, grandeur. Ils constituent le champ lexical au sens strict du mot air.
- Les mots qui acceptent la totalité des constructions syntaxiques, mais n’admettent pas l’ensemble du paradigme de X. Ce sont les mots aigreur, hardiesse, raison, vraisemblance, qui ne peuvent se dire de la personne physique – les mots vraisemblance et raison ne pouvant non plus se dire des actions. Ces mots, qui sont seulement en infraction sémantique par rapport au modèle, constituent un sous-ensemble du premier champ lexical.
- Les mots qui acceptent la totalité du paradigme de X. On a admis, lors de la procédure de commutation qui a porté sur le paradigme de X, certaines variantes du type : « personne physique » / « partie du corps (visage) »., mais n’admettent pas la totalité des constructions syntaxiques. Ce sont les mots embarras, tristesse, trouble, pitié, admiration, qui n’admettent pas la construction avec avoir. En revanche, ils acceptent des constructions nouvelles, ce qui permet de les subdiviser en deux séries :
- les mots embarras, tristesse, trouble, qui admettent la construction être dans (un trouble, un embarras, une tristesse) ;
- les mots pitié, admiration, qui admettent la construction avoir (de la pitié, de l’admiration) pour.
Le premier champ (embarras, tristesse, trouble) a pour archilexème le mot état, tandis que le second a pour archilexème le mot sentiment. Ces deux champs sont des champs voisins du premier champ lexical.
Certains mots ne se laissent toutefois pas aussi facilement enfermer dans cette grille un peu sommaire. Ainsi le mot douceur, présent dans le premier champ, admet la construction avoir (de la douceur) pour, ce qui l’apparente aussi aux mots qui expriment un sentiment. Quant au mot aigreur, qu’on trouve dans le second champ, il admet la construction être dans (une aigreur) et avoir (de l’aigreur) pour, contre, quelqu’un, ce qui l’apparente à la fois aux mots qui dénotent un état et à ceux qui expriment un sentiment.
Si l’on regroupe les mots des deux premiers champs, qui vérifient la totalité des constructions syntaxiques du mot air, soit :
‘agrément, charme, douceur, grâce, grandeur (premier champ)aigreur, hardiesse, raison, vraisemblance (second champ)’
on constate que ce sont des noms abstraits qui expriment une qualité, et peuvent, tous, être mis en corrélation avec un adjectif :
‘agréable, charmant, gracieux, doux, grandaigre, hardi, raisonnable, vraisemblable.’
En tant que tels, ils admettent l’actualisation partitive (de l’agrément, du charme, de la hardiesse). Or le mot air ne dénote pas une qualité particulière, et n’admet pas l’article partitif. Il convient donc d’affiner la procédure de commutation, en établissant l’équivalence, non entre douceur et air, par exemple, mais entre douceur et le syntagme nominal air doux, dans lequel le contenu de la qualité est pris en charge par l’adjectif. Ce qui donne :
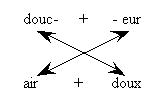
Le mot air commute alors, plus strictement, avec le suffixe - eur, qui exprime, non le contenu de la qualité, mais la notion même de qualité. Notons que, même si tous les mots du champ ne possèdent pas un suffixe, le principe de l’équivalence reste le même – le mot air correspondant toujours à la notion de qualité qu’implique la marque de substantivation. Cette qualité présente le trait « non matérialité », puisqu’on ne rencontre jamais, dans le champ lexical, de noms abstraits exprimant des qualités physiques, comme blancheur, rougeur, grosseur. On pourrait donc remplacer « qualité » par « manière d’être », dans la mesure où l’on ne parle jamais d’une * manière d’être blanche ou rouge, par exemple. D’autre part, cette manière d’être est « extérieure », puisque les mots du champ lexical ne se disent que de supports ayant ce trait, qu’il s’agisse de la personne physique, de paroles ou d’actions. On obtient donc, pour le mot air, le signifié suivant : « manière d’être extérieure ».
Quel bilan pouvons-nous tirer de cette étude ? Certes, l’approche externe est exploitée ici dans sa plus grande rigueur, et elle permet de dégager une signification très abstraite du mot air, qui peut conduire à divers effets de sens, comme, par exemple, « allure », si le mot air se dit de la personne entière, « expression du visage », s’il ne s’applique qu’à cette partie du corps, « ton », s’il est en rapport avec la parole, etc... Mais est-ce une découverte importante ? Les définitions de Littré, dont nous avons dénoncé la pauvreté, nous en disent presque autant... Et les synonymes agrément, charme, grâce, qui apparaissent dans le premier champ lexical (c’est-à-dire le champ lexical au sens strict du mot air) sont des mots qu’on rencontre souvent dans les textes et qui sont tout à fait représentatifs de l’époque, mais dont le contenu est au moins aussi indéfinissable que celui du mot air... Quant à l’identification des effets de sens propres au mot air, qui constitue l’objet même de l’approche polysémique, elle reste à faire entièrement. Finalement, on peut se demander si la rentabilité de l’expérience n’est pas seulement de nature méthodologique et théorique. On a pu montrer, en effet, qu’il est possible de structurer le champ lexical d’air-manière d’être, puis de dégager la signification de base de ce mot, au moyen de procédures distributionnelles (quasiment) indiscutables. On pourrait en conclure que la syntaxe est, en grande partie, pertinente dans l’étude du sens, et qu’il est possible, dans une certaine mesure, d’accéder aux significations lexicales de manière objective. Mais, dans ce cas, on peut dire que l’objet de recherche n’est guère adapté à la finalité. On ne voit pas pourquoi il faudrait précisément partir, pour prouver cela, du mot air au XVIIe siècle, alors qu’on peut, plus naturellement, s’occuper d’ensembles lexicaux dans notre champ contemporain. Et pour peu qu’on s’intéresse, en tant que lexicologue, au mot air et au XVIIe siècle, on se demande ce que peut apporter cette sorte d’épure sémantique que nous avons dégagée – sinon une base de travail pour d’autres recherches 90 .
Mais il y a plus. Nous nous sommes rendu compte, en explorant d’autres corpus que le texte limité que nous avions choisi au départ (et, en particulier, la correspondance de Mme de Sévigné), que notre modèle syntaxique pouvait être mis en question. Non seulement la construction du type un air est dans (quelqu’un) se faisait rare, mais d’autres constructions apparaissaient, qui n’avaient pas été prévues, ou – découverte plus éprouvante encore – qui avaient été éliminées. On a cité ci-dessus quelques exemples des unes et des autres. Parmi les constructions nouvelles, on notera encore être d’un air, et parmi les exclues, la construction être dans un air :
‘Votre frère est dans le bel air, Sévigné (Littré).’à laquelle il convient d’ajouter des occurrences telles que :
‘[...] je ne crois pas qu’il y ait un air de politesse et d’agrément pareil à celui qu’il a pour moi. (t. 1, l. 279, p. 525)Vous connaissez le maître, et le bon air et le bon esprit qu’il a pour < ceux > qu’il aime un peu [...] (t. 2, l. 601, p. 531)’
qui illustrent la construction avoir un air pour quelqu’un... et sans compter, là encore, les emplois (possiblement) métaphoriques d’air-élément. Dans ces conditions, le pari syntaxique et distributionnel que j’avais essayé de tenir apparaissait à la fois comme sémantiquement infructueux et méthodologiquement hasardeux. L’éclatement du modèle que j’avais (laborieusement) mis en place nécessitait que je parte sur de nouvelles bases, que je n’étais pas sûre de maîtriser. Et, en admettant même que je parvienne à élaborer un modèle plus complexe, il était à craindre que les résultats restent aussi frustrants au plan sémantique – la rentabilité de la démarche risquant d’être dérisoire par rapport à son coût. Or il ne me semblait pas possible de maintenir le choix de cet objet de recherche, le mot air-manière d’être au XVIIe siècle, sans vouloir essayer de le saisir dans toute la richesse de ses acceptions et de ses représentations d’époque, sur lesquelles l’expérience tentée ne m’avait finalement rien apporté.
Si cette expérience n’a pu être poussée plus avant, elle a toutefois joué un rôle dans l’orientation que j’ai prise et qu’illustre la présente recherche. J’ai voulu mettre au service de la sémantique différentes formes d’approche linguistique, allant de procédures formelles à d’autres plus informelles, de la distribution et du contexte étroit au contexte étendu, dans un cadre méthodologique élargi, qui échappe à tout esprit de système et où l’intuition se trouve constamment activée.
Avec les mots air-élément et air-manière d’être du XVIIe siècle, ce cadre méthodologique va encore devoir s’ouvrir davantage, dans la mesure où ces deux mots offrent des contenus de significations encore moins accessibles et des représentations peu familières. D’abord, l’exploration du contexte sera d’autant plus approfondie que nous ne serons plus tenue par les exemples du dictionnaire, qui, lorsqu’ils ne se réduisent pas à de simples fragments, ont la phrase pour limite maximale. Les citations que nous relèverons dans la correspondance de Mme de Sévigné auront les dimensions que nous lui donnerons, allant de la phrase, qui représentera, cette fois, la dimension minimale, à des extraits, découpés plus ou moins largement autour de l’occurrence concernée. Là encore, il s’agira de trouver les indices linguistiques qui, au plan de la forme et du sens, contribueront à éclairer la signification étudiée. On pourra s’attacher, en particulier, aux procédés d’enchaînement (anaphoriques, en particulier), plus repérables dans les relations interphrastiques, et à toutes les formes de cohésion sémantique (reprises de traits de sens, parallèles, oppositions, explications), en s’inspirant de certains types d’approche de la grammaire textuelle. Mais, plus largement, nous essaierons de prendre en compte tout ce qui peut permettre une compréhension maximale du texte. Ce pourra être le sens de tel mot, telle expression, telle citation mal connue qui gêne la lecture, mais il s’agira aussi et surtout, au-delà du matériau strictement linguistique, de mettre à jour les connaissances de l’époque, ce savoir partagé sous-jacent au discours, et qui le porte sans afficher directement ses marques. Ces connaissances sont aussi diverses qu’imprévisibles. Selon le cas, il nous faudra préciser un lieu ou une datation, rapporter un événement ou une chronologie, identifier un ou plusieurs personnages, reconstituer une vie ou une portion de temps, décrire des situations et des relations, entrer dans le détail d’un procès... La recherche portera donc non seulement sur les indices linguistiques, mais aussi sur les données extra-linguistiques. Et dans cette double perspective, nous serons amenée à parcourir des pages entières, à suivre un événement ou un personnage sur plusieurs années, à faire des rapprochements ou des digressions, bref, à lire et à relire (on ne saurait s’en plaindre) la correspondance de Mme de Sévigné. Au fond, nous essaierons, dans la mesure du possible, de retrouver la langue et l’esprit, sinon du XVIIe siècle, du moins de nos auteurs, pour la mettre au service d’un mot... Tenter de restituer cette compétence éloignée en se laissant porter au fil du texte, en activant tous les modes de réception dont on dispose, c’est privilégier, au détriment des formes, l’accès aux contenus et le rôle de l’intuition, en se mettant en continu à l’écoute du sens, des représentations et des informations. C’est reconnaître que le mot appartient au discours, et le discours au monde, et que la fréquentation approfondie des textes constitue un véritable outil de recherche susceptible de favoriser la restitution (la plus) authentique du sens. De ce point de vue, on peut dire aussi que cette recherche ne reniera pas l’esprit d’une certaine tradition philologique 91 ...
On aura toutefois remarqué que les notions que je viens d’évoquer, qu’il s’agisse de phrase et de texte, de contexte étroit ou étendu, de savoir partagé sous-jacent au discours, me conduisent sur le terrain de disciplines linguistiques – analyse de discours, grammaire textuelle, pragmatique – particulièrement ouvertes, multiples dans leur objet et leurs approches, et dont la terminologie proliférante n’est pas toujours facile à maîtriser 92 . Une clarification minimale s’impose, qui sera menée uniquement en rapport avec notre propre objet de recherche et de manière très simplifiée.
Ce que ces disciplines ont en commun, c’est de s’intéresser en quelque sorte à « l’au-delà de la phrase » (M. Charolles, B. Combettes, 1999, p. 76). On sait qu’à partir de là, deux grandes orientations ont été prises, dont l’une, dans la foulée de R. Jakobson et d’É. Benveniste, mène à la linguistique de l’énonciation et à l’analyse du discours, tandis que l’autre conduit au projet d’établissement d’une grammaire de texte. Je n’ai évidemment l’intention ni de développer l’historique de ces courants et leur antinomie au niveau des postulats initiaux, ni d’entrer dans la diversité des approches théoriques et la complexité des modélisations, ni de retracer l’évolution des choses jusqu’à ces dernières années (un panorama de la question a été dressé par M. Charolles, 1988, ainsi que par M. Charolles, B. Combettes, 1999). Mais il n’est pas inutile de préciser le matériau d’observation de ces deux disciplines, afin de situer dans tel ou tel cadre certains aspects de ma recherche. Du côté de l’énonciation, on est sensible à l’inscription du sujet dans l’énoncé, et l’on recherche avant tout les marques formelles de la subjectivité, à travers les embrayeurs, les processus de référenciation, les temps, les discours rapportés, les modalités, les actes de langage, etc. 93 De plus, pour un certains nombre d’auteurs, cette approche ne peut se limiter à une appropriation pure et simple de la langue par le sujet parlant, la dimension sociale s’interposant entre l’individu et le système linguistique. On débouche alors sur une conception de l’analyse du discours, qui replace l’énoncé dans le cadre de situations de communication socio-historiquement déterminées 94 , et accorde un rôle un rôle central aux genres et aux typologies de discours (D. Maingueneau, 1995, 1996, p. 44 et 85). Avec la grammaire de texte, on « met l’accent sur les propriétés internes du discours » (C. Baylon, X. Mignot, 1995, p. 197), et l’on s’intéresse à l’interprétabilité des textes, à leur cohérence, ainsi qu’à leur cohésion 95 , c’est-à-dire aux marques de continuité entre énoncés ou constituants d’énoncés (anaphore, répétition, ellipse, temps verbaux, connecteurs, présupposition, thématisation, etc.) – sans oublier le rôle du savoir encyclopédique et des règles d’inférence. Notons que l’emploi des mots discours et texte a fini par reproduire la dichotomie entre ces deux grandes disciplines : « En parlant de discours, on articule l’énoncé sur une situation d’énonciation singulière ; en parlant de texte, on met l’accent sur ce qui lui donne son unité, qui en fait une totalité et non une simple suite de phrases » (D. Maingueneau, 1996, p. 82).
Cette opposition n’est évidemment pas radicale, et elle réside plus dans le point de vue adopté que dans le champ d’application, certaines unités pouvant être communes à l’une et l’autre discipline. Ainsi, les phénomènes de thématisation / rhématisation pourront être retenus autant dans l’approche énonciative et dans l’analyse de discours que dans la grammaire de texte. Comme le notent M. Charolles et B. Combettes, 1999, p. 82, les pronoms de première et de deuxième personne « se prêtent facilement à une interprétation en termes de stratégie énonciative », tandis que ceux de la troisième personne ont davantage vocation à assurer « la reprise d’un référent dans le discours ». De même, les adverbes de modalisation traduisent l’attitude du locuteur tandis que des connecteurs comme alors, en effet, toutefois, explicitent des relations logiques entre contenus propositionnels. D’autre part, comme le souligne D. Maingueneau, 1991,p. 210, « la reconnaissance de la cohérence d’un texte est pour une bonne part relative aux types de textes auxquels on le rattache ». Certaines orientations de la linguistique textuelle intègrent les problèmes de genres et de typologies des discours 96 , et se rapprochent en cela de l’analyse de discours, telle qu’elle a été précédemment définie.
Mais il convient aussi de prendre en compte un aspect fondamental de la réflexion récente, qui porte sur la nature de cet « au-delà de la phrase » commun aux différents types d’approche que nous avons évoqués. Il s’agit de la remise en cause, par les auteurs ci-dessus mentionnés (M. Charolles, M. Combettes, 1999), d’une certaine conception « discontinuiste » qui, selon eux, a dominé jusque-là les recherches en analyse du discours (au sens large du terme, englobant énonciation et grammaire de texte), et ce, à travers la séparation radicale qu’elle a opérée entre la phrase d’un côté, le texte ou le discours de l’autre. Rappelant la position d’É. Benveniste, 1966, pour qui il n’existe pas d’« unité d’un ordre supérieur à la proposition » (p. 129), M. Charolles et B. Combettes montrent que l’analyse du discours, quels que soient les modes d’organisation qu’elle met à jour, est profondément de nature sémantique et pragmatique, et qu’en cela, elle s’oppose à la phrase conçue comme un ensemble de constituants entre lesquels s’établissent des relations de dépendance hiérarchique. Or c’est précisément cette conception « formelle et géométrique » (p. 103) de la syntaxe que nos deux auteurs entendent remettre en cause, dans le sillage de la grammaire cognitive de R. Langacker en particulier. Non seulement, la phrase intègre de manière plus ou moins lâche certains constituants (les constructions détachées, en particulier), mais les relations de dépendance elles-mêmes pourraient bien avoir une origine sémantique, et, en fin de compte, la syntaxe ne ferait qu’exprimer « la façon dont le locuteur conceptualise certaines relations entre des entités » (p. 108). De la phrase au discours, il y aurait donc un continuum, puisque, de l’une à l’autre, on ne ferait qu’assembler « des représentations » (p. 108). D’une situation de rupture, on passe à une harmonie quasi fusionnelle qui ébranle à la fois une conception trop structurale de la phrase et les principes fondateurs de l’analyse du discours (toujours au sens large). Il n’y a pas lieu ici d’engager et d’approfondir le débat sur cette problématique de fond. Mais il n’est pas inutile de donner à la démarche que j’adopte dans cette recherche quelques repères en relation avec ce qui vient d’être dit.
Je préciserai d’abord qu’en fonction de la nature du projet (étude d’un mot en langue), je me situe évidemment plus dans le cadre de la grammaire de texte que dans celui de l’analyse du discours, dans ses implications socio-historiques. Ce champ de recherche n’exclura pas le domaine de l’énonciation si celui-ci permet d’enrichir les représentations qui s’attachent au mot étudié. Venons-en maintenant à la distinction posée au départ entre la phrase et son au-delà. Elle implique l’existence d’une frontière dans le matériau linguistique lui-même, alors qu’on sait que la définition de la phrase est loin d’être acquise. La prise en compte de la ponctuation, à l’écrit, n’est pas satisfaisante dans la mesure où elle délimite, de la phrase simple à la phrase complexe, des unités variables dans leur dimension et hétérogènes dans leur mode d’organisation 97 . Il est clair, par exemple, que les phénomènes de coordination et de subordination, au sein de la phrase complexe, ne peuvent être mis sur le même plan. Les premiers obéissent aux mêmes règles que les processus d’enchaînement transphrastique, tandis que les seconds relèvent en principe de la rection. En principe seulement, car la subordination, à y regarder de plus près, est un phénomène composite, les différentes subordonnées présentant des seuils d’intégration différents, selon qu’on a à faire, par exemple, à une complétive ou à une « circonstancielle » introduite par puisque. Et, de proche en proche, la désintégration peut gagner certains constituants de la phrase simple (ou de la proposition) elle-même, comme nous l’avons vu ci-dessus avec les constructions détachées 98 . Dans cette mesure, on pourrait dire que ce n’est pas l’objet qui conditionne des types d’approche différents, mais que les objets se constituent et se différencient à partir des points de vue qu’on adopte 99 . Il convient donc de clarifier ces différences de point de vue.
Je partirai de quelques principes simples, en m’efforçant de tenir l’équilibre entre les perspectives continuiste et discontinuiste, avant de préciser la voie que j’ai plus ou moins empiriquement choisie dans le cadre de cette recherche. Il me semble d’abord qu’il n’est pas question de nier l’existence de relations dépendantielles et hiérarchiques, qui s’incarnent de façon privilégiée dans la phrase minimale (plutôt que simple), et qui constituent le fameux noyau dur de la syntaxe – ce que M. Charolles et B. Combettes appellent eux-mêmes « un palier structural crucial et original » (p. 113). Tout aussi indéniablement, on doit reconnaître qu’il existe des modes d’organisation que le discours (entendu comme succession de phrases) met particulièrement en valeur, et qui échappent au domaine de la rection dans la mesure où ils mettent en jeu l’interprétation sémantique et la dimension temporelle. Je prendrai l’exemple des phénomènes anaphoriques, qui illustrent de façon exemplaire cette double composante. De ce point de vue, on peut parler de seuil, de rupture, de disjonction 100 . Situons-nous maintenant dans une perspective continuiste. Il est impossible de nier que le syntacticien qui travaille dans le cadre de la phrase se trouve constamment confronté à des unités rebelles – constituants détachés, périphériques, prédications secondaires – qui refusent de rentrer dans le rang. La problématique du circonstant, par exemple, illustre assez bien le malaise et la perplexité que suscitent, chez le grammairien de type psychorigide, ces constructions plus ou moins en suspens. Pour sauver malgré tout le noyau dur et le principe hiérarchique, on peut toujours déclarer hors-la-loi ce type de constituants, et admettre, à la lisière de la phrase, une zone de non-contrôle, où la syntaxe perd en grande partie ses droits 101 . Mais on peut aussi penser que, loin de représenter une frange résiduelle, et somme toute négligeable, de l’organisation phrastique, ces constituants ne font que poser les problèmes avec plus d’acuité, en mettant en lumière des phénomènes linguistiques présents dès l’origine, c’est-à-dire au sein même du noyau propositionnel. C’est ainsi que j’interpréterai la position de M. Charolles et B. Combettes, à laquelle je souscris également.
Mais peut-on, sans contradiction, affirmer que la phrase est tout à la fois une unité structurale originale et le point de départ d’un continuum qui conduit au discours ? Il me semble que cela est légitime si l’on prend soin de distinguer soigneusement les niveaux d’analyse. Si la morphosyntaxe occupe une place centrale dans la description de la phrase, elle n’exclut pas pour autant la dimension sémantique et énonciative. Sémantiquement, on sait que les catégories et les fonctions grammaticales se doublent d’une interprétation en termes de notions (personne, chose, action, état, qualité, etc.) et de fonctions actancielles ou casuelles (agent, patient, destinataire, instrument, locatif, temporel, etc.), qui constituent ce que j’appellerai le niveau notionnel. Entre le niveau notionnel et le niveau morphosyntaxique s’établissent des affinités telles que, sans aller jusqu’à dire, comme M. Charolles et B. Combettes (p. 104), que « c’est le lexique qui gouverne la grammaire », on peut prédire certains emplois prototypiques (par exemple, un agent occupant la fonction sujet ou un instrument la fonction de circonstant) – mais sans que ces prédictions prennent jamais un caractère systématique (un patient pouvant être sujet, et un instrument complément essentiel, comme dans Il se sert d’un couteau) 102 . Si la morphosyntaxe a partie liée avec la sémantique, elle s’articule également avec la dimension énonciative. La phrase, en effet, n’est pas une structure inerte. En tant qu’unité de communication, elle s’inscrit dans une dynamique temporelle de type thème-rhème, qui relève de l’intention du locuteur et s’articule souvent sur le contexte. Si les constituants facultatifs ont vocation à occuper ces fonctions pragmatiques (par exemple, le circonstant détaché en tête de phrase, mis en position de thème), le noyau propositionnel n’est pas épargné, dans la mesure où n’importe quel constituant (ou groupe syntaxique) peut être appelé à occuper ce type de fonctions 103 . Je dirai donc que la phrase est faite de l’imbrication des trois niveaux, sémantique, morphosyntaxique et énonciatif.
C’est dans le cadre de cette approche globale de la phrase, qui vient d’être esquissée à grands traits, que ma démarche, si empirique soit-elle, peut trouver sa logique et son unité. Du mot à la phrase, du contexte étroit au contexte large, de la phrase au texte, on peut en effet observer une progression méthodique et continue. Je pars d’une approche distributionnelle, dans le respect de l’orthodoxie structuraliste, en essayant de tirer de la syntaxe ce qu’elle est en mesure de donner. Dans un premier temps, j’interroge le « noyau dur », c’est-à-dire, quand elles existent, les constructions spécifiques du mot (par exemple, en ce qui concerne air-apparence, le syntagme nominal l’air de quelqu’un ou la locution verbale avoir l’air). C’est ce que j’ai appelé précédemment l’approche externe au sens strict. Dans un second temps, j’observe les différentes formes d’intégration syntaxique du mot (caractérisation, constructions verbales, collocations, expressions etc.). Dans l’un et l’autre cas, la forme me conduit naturellement à l’interprétation notionnelle et lexicale. De ce contexte étroit, je pars à la recherche d’indices dans le contexte plus large de la proposition, à travers tel ou tel constituant (temps verbal, adverbe, préposition, etc.), puis j’en viens aux procédés d’enchaînement transpropositionnel ou transphrastique 104 . C’est dans la mesure où, non seulement la distribution d’une unité lexicale peut induire des variations sémantiques de cette unité, mais aussi et surtout dans la mesure où les structures syntaxiques sont susceptibles d’être elles-mêmes interprétées sémantiquement, que l’on peut prétendre passer d’une étape à l’autre, et finalement, du mot au texte, sans véritable solution de continuité. Je suis bien consciente que les problèmes que j’aborde ici demanderaient un développement et une maîtrise que je ne suis pas en mesure d’assumer dans le cadre de cette recherche, mais c’est déjà une satisfaction de penser que je peux donner à ma démarche d’ensemble quelques repères théoriques qui permettent, dans une certaine mesure, de valider sa cohérence et son unité. Je précise un dernier point. C’est que, quand j’évoque, à plusieurs reprises, le caractère plus ou moins informel de certaines investigations en contexte large ou dans l’au-delà de la proposition ou de la phrase, je n’entends évidemment pas par là dénier à ces dimensions leurs formes d’organisation propres, mais seulement signaler que, par la force des choses, je procéderai au cas par cas, retenant, selon les nécessités du moment, une anaphore dans tel contexte, tandis que dans tel autre, ce pourra être le temps d’un verbe, un adverbe ou une conjonction de coordination...
Je dois enfin un mot d’explication sur l’étape ultime de ce cheminement, qui me conduit à explorer un espace non directement accessible et aux contours flous, celui du savoir partagé sous-jacent aux énoncés, dont le rôle n’a d’ailleurs pas été négligé dans certaines théories de l’« au-delà de la phrase » précédemment évoquées.La recherche de ce savoir joue un rôle particulièrement important dans le genre de texte auquel nous avons à faire, une correspondance privée, si l’on admet que Mme de Sévigné n’écrivait pas pour la postérité 105 . À cela s’ajoute la distance dans le temps sur laquelle nous avons déjà longuement insisté. Le savoir partagé fait partie de ce qu’on appelle le contexte, ou « environnement non textuel », qui inclut une pluralité de paramètres (participants, lieu, moment, but, thème, genre de discours, différents types de savoir), et s’oppose au cotexte, qui est « l’environnement textuel immédiat » (D. Maingueneau, 1996, p. 22-23, 26) 106 . En ce qui nous concerne, la recherche d’« indications », d’« informations » 107 se fait en direction de deux sources. Ce peut être le texte lui-même, à plus ou moins grande distance de l’occurrence concernée, et, dans ce cas, une sorte de continuum s’établit avec le cotexte. Comme le dit C. Kerbrat-Orecchioni (1986, p. 16), « le cotexte est un objet indéfiniment extensible, qui finit par se confondre avec le contexte ». L’autre réserve d’informations se trouve... dans le remarquable apparat critique établi par R. Duchêne, dans le fourmillement de petites notes et les différents index, qui permettent au lecteur de s’immiscer dans le monde de Mme de Sévigné et de reconstituer les éléments de connaissance qui s’avèrent indispensables à la bonne compréhension du texte. Cette recherche est entièrement au service de l’étude lexicologique, et nous ne sommes pas entrée, bien sûr, dans tout ce qui relève de l’interaction, des relations interpersonnelles, des situations, des dispositions et des arrière-pensées, des intentions et des visées de communication, sauf, quand, exceptionnellement, la prise en compte de ces données pouvait avoir une incidence sur l’étude sémantique, ou pour souligner la difficulté qu’il peut y avoir, dans certains cas, à distinguer, dans le discours de Mme de Sévigné, une réaction personnelle d’une représentation à vocation collective, ou encore, dans certaines occasions, de manière plus ou moins anecdotique, dans le simple but de faire partager un plaisir de lecture. Reconnaissons toutefois que nous avons poussé assez loin la reconstitution des fragments de connaissance impliqués par nos citations...
De cette recherche, qui est avant tout un important travail de terrain, mené, dans l’intention de construire, en particulier en ce qui concerne le XVIIe siècle, des significations et des représentations qui n’ont pas véritablement été explorées jusqu’à présent, il ne faut pas attendre plus qu’elle ne peut donner. Il ne s’agit pas d’une recherche en syntaxe, dans la mesure où cette discipline sera mise au service de la sémantique, et non exploitée pour elle-même. Nous n’entrerons donc pas dans les considérations savantes et dans les démonstrations argumentées qu’elle exige, nous contentant de relever les faits qui nous intéressent, et, éventuellement, d’avancer certaines hypothèses relatives à leur interprétation. Il ne s’agit pas non plus d’un travail théorique, on l’a dit, ayant pour objet le phénomène de la polysémie, et mettant en débat les différentes approches qui ont cours sur ce sujet. L’ampleur de la tâche pratique qui nous attend ne permettra pas de véritable ouverture à ce niveau. Tout au plus pourrons-nous, à l’occasion, sur un point précis, faire référence à tel ou tel point de vue, sans chercher à restituer la visée d’ensemble qui l’inspire. Précisons encore qu’en matière de références, la concision sera de mise. Ce travail ayant vocation, en raison de la méthodologie adoptée, à mettre en œuvre des faits linguistiques multiples fort différents les uns des autres, nous ne pourrons faire un point complet sur chacun des points abordés. On s’efforcera donc de sélectionner, sur telle ou telle question, quelques travaux représentatifs, qui sont d’une utilité directe pour notre travail et qui ouvriront eux-mêmes toutes les voies souhaitables. Nous nous y réfèrerons sans exposer longuement ni discuter de manière approfondie leur contenu, toujours en raison de l’importance du travail de terrain qui ne laissera que peu de place à l’exploitation des données bibliographiques. Enfin, nous avons fait choix de rester autant que possible au plus près du langage courant, sans user d’une terminologie trop linguistique. Sans en faire une question de principe, il nous a semblé que les termes « scientifiques », qui ont toute leur place dans la réflexion théorique et méthodologique, n’apporteraient rien à notre approche empirique, et qu’il serait même difficile, dans les études minutieuses de corpus que nous entendons mener, de les employer avec toute la rigueur nécessaire. Peut-être aussi avons-nous craint que les archisémèmes, sèmes ou taxèmes 108 , qui nous sont si familiers, ne sonnent étrangement, appliqués à des occurrences du XVIIe siècle et ne me donnent l’air de quelque précieuse ridicule égarée dans le temps... Nous avons donc évité les termes faisant partie de tel ou tel système terminologique, peu connus en dehors des confréries linguistiques, mais nous avons gardé quelques mots incontournables, d’usage courant (présents dans tous les manuels), qui n’avaient pas vraiment d’équivalents dans le lexique commun (hyperonyme / hyponyme, champ générique, actanciel, par exemple). Nous avons essayé de compenser cet abandon par une expression aussi concise qu’il nous a été possible. Précisons que nous sommes souvent passée du mot (air) à ce qu’il dénote (l’air), ou encore, pour reprendre la terminologie de J. Rey-Debove (1971, p. 24), du signe-nommant à la chose-nommée, dans la mesure où l’expression de la chose vient naturellement avec celle du mot et où cela permet de varier la formulation... en nous efforçant toutefois de le faire de façon consciente et justifiée. Il convient enfin d’ajouter que, si ce travail porte sur des textes littéraires, cela n’implique pas de notre part une connaissance de spécialiste en la matière, et que, s’il accorde une large part aux représentations qui s’attachent aux mots, il ne prétend pas non plus être une recherche de pointe dans le domaine de l’histoire des idées ! Et bien que le mot air puisse être considéré comme un mot-témoin – au sens où l’entend G. Matoré (1953) – dans la mesure où il exprime et cristallise l’idéal de l’honnête homme et du galant homme (mots-clefs de l’époque), nous ne prétendons pas nous inscrire dans ce courant qui se fonde, au plan méthodologique, sur l’étude de « groupes de mots considérés statiquement du point de vue notionnel », et considère, au plan théorique, la lexicologie comme « une discipline sociologique » (p. 13).
La structuration d’ensemble de notre travail est, quant à elle, extrêmement simple. Il y a deux champs de recherche, le XVIIe et le XXe siècle, qui constituent les deux grandes parties du travail. À l’intérieur de chacune d’elles, on étudie deux mots qui se correspondent d’un siècle à l’autre, air-fluide gazeux et air-apparence pour le XXe siècle, air-élément et air-manière d’être pour le XVIIe siècle. Nous allons du (supposé) connu au moins connu, donc du XXe au XVIIe siècle, dans le souci de clarifier notre compétence moderne avant d’aller à la découverte de mots qui ne sont plus les nôtres. Chaque étude polysémique est très développée, et a, pour ainsi dire, son unité propre. Mais l’intérêt de ce regroupement réside évidemment dans le projet d’ensemble qui les fédère. Dans le cadre de l’étude sur le XXe siècle, les mots air-fluide gazeux et air-apparence sont posés distinctement, tandis que l’hypothèse d’une relation entre air-élément et air-manière d’être est retenue pour le XVIIe siècle. Dans les titres respectifs, j’oppose donc les mots air au XXe siècle au (seul) mot air du XVIIe siècle. Une importante récapitulation générale permet de reprendre la problématique d’ensemble, en comparant les polysémies respectives des mots air-apparence et air-manière d’être, et en situant les deux mots air-fluide gazeux et air-apparence l’un par rapport à l’autre, à la lumière de ce qu’apporte la mise en relation d’air-élément et air-manière d’être au XVIIe siècle.