A. Le panorama urbain
Le premier intérêt de la représentation panoramique de la ville est en effet de rendre une cohérence à l’ensemble architectural pourtant de plus en plus varié que nous avons décrit plus haut. Si l’espace urbain se spécialise et donc perd de son homogénéité, la vision panoramique permet d’embrasser d’un seul regard l’ensemble de la ville et ainsi, en quelque sorte, d’en gommer les variations, les incohérences, ou tout simplement de lui donner une forme compréhensible. Dans son histoire des représentations de la ville américaine, Anselin Strauss rappelle cette nécessité inhérente à l’espace urbain, et qui se fait de plus en plus pressante au fur et à mesure que le ville s’étend :
‘« Not only does the city-dweller develop a sentiment of place gradually, but it is extremely difficult for him even to visualize the physical organization of the city and even more, to make sense of its cross-current activity. Apparently an invariable characteristic of city life is that certain stylized and symbolic means must be resorted to in order to ‘see’ the city. The most common recourse in getting a spatial image of the city is to look at an aerial photograph in which the whole city - or a considerable portion of it - is seen from a great height. Such a view seems to encompass the city, psychologically as well as physically. »320 ’De cette analyse, sans doute serait-il prudent de retirer, du moins pour les contemporains, les termes « stylisé » et « symbolique ». Si l’historien est fondé à analyser de la sorte le fonctionnement de ces images, il convient de souligner que le pouvoir mimétique de la photographie, ainsi que son statut bien établi d’instrument scientifique, confèrent aux vues proposées au public le pouvoir de « prouver », en quelque sorte, la rationalité du monde urbain. Comme le souligne l’historien de la photographie Peter B. Hales, la réputation d’ « honnêteté visuelle » de l’appareil photographique offre une garantie rassurante au citadin inquiet de l’évolution de son environnement :
‘« If these views succeeded in revealing order to contemporary viewers, then it was reasonable for viewers to assume that order did exist beneath the confusing order of the city. Thus the camera became less a mechanism of description than one of analysis. »321 ’La distinction proposée ici par Hales, entre description et analyse, n’est pas sans importance, même s’il nous semble que le mot de « synthèse » serait plus approprié pour le second terme. L’interprétation de Hales s’appuie sur sa comparaison des vues urbaines composées d’une image unique, utilisées dans toutes les publications du début du 20e siècle, avec les panoramas composés de plusieurs photographies juxtaposées, du type de ceux réalisés par Muybridge à San Francisco en 1878.322 Peter Hales vante à juste titre la richesse de détails de ces derniers, la manière dont chaque habitant de San Francisco pouvait, s’il le voulait, repérer sa rue, sa maison, la fenêtre de sa chambre. De même, il insiste sur le fait que par leur gigantisme, ces panoramas composés ne pouvaient être embrassés d’un seul regard, qu’ils demandaient une sorte de déambulation, ramenant en quelque sorte le spectateur au rôle du piéton de la première moitié du 19e siècle, parcourant la ville américaine à une époque où celle-ci pouvait encore se traverser à pied.
On se permettra de surenchérir, et d’ajouter deux éléments de réflexion. D’une part, sur ces panoramas composés, ce n’est pas seulement le point de vue du spectateur qui est mobile, mais aussi celui du photographe. En effet, Muybridge a fait tourner son appareil de quelques degrés - même si c’est autour d’un point fixe - entre chacune des 11 prises de vue qui forment son panorama de San Francisco. D’autre part, la représentation ainsi constituée est composée à partir du coeur de la ville, le photographe ayant choisi de se placer sur l’une des nombreuses collines qui constituent sa géographie accidentée. Vision « descriptive », donc, comme le souligne Peter Hales, mais aussi regard interne à la ville (et non « point de vue » extérieur), et surtout mise en oeuvre d’une représentation qui ne peut se résumer à un seul cadrage, à une « plaque » unique. Chacun des onze panneaux de Muybridge se continue sur le suivant, mais appelle aussi le huitième, ou le onzième, au loin, vers lequel il faut faire l’effort d’aller, ou du moins de porter le regard. Or cette contrainte imposée au spectateur naît au moment de la « prise de vue », nécessairement plurielle. Onze plaques, ce sont autant d’efforts délibérés, autant de visées. Le cadre photographique bute ici sur ses propres limites, même si tout l’effort de Muybridge cherche précisément à les surmonter. L’oeil qui cherche à « visualiser » la ville ne parvient pas à l’englober. Il ne la réduit donc pas à une simple « vue », il ne la « domine » qu’au prix du mouvement, et du déplacement, qui trouvent ensuite leur écho dans le va-et-vient continuel du spectateur, d’une image à l’autre.
Chez Muybridge, la photographie est donc certes déjà un instrument de maîtrise, mais celle-ci passe toujours par l’exploit, la prouesse technique et l’exploration. Les onze vues sont les onze étapes de la conquête visuelle. Le gigantisme de l’oeuvre, s’il célèbre d’abord le photographe-conquérant, est aussi en soi un hommage à la richesse de la réalité urbaine, alors pourtant que les contraintes techniques (temps de pose notamment) semblent vider la ville de ses habitants. Sur de telles images, San Francisco possède encore une « profondeur de champ » qui ne la réduit pas à un cliché en deux dimensions.
Une vingtaine d’années plus tard, Pittsburgh n’apparaît jamais sous des formes aussi complexes dans les principales publications locales ou nationales. La conquête est chose entendue ; la ville elle-même en est le symbole. Pittsburgh est donc bien installée dans les conventions de ce que Hales appelle « Grand Style urban photography », et dont le panorama « simple », réalisé en une seule prise de vue, est la figure obligée. Dans le cas de Pittsburgh, cette pratique est d’autant plus prisée qu’elle est facilitée par le site où s’est développée la ville. Au nord et au sud, les rives de l’Allegheny et de la Monongahela sont extrêmement escarpées, et offrent un point de vue « imprenable » sur le centre et certaines des usines installées au bord des voies navigables. Notons toutefois que ces promontoires sont situés en bordure de la ville, et non en son centre, comme c’est le cas à San Francisco. La vision qu’ils offrent est donc extérieure, et immédiatement synthétique, même si elle reste en tout point éminemment spectaculaire. Il n’en reste pas moins que le paysage qu’elle offre se réduit à une silhouette, un « cliché », avec tout ce que ce terme suggère de schématisme.
Il n’est peut-être pas inutile de signaler au passage un détail significatif : le « tableau » extraordinaire suggéré par le texte déjà cité de Charles Henry White dans Harper’s Monthly, bien que contemporain du Survey, n’est pas constitué de photographies, mais de gravures réalisées par l’auteur lui-même. Chacune de ces illustrations est accompagnée d’une légende qui est en réalité un titre, évocateur de la fascination subjuguée de White pour le décor qui s’offre à lui.323 On est en droit de penser que l’image photographique, telle qu’elle apparaît alors dans la majorité des publications, ne convient pas aux intentions de White. En effet, ce n’est pas seulement le point du vue qui fait le sublime, mais aussi la mise en valeur des effets les plus spectaculaires de l’industrie : le bruit presque infernal, relevé dans le texte, mais aussi la fumée et la lumière, omniprésents aussi bien dans la description que dans les illustrations de White et de Stella, ainsi que sur l’image du Survey intitulée Pittsburgh : Night.324 Or, répétons-le, ces effets restent minoritaires dans la production photographiques la plus courante.
Le cliché panoramique, au contraire, s’il suggère la majesté et la puissance, exprime en même temps le contrôle, et par extension le progrès. On trouve des vues aux caractéristiques relativement uniformes, mettant en général l’accent sur l’alignement des bâtiments le long de l’une des deux rivières. Sans doute ne peut-on en trouver meilleur exemple que celui du Pittsburgh Post, daté du 31 octobre 1910, dont la une est barrée sur toute sa largeur d’une photographie sans doute recadrée (avec l’élimination probable d’une grande partie de l’image occupée par le ciel), ce qui a pour effet d’accentuer sa dimension horizontale et le développement de la ville parallèlement au fleuve. Au-dessus de cette « vue du centre-ville prise un jour ensoleillé depuis le Mont Washington » (ainsi que le précise la légende), le principal titre de cette première page proclame en grosses lettres :
‘« Pittsburgh’s skyline a sign of industrial power »’Une large colonne centrale, sous le cliché, présente une série de ces « statistiques qui prouvent la grandeur (greatness) de Pittsburgh ». Les chiffres, une fois de plus, doivent donner la mesure de l’exceptionnelle puissance du plus grand centre sidérurgique du monde. Mais ils ne sont ici qu’un complément au panorama, qui met en valeur la « silhouette » de la ville et résume en une seule image sa majesté. Le skyline, ainsi consacré par la photographie, propose une vision d’ordre et d’harmonie qui vient rééquilibrer l’impression monstrueuse parfois suggérée par les visions nocturnes de l’activité industrielle. Saisi frontalement, l’alignement des nouveaux gratte-ciel offre l’image d’un futur radieux. Comme le rapporte David Nye, certains observateurs avisés percevaient dès 1909 cette capacité du skyline à transcender les disparités et les incohérences de la grande ville moderne, fut-elle, comme New York, la plus chaotique de toutes :
‘« The mayor [admitted] that ’there are comparatively few buildings in New York which, when taken by themselves, are not architecturally incorrect ; there are only a few buildings that even by a stretch of the imagination can of themselves be called beautiful.’ Yet, despite the individual inadequacies, he declared the whole to be much more than the sum of its parts : ’Take the city altogether, the general effect of the city as a whole [and it makes] of lower Manhattan, to the eye at least, a city that is set on a hill, and New York does have a beauty of her own.’ »325 ’Le tout est bien supérieur à la somme des parties : il suffit donc de produire des images qui mettent en valeur cet ensemble vu de loin, et la cité retrouvera les reflets de l’utopie originelle, la ville sur la colline rêvée par les Puritains.
Ainsi s’impose le panorama, à New York mais aussi à Pittsburgh, comme en témoigne la photographie qui ouvre le volume du Survey intitulé The Pittsburgh District (Figure 2). On notera que cette image a été obtenue auprès de la Detroit Publishing Co., l’une des grandes sociétés de distribution commerciale de stéréographies au 19e siècle, puis de cartes postales au 20e. Nul n’est besoin pour les auteurs du Survey de chercher à réaliser eux-mêmes le type de vue le plus courant, sans doute, des divers modèles de représentation de la ville. Une image presque identique, mettant elle aussi en valeur la jonction de la Monongahela et de l’Allegheny donnant naissance à l’Ohio à l’extrémité ouest de la ville, est la première photographie de Pittsburgh (même si elle n’est pas la première illustration) dans un long article paru en 1905 dans l’American Monthly Review of Reviews.326
Citons pour finir un dernier exemple de ce type de vue : on le trouvera à nouveau dans le numéro de Charities daté du 2 janvier 1909, à la suite du poème de Richard Realf (Hymn of Pittsburgh) et de l’illustration de Joseph Stella, commentés plus haut : ce panorama très classique dans sa forme a été réalisé, comme celui de
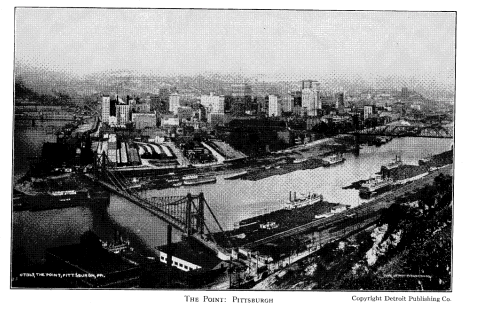
Pittsburgh District, par une compagnie commerciale, la Chautauqua Photographic Co.327 Son utilisation, en contrepoint des deux documents qui le précédent, et dont nous avons tenté de montrer ce qu’il doivent au « sublime industriel », offre un raccourci saisissant de l’évolution iconographique de la vision urbano-industrielle.
Pour décrire ce glissement des représentations, qui ne peut évidemment être compris comme linéaire, on pourrait avancer que le poème de Realf et l’illustration de Stella relèvent en quelque sorte de la légende sidérurgique. Vulcain, appelé en renfort par l’écrivain, participe à l’élaboration d’une mythologie fondatrice, construite sur l’affrontement titanesque de la technologie et de la matière, et indirectement de l’homme et de la nature. William L. Scaife, dans l’article déjà cité de l’American Review of Reviews, avait par exemple choisi de comparer les usines de Pittsburgh à la pyramide de Cheops, à ceci près que le progrès technique libère aujourd’hui l’homme de son rôle antique de « bête de somme ». Le 20e siècle est ainsi présenté comme le temps de l’efficacité et du progrès. La référence mythique n’était rappelée pour pouvoir être aussitôt dépassée par la légende industrielle :
‘« Pittsburgh’s industries [...] transform yearly into the bones and sinews of civilization the weight of a dozen Great Pyramids. »328 ’Le panorama photographique publié à la suite immédiate de ces représentations mythologisantes, aussi bien dans Charities que dans la Review of Reviews, offre précisément le tableau apaisé et rassurant des lendemains de cette lutte des hommes contre la matière. De ce combat fertile est née Pittsburgh, fille de Vulcain et d’Industrie, « monstre » de technologie et modèle d’une civilisation nouvelle. Que la photographie remplace alors la peinture semble presque pléonastique : la grandeur industrielle est ce « fait lyrique utile », pour lequel l’image argentique, qui tient elle même du miracle technique, offre une adéquation parfaite. Il s’agit bien, toujours, de donner le sens de la puissance industrielle, mais aussi de souligner que le monstre est dompté, ou du moins apaisé. L’image photographique permet de concilier, comme presque toujours, la maîtrise et le fantasme. Même les réformateurs de Charities, puis du Survey, ne peuvent échapper à cette donnée constante de la représentation urbaine au tournant du siècle, point de départ visuel incontournable de toute approche de la grande métropole américaine.