I.2. La mort des riches : une compensation pour les plus démunis.
Dans son poème André Spire respecte la hiérarchie des anciennes danses puisque la mort convoque les personnes qui occupent un rang élevé dans la société mais l’égalité devant la mort se transforme rapidement en inégalité puisque les riches sont les premiers et les seuls à être happés par la grande faucheuse. « Une foule regarde défiler une foule. Les vivants sont les pauvres : ouvreurs de portières, mendiants, camelots, femmes de chambre, distributeurs de prospectus. Les morts sont les riches, les « riches piteux », la « douairière » et le « monseigneur », des généraux à bicorne, des ambassadeurs à plumes, le « premier président », des femmes et des jeunes filles du monde dont les doigts soudain décharnés laissent tomber les bagues sur le trottoir. 751» Toutefois, tous savent que la mort les attend. Après avoir feint de disparaître pour pouvoir, avec ironie, laisser les hommes montrer leur vraie nature, la mort lance à l’ensemble de la foule : « Vous êtes tous à moi ! 752» Elle emmène alors aussi bien le directeur que le chef de commis, le moine, le second syndicat, la stoppeuse... tous font désormais partie du cortège. Mais, l’espace de quelques heures, les plus démunis auront connu le goût amer de la vengeance.
En effet, les plus pauvres se réjouissent des danses qui malmènent ceux qui se croient invulnérables et toute la ville accourt pour voir la Mort maltraiter les grands de ce monde. « La fange de la population était montée à la surface, tant la curiosité avait troublé jusqu’au fond Paris immobile et endormi depuis deux ans. 753» Les plus démunis qui entrent dans la danse semblent se délecter de ce dernier jeu qui leur permet de côtoyer éternellement ceux qui ont ignoré leur misère terrestre.
Et chacun applaudit lorsque Macaber caresse la moelle épinière du saint pontife avec sa pelle, chacun se plaît à voir le symbole de la dignité qui « débarrassé d’une fausse honte » s’agenouille devant la Mort pour obtenir un sursis, qui essaie ensuite en vain les menaces d’excommunication puis tente de fuir. « Le peuple riait de tous ses poumons, et applaudissait la pantomime autant que la musique 755», la danse lui offre pendant quelques instants l’illusion qu’il peut se comparer aux plus hauts dignitaires du royaume.
La foule des petites gens, lorsqu’elle voit la mort s’emparer des notables de la ville, se contente tout d’abord de décrire la scène : « leurs robes se fanent », « leurs chichis dégringolent », « ces femmes étaient belles à parer. 756» Puis, tous se souviennent des humiliations que leur ont fait subir les femmes de la haute société :
renchérit une stoppeuse. La danse se transforme rapidement en une sorte d’exutoire : le cocher ironise,
Et le croque-mort s’amuse d’un jeu de mot pour répondre à l’ironie du sergot :
Les danses « contemporaines », tout comme leurs modèles, ont exploité le thème de l’universalité de la mort qui permet aux plus pauvres d’exprimer leurs sarcasmes. Dans la danse de Guyot Marchant, la mort s’adresse à chaque personnage en tenant compte des actions qu’il a accomplies pendant sa vie terrestre, elle juge les hommes et ses paroles préfigurent le Jugement Dernier. Elle ironise sur l’air surpris du cardinal, lui rappelle qu’il a su tirer profit des biens mondains et utilise les impératifs pour le pousser dans sa ronde :
Utilisant le même procédé, la mort d’Auguste Hoyau arrête , sans aucun respect, l’avocat dans sa plaidoirie :
Le sergent, fier de sa profession, se croit au dessus de toutes les lois et déclare avec orgueil :
Mais la mort le rappelle aussitôt à l’ordre :
Elle semonce également le puissant souverain :
La mort dénonce enfin les agissements du hallebardier qui a volé les faibles en toute impunité :
En revanche, la mort se montre compréhensive et douce avec le laboureur :
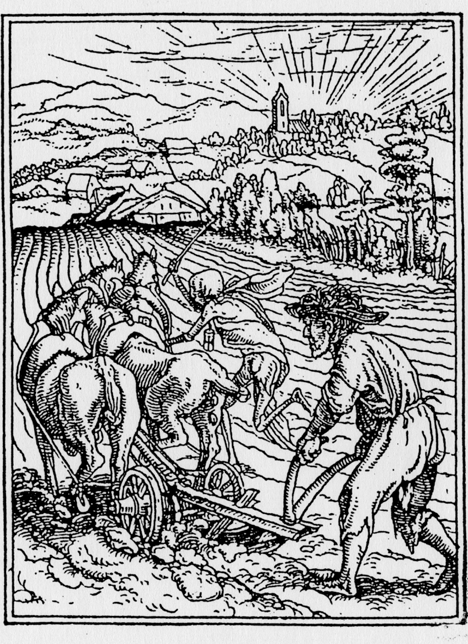
Dans la danse de Martial d’Auvergne, la mort montre sa sympathie pour les femmes du peuple, elle s’adresse avec douceur à la « plaisant bergiere 767» et dit à la marchande :
Conservant la même attitude à travers les siècles, la mort arrête d’une parole amicale le paysan dans son champ, « Assez peiné, bon moissonneur 769» ; compatit au « malheur 770» de la jeune fille ; encourage l’aïeule qui se juge repoussante, « Ma fête est la fête des rides 771» ; relève la nonne dont les « genoux s’usent sur la terre 772» et prend pitié de l’ouvrier qui, peinant sous le poids de l’âge, porte encore sable et outils :
Depuis le moyen âge les vivants adressent toujours les mêmes paroles à la mort, ils sont attristés de devoir quitter la vie, ses plaisirs et ses souffrances, et les plus démunis trouvent dans ce moment une amère satisfaction : ils ont l’occasion de porter une dernière pique à l’encontre de ceux qu’ils auraient peut-être aimé égaler et qui ne se sont pas souciés de leurs misères. « Il est indubitable que la danse macabre exprime le mécontentement des humbles, leurs critiques à l’égard de la société, des abus et des privilèges. Il y souffle un vent de justice qui porte les petits à se réjouir du malheur des grands et à trouver dans la mort une dernière et amère revanche. Les morts entraînent les princes de ce monde avec des railleries cruelles et parfois même de grossières insultes. Des sentiments nouveaux apparaissent, que le littérature antérieure n’avait pas connus : l’ironie cruelle, l’atroce gaieté, le sarcasme, la joie féroce. 774»