II.3.2. La luxure
Pour certains membres de l’Eglise, il est incontestable que la danse engendre la luxure. « Johannes Chrysostomus affirme que « là où il y a la danse se trouve le diable ». Isidore de Séville observe que « la musique allume le désir charnel. 1418» Grâce au son de ses instruments, le diable peut inspirer la danse en groupes mais il peut aussi faire danser une très belle femme qui, exerçant l’art de la séduction, enflamme de passion une assistance masculine. « De nombreuses images du moyen âge, sculptées sur des chapiteaux, peintes dans des manuscrits, montrent cette scène du ménestrel jouant souvent de la vielle à archet, et devant lui la jongleresse se courbant en arrière dans un délire de volupté. Souvent, l’instrumentiste est un démon, une créature grotesque de l’autre monde, ou bien un animal - âne, chèvre, chien, sanglier. 1419» De tels animaux représentent traditionnellement le diable et le péché. L’histoire biblique de Salomé est une version très connue de ce scénario, envoûté par la danse érotique de la jeune fille, Hérode s’engagea par serment à lui donner ce qu’elle réclamerait. « A Venise, sur les mosaïques de la Basilique Saint-Marc, la fille d’Hérodiade exécute une danse assez macabre. Elle porte sur la tête, tout en dansant, le chef de jean Baptiste posée sur un plat. » Des musiciens sont parfois présents pour « rappeler que c’est à cause de la danse de Salomé que l’on a exécuté Jean-Baptiste 1420». Dans Le Festin d’Hérode, un personnage dont on ne peut nier que ce soit le diable, continue à jouer du violon tout en regardant avec complaisance la tête de Jean-Baptiste posée sur un plateau d’argent. Cet épisode montre bien que de la luxure à la diablerie il n’existe qu’un pas que les prédicateurs médiévaux ont allègrement franchi.
Dans les danses « contemporaines », en entendant le mot « amour », ceux qui sont morts à cause de lui se lèvent de leur tombe et se mettent à danser avec une frénésie diabolique, ce qui fait dire au ménétrier que les hommes sont « toujours fous ! »
« L’épouse en dentelles », en entendant les jeunes filles chanter le « mois de Mai joli » demande à son « bel époux » de lui laisser le temps d’aimer :
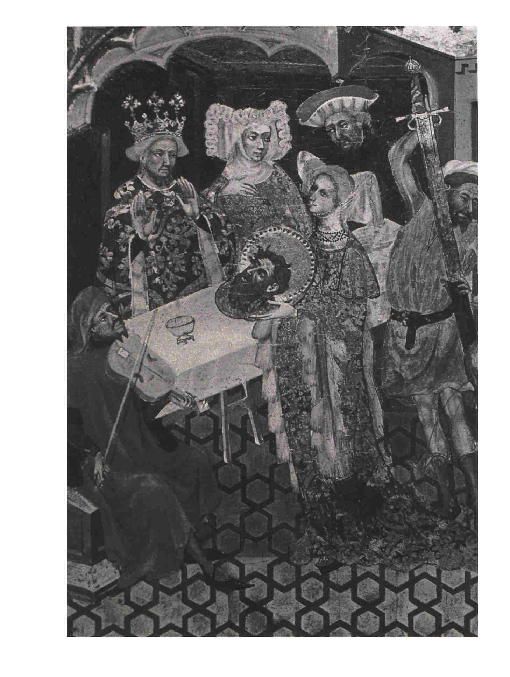
Cendrillon attend, « dolente », son « doux prince Charmant » :
Mais Chérubin est un « ange bel infernalement 1424», sous l’impulsion du diable, l’Amour rêvé devient obsession de la chair ; le couple épris de pureté subit alors une étrange transformation,
Mais elle l’enlaçant, rougissante, soupire :
Lui s’effare, mais sent toute sa chair bondir :
Et Cendrillon confie à Chérubin la nature du feu qui la consume :
Et très vite « les femmes sur leur automne / Sont en rut », et « font la chasse au jeune homme / Tant qu’il est frais et dodu 1428». Chérubin qui désire séduire Elvire s’écrie « Soyons pervers et grâce au Ciel séduisons-là 1429», Nicolas repousse Célimène en proférant des obscénités, « Un trou c’est toujours un trou 1430» ... La deuxième partie de la danse macabre de Fagus est une immense danse de l’amour, un amour qui pervertit l’humanité, enflammant les femmes et mettant des mots obscènes dans la bouche des hommes, la danse devient le lieu où s’expriment tous les tabous :
Et tous nos appétits, désir, transe, plaisir :
La quatrième partie de la danse développe un hymne au Dieu Phallus qui n’est autre que Lucifer :
L’ « âme tourmentée de tous les mauvais morts, / tournent sans cesse autour de cet immense corps » qui déverse « du liquide à torrents » « Sur l’océan hagard des spectres délirants. » Tous, hommes et femmes, se « ruent 1432» autour de Lucifer et les descriptions des sabbats que l’on trouve dans les procès de sorcellerie font pâle figure en comparaison de l’orgie sexuelle qui se déroule sous les yeux du narrateur :
Dans sa danse, Fagus évoque un grand nombre de couples historiques, mythiques ou littéraires qui sont connus pour l’amour qui les lia, il met à jour dans leur relation tout ce qui appartient au non-dit, au tabou, c’est ce que nous avons par exemple montré pour Cendrillon ou Philémon ; puis, très vite, sous l’influence de Don Juan, la danse se transforme en une gigantesque orgie. « La Danse macabre, c’est la ronde de nos passions autour de Lucifer 1434»,
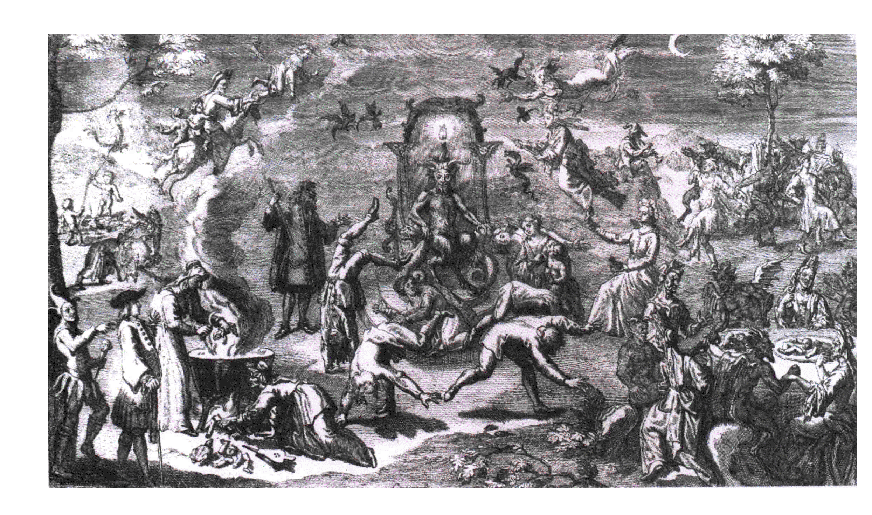
la « fresque atrocement piteuse de gens aveuglés par le vice, cabriolant dans le rut, la débauche qu’ils appellent l’Amour, danse des aveugles... danse macabre ! 1435»
L’inspiration de Verhaeren est tout à fait semblable, dans le « sabbat » mené par le ménétrier, le « rut gagne, de proche en proche »,
Rimbaud insiste dans le « Bal des pendus » sur l’aspect obscène de l’acte charnel. « Et les pantins choqués entrelacent leurs bras grêles », « les poitrines à jour » « Se heurtent longuement dans un hideux amour » ; l’obscénité ne naît plus du contact des chairs mais de celui des os noircis par la terre, rongés par les vers. Le caractère abject et repoussant de ces contacts physiques provient précisément de l’impuissance dérisoire des squelettes,
« Presque tous ont quitté la chemise de peau :
Flaubert, dans d’autres parties de sa danse, inverse le processus avec cynisme : les morts peuvent s’adonner à tous les plaisirs de la chair, ils seront enfin purs puisqu’ils n’ont plus de bouche pour blasphémer, de dents pour mordre, de corps pour s’enlacer.
‘« Choisissez vos femmes, que leur tête soit blanche et leurs longues dents polies ; leur peau est froide, n’est-ce pas, bien froide ? Et leurs yeux vous regardent ? Faites-les sauter fort, que la valse les emporte ! Que de voluptés ! Elles sont nues et vous montrent leurs coeurs, la place où était leur âme, où tant de fois ont battu de douces choses ; elles sont belles, leur taille fine, leurs ongles longs, polis, blanchis ; leurs cheveux flottent sur leurs épaules. Dansez, les morts ! Embrassez-vous, vos bouches ne mordent plus ; elles sont pures maintenant, l’orgie au vin rouge, la luxure, les mensonges, le blasphème n’y sont plus ; le ver a passé là et pris les lèvres .1440»’ ‘« La littérature du XIXe siècle, quand elle renverse l’image traditionnelle des épousailles de l’homme avec la mort en imaginant la femme livrée au Ver, glorifie en celui-ci un Phallus tout-puissant dont la rivalité met les vivants dans la situation des maris trompés : dans L’épopée du Ver de Hugo (1862), le ver veut bien rendre à l’amant, qui la lui dispute, la maîtresse défunte, mais il l’a déjà possédée en pénétrant dans son flanc1441. Théophile Gautier avait longuement exploité, dans La Comédie de la Mort (1838), ces images phalliques 1442» :’