2.1.2 Une vision ’idyllique’ de la télévision
La télévision étant à l’évidence le média dominant, il nous semble indispensable, au point où nous en sommes, d’évoquer les différentes analyses globales de la télévision. Est-elle, comme le soutient Dominique Wolton, un instrument de la ’culture de masse’, un facteur indispensable du ’lien social’et de ’l’ouverture sur le monde’ 216, ou bien, comme l’affirment certains chercheurs, ne contribue-t-elle pas à ’abrutir’, à ’décerveler’, n’est-elle pas au fond, ’une machine à empêcher de penser’ 217 ? Sans vouloir à tout prix tenter une synthèse ou un compromis entre ces deux points de vue extrêmes nous essaierons pour notre part, après avoir analysé ces deux thèses, de changer quelque peu de perspective afin de prendre en compte la complexité ontologique de la télévision et la nature fondamentalement équivoque des rapports sociaux qu’elle génère.
Le premier point de vue - assez largement positif - sur le rôle joué par la télévision, nous semble parfaitement bien développé par Dominique Wolton. Depuis une vingtaine d’années en effet, celui-ci, soit seul, soit en collaboration avec d’autres chercheurs, notamment Jean-Louis Missika, s’est fait le défenseur du ’grand public’ 218 , de la ’culture de masse’ et soutient avec une remarquable constance que la télévision constitue un outil essentiel de la construction du ’lien social’ et permet de ’mieux comprendre le monde’ 219.
Amalgamant la communication de masse et le suffrage universel, Dominique Wolton écrit notamment: ’ ‘C’est le même individu qui est au fondement du système démocratique, avec le suffrage universel, et qui est engagé dans la communication. Il faut donc choisir. Si le citoyen est assez intelligent pour distinguer les messages politiques et l’origine de la légitimité, il l’est également pour distinguer les messages de la communication ! La communication est ainsi inséparable du suffrage universel’ ’ 220. Même si Dominique Wolton introduit une distinction subtile - et quelque peu idéaliste - entre ’les publics’ réels et le ’grand public’ qui serait ‘’un concept, une représentation, un choix, une orientation, une valeur, une volonté (...) la traduction dans le domaine de la communication, du concept de suffrage universel dans celui de la politique’ ’ 221, nous considérons son ’éloge du grand public’ comme quelque peu spécieux, dans la mesure même où il le confond avec le processus démocratique, considéré dans sa dimension électorale. Il est d’ailleurs assez piquant d’observer que son raisonnement rejoint - sans doute malgré lui - celui des partisans de l’audimat. En effet, si pour Dominique Wolton, ’ ‘la question du grand public ne se résout pas à celle de l’audience’ ’ 222 , s’il note fort justement que l’audience traduit ’principalement la réaction à l’offre de programmes, et non pas la demande du public’ 223 , il n’en reste pas moins que le fait de concevoir le ’grand public’ comme ’l’équivalent du suffrage universel’ 224 nous semble assez peu convaincant et même passablement contreproductif. D’une part, c’est se placer sur un terrain qui n’a pas grand chose à voir avec la culture, alors même que l’argumentation en question se situe dans le chapitre 5 intitulé ’La culture et la télévision’. On ne peut évidemment que souhaiter que la culture soit accessible au plus grand nombre, mais s’il s’agit bien, comme le disait Antoine Vitez d’être ’élitaire pour tous’, il ne saurait à aucun moment être question de renverser les termes et de considérer le verdict du ’public’ comme un critère susceptible de légitimer une création ou une programmation. Or, dès l’instant où l’on fait intervenir - fût-ce par le biais de cette espèce de public idéal, imaginaire, que recouvre le concept de ’grand public’ - une relation directe entre la culture et le suffrage universel, on court le risque de se laisser entraîner, malgré qu’on en ait, dans une logique quelque peu démagogique où la démocratie conduit finalement à justifier la recherche de l’audience maximale.
D’autre part, il nous semble très contestable de considérer que ’ ‘la communication est inséparable du suffrage universel’ ’ comme si c’était les mêmes mécanismes qui étaient à l’oeuvre. En effet, si le suffrage universel apparaît bien, dans le domaine politique - et particulièrement dans le domaine de la représentation - comme une valeur universelle, on peut fort bien penser que la loi du plus grand nombre n’est pas nécessairement un critère de vérité: ce n’est pas parce qu’une majorité de Français est favorable à la peine de mort, par exemple, que celle-ci serait une bonne chose. D’ailleurs, même dans le domaine politique, si le suffrage est universel, il n’est pas permanent et si le peuple élit ses représentants, ce n’est pas lui qui prend les décisions, sauf dans les rares occasions où il est procédé à un référendum. Et il est extrêmement fréquent que des décisions prises soit par le gouvernement, soit par le parlement, ne soient pas approuvées par la majorité des citoyens. C’est d’ailleurs l’honneur des gouvernants que de savoir prendre, si l’intérêt général est en jeu, des mesures impopulaires. Il reste que, dans le champ du politique, qui, comme l’indique Bernard Lamizet, ne peut être, en principe, que dans le champ de ’l’indistinction’ 225 , c’est-à-dire le lieu où ’chacun compte pour un’,sans distinction de sexe, de race, de religion, de famille, d’appartenance sociale ou politique, de capital culturel, économique ou symbolique, le pouvoir procède, ontologiquement, du peuple, c’est-à-dire du suffrage universel, même si, comme le disait Winston Churchill, avec humour, à propos de la démocratie: ’ ‘C’est le pire des systèmes de gouvernement mais il n’y en a pas d’autre’ ’.
La communication de masse, notamment audiovisuelle, en revanche, relève d’une problématique toute différente. Même s’il est sans doute excessif de la comparer à un processus plébiscitaire, même si Habermas exprime un point de vue caricatural lorsqu’il affirme que ‘’les nouveaux médias captivent le public des auditeurs et des spectateurs mais en leur retirant par la même occasion toute distance émancipatoire, c’est-à-dire la possibilité de prendre la parole et de contredire’ ’ 226 , il nous semble tout à fait certain, comme nous l’avons déjà indiqué, que Bernard Miège voit juste lorsqu’il indique: ’ ‘La communication est asymétrique et inégalitaire, mais elle ne saurait être unilatérale’ ’ 227 . En effet, si la communication de masse ne met pas en oeuvre les mêmes mécanismes que la propagande, si elle s’attache à construire une situation où le public participe au processus et co-construit le message, il n’es reste pas moins qu’elle n’a pas grand chose à voir avec la démocratie, bien qu’elle fasse mine d’en procéder.
Il est évidemment essentiel de bien prendre en compte le fait que la communication, à l’inverse de la propagande, ne constitue pas un dispositif unilatéral dans lequel le récepteur serait lié à l’émetteur par une relation de subordination totalement passive; c’est d’ailleurs, selon nous, précisément de cela que la communication tire une grande partie de son efficacité. Nous aurons naturellement à examiner plus avant le fonctionnement de ce mécanisme dans une étape ultérieure de la présente thèse, mais nous pouvons d’ores et déjà avancer l’idée - qui reste à démontrer - que si la propagande vise explicitement à ’faire croire’ ou à ’faire faire’, la communication a plutôt pour objet de construire de la ’connivence’, de l’empathie, un certain cadre émotionnel et /ou idéologique à partir duquel le récepteur élabore lui-même - en s’appuyant sur ses propres affects, sur son habitus, sur ses expériences sensibles, sur son capital culturel et intellectuel - le sens précis du message, et, partant, ses comportements économiques, sociaux, politiques, etc.
Ceci étant posé, il nous semble tout aussi nécessaire d’insister sur la dimension ’asymétrique et inégalitaire’ de la communication de masse qu’évoque Bernard Miège. Il serait en effet naïf - ou particulièrement hypocrite - de prétendre que le public, le récepteur, intervient ’à armes égales’ avec le groupe émetteur. On peut d’abord s’interroger sur le concept même de ’public’. En effet, dans son acception courante, le terme ’public’ désigne ‘’l’ensemble de la clientèle visée ou atteinte par un média’ ’ aussi bien que ’ ‘l’ensemble des personnes qui sont réunies dans une salle, qui voient un spectacle’ ’. Quant au ’grand public’, il s’agit de ‘’l’ensemble du public, par opposition aux initiés, aux connaisseurs’ ’. Et pour ce qui est de l’adjectif ’public’, il renvoie à ce qui concerne ’ ‘la collectivité dans son ensemble ou à ce qui en émane, par opposition à privé’ ’ ou bien ce qui est ’ relatif au gouvernement, à l’administration d’un pays’, ou encore ‘’ce qui relève de l’Administration ou des finances de l’Etat’ ’ 228. On retrouve donc ici la même ambiguïté que celle que nous avons soulevée à propos de l’importante différence sémantique entre ’l’opinion publique’ qu’évoque Habermas et ’l’opinion publique’ dans son acception moderne habituelle. Dans le premier cas, il s’agit d’un concept qui transcende les intérêts privés grâce à l’usage public de la Raison et qui permet de déterminer ’l’intérêt général’; dans le second cas, on a affaire à une simple addition d’opinions privées qui ne tire sa ’légitimité’ que du nombre. Et quand on se réfère au ’public’, particulièrement lorsque l’on a l’intention de le sacraliser, on se trouve bien dans ce second cas de figure caractérisé par la simple loi du nombre.
Au surplus, on peut se demander si le public en question - celui qu’il faut ’satisfaire’, celui aux attentes duquel il faut répondre - n’est pas au fond une construction discursive bâtie à partir d’une idéologie - le libéralisme - et de techniques qui en découlent - le marketing, l’audimat - afin de légitimer la ’marchandisation’ croissante des médias. Il y a selon nous dans l’utilisation récurrente de la notion de ’public’ toute une mythologie 229 qui vise à ’naturaliser’ la migration des médias dans l’univers marchand et, à l’extrême, à leur retirer par là-même toute mission de service public ( c’est-à-dire d’intérêt général) et toute fonction dans l’espace public. On peut ainsi imaginer un système sémiologique premier composé d’un signifiant premier, l’audimat, et d’un signifié premier, l’audience, le tout formant un signe, le public. Ce signe, par l’effet des discours dominants, devient à son tour le support d’un système sémiologique second dont il est le signifiant, le signifié second pouvant être, par exemple, des ’parts de marché’ ou l’approbation. Ainsi cette association entre ’public’ et ’ parts de marché’ apparaît-elle bien comme un mythe visant à légitimer idéologiquement l’application aux médias de masse de la logique néo-libérale.
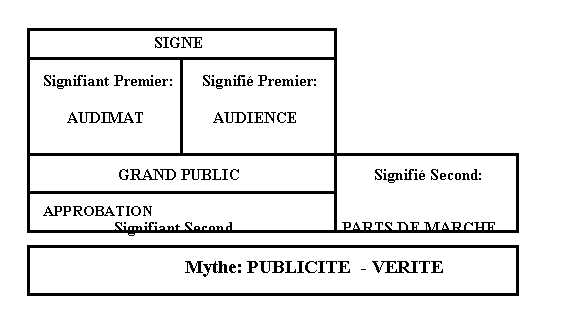
En appliquant strictement la terminologie suggérée par Roland Barthes (qui permet par exemple de former le néologisme ’sinité’ à partir du signe ’Chine’), on obtient donc, à partir du signe ’public’, une mythologie que l’on peut désigner par le vocable ’publicité’. Certes, ce lexème est déjà utilisé, mais son acception moderne (vanter un produit pour en maximiser les ventes) n’est pas très éloignée, au moins analogiquement, de la mythologie que nous tentons présentement de mettre au jour. Dans les deux cas, en effet, intervient fortement la notion de commerce, de ’marché’, de concurrence, toute la ’magie’ de l’opération mythologique ayant finalement pour objet de transformer le ’public’ en ’clientèle’, le dictionnaire Larousse lui-même attestant de la réussite de cette ’transmutation’ en définissant le ’public’ comme ’ ‘l’ensemble de la clientèle visée ou atteinte par un média’ ’.
Il nous semble enfin utile de souligner que le concept de ’public’ nous apparaît comme relevant d’une représentation éminemment positiviste de la société. Il existerait donc, en toute hypothèse, un ’public’ ou des ’publics’, c’est-à-dire un ou des ensembles d’individus caractérisés par des goûts et des inclinations ’culturelles’ communes, par une même ’attente’ de tel ou tel type ’d’information’ ou de production écrite ou audiovisuelle. Et il suffirait, grâce au marketing, aux sondages d’opinion et aux techniques annexes, de bien connaître les différents ’segments’ du ’marché’ et de concevoir des productions médiatiques adaptées à ces diverses ’cibles’. Autrement dit, le concept de ’public’ et l’utilisation qui en est faite par la plupart des programmateurs et des dirigeants de médias renvoie à une ’demande’ considérée comme ’transcendantale’ pour reprendre une formulation kantienne, en ce sens qu’elle constituerait en quelque sorte une catégorie ’a priori’ de l’entendement médiatique. On aurait ainsi comme une réalité objective un ’public’ demandeur de presse à scandales, un ’public’ demandeur de ’sitcoms’, un ’public’ demandeur de films comiques, un ’public’ demandeur de divertissements, etc. Or ce ’public’ ou ces différents segments du ’public’ ne sont constitués en catégories - par un effet analogue à celui des sondages d’opinion sur lequel nous reviendrons largement - qu’en tant que réponse à une interrogation binaire (’aimez-vous ou n’aimez-vous pas telle émission ?’) produite soit par les enquêtes marketing, soit par les études d’audience. Autrement dit ce que le discours dominant présente comme une ’demande du public’ qu’il faut satisfaire apparaît en réalité comme une offre implicite, à un questionnement sous-entendu dans lequel - comme l’indique Pierre Bourdieu à propos des sondages d’opinion - ‘’il arrive souvent que l’on induise la réponse à travers la façon de poser la question. Ainsi, par exemple, transgressant le précepte élémentaire de la construction d’un questionnaire qui exige qu’on ’laisse leurs chances’ à toutes les réponses possibles, on omet fréquemment dans les questions ou dans les réponses proposées une des options possibles, ou encore on propose plusieurs fois la même option sous des formulations différentes’ ’ 230 .
Si l’on s’interroge, à la lumière de cette analyse, sur le fonctionnement de ’l’audimat’ et sur les effets pervers qu’il provoque - ou sur les conséquences, dans le domaine de la chanson, de la logique des ’hit-parades’ et du ’matraquage’ opéré par les radios et les télévisions - on constate que les prétendus ’goûts du public’ constituent bien un alibi commode pour dissimuler la structure véritable du champ des médias audiovisuels. Celle-ci est fondée pour l’essentiel - en tout cas dans le secteur privé, qui est très largement dominant - sur la maximisation du taux de profit et sur la reproduction du système libéral, et non pas sur des préoccupations culturelles ou démocratiques, même si, à un moment donné, les médias peuvent se voir confier la mission de contribuer à mettre en adéquation le niveau de développement technico- intellectuel des forces productives et les exigences des moyens de production et d’échanges modernes. En d’autres termes, il nous apparaît que l’une des contradictions majeures du capitalisme moderne, profondément marqué par une révolution scientifique et technique de plus en plus rapide, est due au décalage de plus en plus net entre les technologies modernes - que ce soit en termes de fabrication des marchandises ou en termes de marché -, et les capacités réelles des masses, aussi bien pour des raisons de méconnaissance que de mentalités, à utiliser de façon efficiente les outils et les machines actuellement disponibles. On se trouve face à un grave problème: c’est que l’évolution technique va plus vite que l’évolution sociale ce qui ouvre une possibilité de manipulation au nom du progrès technique.
On ne peut que s’interroger, à partir de là, sur la capacité de la télévision, en l’état actuel des choses, à promouvoir, comme le prétend Dominique Wolton, une ’culture de masse’ ayant quelque chose à voir avec la culture. Car la notion de ’culture de masse’ nous semble singulièrement ambiguë et porteuse de nombreux effets pervers. En effet, la formule ’culture de masse’ peut s’appliquer à deux processus radicalement différents. S’agit-il, en somme, de permettre aux masses d’accéder à la culture ’cultivée’, aux formes culturelles et aux connaissances qui ne font pas partie de leur habitus, d’élever leur capital culturel, ou bien s’agit-il de considérer que les programmes télévisés finissent par construire une espèce de (sous) culture pour les masses, en mettant à leur disposition une grande quantité d’informations sur les sujets les plus variés, cette culture ayant l’avantage - selon Dominique Wolton - d’être identique pour tous, et donc de créer du ’lien social’. Sauf à la marge, la télévision se situe évidemment dans ce second cas de figure: elle peut en effet se targuer à bon droit de donner au plus grand nombre une somme non négligeable d’éléments, de pré-notions, et parfois de vraies connaissances à propos de ce qui se passe dans le monde; de ce point de vue, les masses sont sans doute plus informées qu’avant la généralisation de la télévision (le sont-elles mieux, rien n’est moins sûr !); il est même évident que dans le domaine du cinéma, par exemple, la télévision permet l’accès de tous à la plupart des films, y compris anciens, même si tous les films ne passent pas à la télévision et même si la production américaine est omniprésente dans les programmes et même si le pire côtoie le meilleur. Mais, in fine, force est de constater que la ’culture de masse’ popularisée par la télévision est tout entière fondée sur la logique du spectacle et qu’elle ne procède d’aucune autre ambition que celle de l’audience. La mission culturelle et informationnelle que pourrait (et devrait) avoir la télévision se trouve donc bien enfermée dans un cercle vicieux provoqué par ce que nous avons appelé, dans la première partie de la présente thèse, la ’dictature de l’audimat’: pour séduire le ’public’, il faut programmer ce qui est censé lui plaire, ce qui exclut pratiquement, en tout cas aux heures de grande écoute, ce qui serait justement nécessaire pour élever le niveau culturel et intellectuel de tous.
Plus importante encore peut-être nous semble être la question du ’lien social’ à laquelle Dominique Wolton accorde tant d’importance. Pour lui, en effet, un des mérites essentiels de la télévision ’généraliste’, opposée à la télévision ’thématique’, résiderait dans le fait que les téléspectateurs, qui regardent par millions les mêmes programmes au même moment (et souvent à plusieurs devant un récepteur), se trouveraient ainsi reliés entre eux, unis dans une espèce de communion cathodique qui renforcerait - voire créerait, pour certains individus isolés - leur sentiment d’appartenance sociale. Dominique Wolton écrit ainsi: ‘’La force de la télévision est de constituer ce lien social et de le représenter. Reprenant l’hypothèse d’E. Durkheim sur la religion, on pourrait presque dire que la télévision est l’une des formes élémentaires du social. Si de nombreuses pratiques sociales contribuent au lien social, mais sans visibilité, l’intérêt de la télévision est de le représenter, de manière visible par tous’ ’ 231 . Sans doute, d’un point de vue sociologique ou anthropologique, Dominique Wolton n’a-t-il pas tout à fait tort d’établir ce parallèle entre télévision et religion. Poussant cette analogie plus loin que lui - et trahissant du même coup sa pensée - nous aurions même tendance à considérer, pour paraphraser Marx, que, comme la religion, la télévision ’ ‘est le soupir de la créature accablée par le malheur, elle est le coeur d’un monde sans coeur, comme elle est l’esprit d’un monde sans esprit: elle est l’opium du peuple’ ’ 232 . De la même façon, en allant jusqu’au bout du raisonnement, on pourrait penser - de façon sans doute quelque peu caricaturale - que la télévision s’inscrit dans la méthode de gouvernement des empereurs romains dénoncée par le poète Juvénal: ’Panem et circenses’ 233. A cet égard, la profusion des jeux à la télévision, ainsi que la place privilégiée accordée au sport montre assez que la télévision est dominée par la logique du spectacle.
C’est pourquoi - et là nous avons une divergence radicale avec Dominique Wolton - nous ne nous réjouissons pas du rôle joué par le petit écran dans la construction du ’lien social’, d’une part pour des raisons de principe et d’autre part eu égard à la nature du ’lien social’ qui est ainsi créé. Les raisons de principe tiennent au fait que la télévision - dominée, rappelons-le, par des intérêts privés - ne nous semble disposer d’aucune légitimité particulière pour remplir cette mission, même si, sous certaines conditions (pluralisme, ambitions culturelles, nouvelle conception de l’information,...), le problème pourrait se poser différemment pour le service public télévisuel. Quant à la nature du ’lien social’ généré par la télévision, nous pouvons indiquer un certain nombre de tendances lourdes: mise en oeuvre d’un consensus politique et idéologique fondé sur l’acceptation et même l’intériorisation du libéralisme; tendance à conforter l’ordre social en place et la logique d’appartenance; développement d’une orientation de plus en plus consumériste; généralisation d’une ’culture’ dominée par les modèles américains; construction de ’mythologies’ et de représentations visant à légitimer par le spectacle l’idéologie dominante et les comportements sociaux ’politiquement corrects’, etc. En toute hypothèse, le ’lien social’ ne nous semble pas devoir être considéré comme une fin en soi, sauf à prôner une société qui, d’une certaine façon, serait totalitaire, en ce sens que les différents dispositifs sociaux destinés à conforter le sentiment d’appartenance - outre qu’ils produisent en même temps de l’exclusion - construiraient une espèce de ’camisole sociale’ extrêmement coercitive sur le plan psychologique et rendant pratiquement impossible toute velléité d’indépendance personnelle, toute initiative ne rentrant pas dans les normes, tout comportement non conforme à ’l’opinion publique’. On ne serait pas très loin du ’Big Brother’ décrit par Georges Orwell dans 1984 234. Nous avons donc tendance à nous méfier quelque peu de la sacralisation du ’lien social’ tout en admettant que celui-ci, à, dose raisonnable, est nécessaire; et il est fort à craindre, selon nous, que, de ce point de vue, la télévision aille très au-delà du raisonnable.
Enfin, Dominique Wolton, - et bien d’autres, car c’est là une idée reçue largement répandue - affirme que la télévision est un outil irremplaçable pour mieux connaître et mieux comprendre le monde: ‘’A l’heure du repli frileux sur soi face à l’inquiétante mondialisation, tandis que nos univers sont incroyablement perturbés mentalement et culturellement, heureusement qu’existe un tel média de masse pour aider à mieux comprendre un monde, qui, du coup, semble moins menaçant’ ’ 235 . Ce point de vue nous semble bien optimiste et loin de la réalité. Certes - on l’a déjà indiqué - les téléspectateurs actuels sont-ils sans doute davantage informés que le citoyen lambda il y a cinquante ans, encore que la radio, à l’époque, jouait un rôle très positif en matière d’information, sans oublier les journaux dont les tirages étaient très sensiblement supérieurs à ceux d’aujourd’hui. Mais on peut formuler deux objections fortes. Tout d’abord la télévision, au-delà des apparences, ne traite qu’une infime partie de l’actualité et des problèmes qui se posent dans le monde; il n’est, pour s’en convaincre, que de comparer le contenu des journaux télévisés avec celui des grands quotidiens nationaux, qui, eux-mêmes, n’abordent pas, loin s’en faut, la totalité des ’événements’ qui se déroulent dans une période de temps donnée. En fait, comme l’ont très bien montré Jean-François Tétu et Michel Mouillaud 236, c’est le concept même ’d’événement’ que l’on peut critiquer, dans la mesure où les médias en général et la télévision en particulier ’construisent l’événement’ plutôt qu’ils ne le rapportent. Autrement dit, n’accèdent au statut ’d’événements’ que les faits ou les discours retenus ou produits par les médias. En second lieu, ces faits ou ces discours, même quand ils ont une base matérielle, sont complètement retravaillés, ’reconstruits’ par les médias, en termes d’espace occupé ou de temps d’antenne, de traitement de l’information, de commentaires, d’analyses. Et ce paradoxe des médias - qui se présentent comme des simples interfaces entre le réel et le ’public’ alors qu’ils ne font que construire des représentations - est évidemment encore plus saisissant pour la télévision, en raison de la crédibilité particulière que lui confère l’image. Le fait de ’voir’ les choses à la télévision les rend ’évidentes’ 237. Et, du coup, le rationalisme prêté à Saint Thomas (’Je ne crois que ce que je vois’) sert en quelque sorte de support à la posture naïve du téléspectateur qui tend à ’croire tout ce qu’il voit’ et à ne pas voir ce qu’on ne lui montre pas à la télévision. Nous émettons donc de sérieux doutes quant à la capacité - et à la volonté - de la télévision d’aider à ’mieux comprendre le monde’. Il nous apparaît que, fondamentalement, la télévision produit chez ceux qui la regardent l’illusion qu’ils comprennent le monde parce qu’ils peuvent le voir. Cette espèce de familiarité avec le monde dont l’immensité physique se trouve circonscrite dans le minuscule espace du téléviseur ne relève pas du cognitif ou de l’intelligible, mais du magique, un peu à la manière de la lampe d’Aladin. Ayant enfermé le monde dans la télévision, le téléspectateur croit pouvoir en comprendre les mécanismes. Mais en fait, si la télévision semble rapprocher le monde, si elle le rend - peut-être - moins menaçant, elle n’aide pas vraiment à le comprendre, et, dans une certaine mesure, elle en empêche la compréhension, en ce sens qu’elle tend à naturaliser tous les phénomènes (notamment les phénomènes économiques) ce qui a pour effet de contribuer fortement à l’acceptation de l’ordre actuel du monde.
Nous croyons avoir suffisamment montré les limites du point de vue ’téléphile’ développé par Dominique Wolton. Celui-ci, qui se classe lui-même dans le courant des ’empiristes - critiques’ résume ainsi sa position. Il s’agit, selon lui, ’ ‘d’utiliser l’ambiguïté de la communication pour préserver sa dimension d’émancipation et permettre aux individus comme aux collectivités de refuser la réification et l’instrumentalisation complète de la communication. On retrouve ici la vision idéaliste critique qui existe souvent dans une certaine philosophie de l’histoire et de la société’ ’ 238.