2-2-2 Mémoire permanente
La forme d’un objet dans l’environnement prend une signification et une identité lorsqu’un exemplaire correspondant à cette forme est trouvé dans la mémoire à long terme de l’intéressé. Les connaissances sur les objets acquises par le sujet et stockées en MLT sont désignées sous le terme de représentations d’objets.
La mémoire permanente ou à long terme contient à juste titre des informations stables, des connaissances qui peuvent évoluer bien qu’elles aient un caractère plus statique que les représentations ou informations du niveau inférieur (de la mémoire transitoire). Du fait de la variété des informations, le format des représentations en mémoire a fait l’objet de vifs débats entre les informations imagées et celles verbales. Dès 1967, SHEPARD a démontré expérimentalement que la reconnaissance d’images était supérieure à la reconnaissance des mots et des phrases ; PAIVIO (1971) a renforcé ce résultat en imposant l’hypothèse d’un double codage des informations en mémoire permanente : certaines informations peuvent être stockées sous une forme verbale, d’autres sous une forme imagée et d’autres, enfin, sous ces deux formats.
Contrairement à la théorie bimodale, de nouvelles théories proposées par PYLYSCHYN (1973) et ANDERSON (1983), suggéraient que les informations ne pouvaient être stockées que sous une forme essentiellement propositionnelle (codage sémantique et abstrait).
Puis, une nouvelle controverse s’opposa à cette dernière pour proposer une théorie mixte soutenue par KOSSLYN (1975) qui envisage différents niveaux de représentation mnésique. Un niveau profond où toutes les informations seraient codées sous une forme propositionnelle et un niveau de surface où le format ne serait pas homogène mais pourrait être aussi verbal qu’imagé.
Si jusque là, les oppositions portaient essentiellement sur le codage, les travaux de TULVING (1983) vont montrer que cette dichotomie obéit à certaines règles d’organisation des informations stockées en mémoire à long terme (tableau 2-1). Il s’avère que certaines représentations mnésiques possèdent une très grande stabilité et sont relativement peu affectées par la variabilité des contextes de récupération. Ces représentations sont des concepts ou des connaissances générales, elles peuvent être regroupées sous le nom de mémoire sémantique. Elles se différencient d’un autre type de représentations plus flexibles et particulièrement sensibles aux variations contextuelles.
Ce sont des représentations d’événements décrites sous le nom de mémoire épisodique. La mémoire épisodique est un système de stockage des informations datées, événements ou épisodes personnellement vécus et de leurs associations spatio-temporelles ; la mémoire sémantique, elle, reste la mémoire nécessaire à la production et à la compréhension linguistique sous forme de thésaurus mental : mots, symboles verbaux, significations... La mémoire épisodique est également essentielle pour s’orienter dans le temps et l’espace ; la conscience que nous avons de l’endroit où nous nous trouvons est considérablement renforcée lorsque nous savons comment nous y sommes arrivés, ce qui à son tour doit contribuer largement à nous guider vers notre but. La mémoire épisodique est importante non seulement pour se rappeler ce qu’on a fait mais pour se rappeler ce qu’on doit y faire ultérieurement. (BADDELEY, 1993)
| MÉMOIRE ÉPISODIQUE | MÉMOIRE SÉMANTIQUE | |
| INFORMATION | Evénement Episodes Référence au moi Croyance |
Faits, idées Concepts Références à l’univers Consensus social |
| PROCESSUS | Codage temporel Affect important Contextuel Evocation du passé Sensible à l’amnésie |
Codage atemporel Affect peu important A-contextuel Actualisation des connaissances Peu sensible à l’amnésie |
| APPLICATIONS | Utilité faible dans l’éducation Utilité sociale faible Sans relation avec l’intelligence Oubli Témoignage |
Forte utilité dans l’éducation Utilité sociale élevée Forte association avec l’intelligence Langage Expertise |
Les représentations ont cependant une propriété commune importante : elles sont toutes, en principe verbalisables, qu’il s’agisse d’épisodes singuliers, de concepts ou d’images mentales. Elles ont en outre un caractère relativement statique et ne font que décrire certains états du monde. Elles sont alors rassemblées sous une même entité appelée les connaissances déclaratives en opposition aux connaissances procédurales. Ces dernières beaucoup plus dynamiques renvoient aux capacités perceptivo-cognitives et cognitivo-motrices ; elles ne sont pas, ou très difficilement, communicables. Elles reposent enfin sur des systèmes d’association plus ou moins complexes entre des stimuli, des comportements et des états mentaux. La prise de conscience et le contrôle intentionnel dominent dans la manipulation des connaissances déclaratives alors que les connaissances procédurales sont fortement automatisées.
La mémoire épisodique est probablement impliquée dans le processus d’orientation spatiale ou simplement dans le processus de mémorisation des lieux, du fait de sa capacité à acquérir de nouvelles informations et à les relier à notre propre histoire ou à nos expériences de la vie quotidienne ainsi qu'à notre environnement. Un lieu est facilement associé à un événement sans intention de la part du sujet : vous vous promenez dans un quartier de votre ville que vous n’avez pas l’habitude de fréquenter, puis vous rentrez dans une librairie pour acheter un journal et par hasard vous retrouvez un ami d’enfance que vous n’aviez pas vu depuis longtemps. Des semaines ont passé, et un de vos collègues de travail vous conduit dans cette rue, une adresse voisine de la librairie. Instantanément vous la reconnaissez car vous l’associez à un événement heureux : la rencontre d’un ami.
La majorité des chercheurs travaillant dans le domaine de la mémoire acceptent l’idée de la distinction entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique mais elle est cependant encore fortement débattue comme le souligne NICOLAS (1993) : En effet, certains auteurs (ANDERSON et ROSS 1980) ont suggéré que cette distinction est une manière potentiellement utile de classer différents types de connaissances mais ne correspond pas certainement à des systèmes indépendants de mémoire. Ces critiques ont conduit TULVING, depuis 84, à adopter l’hypothèse des systèmes emboîtés (mémoire déclarative et mémoire procédurale). TULVING affirme que la mémoire procédurale peut opérer sans l’aide des autres systèmes ; la mémoire sémantique, en revanche, ne peut fonctionner indépendamment de la mémoire épisodique qui, elle-même, est liée aux deux autres systèmes." Finalement, mémoire procédurale et déclarative sont clairement distinctes aussi bien dans les aspects psychologiques que neuropsychologiques.
ANDERSON J. R. (1983) propose un modèle de mémoire de type computo-symbolique, le modèle ACT* (Adaptive Control of Thought) 6 , où les mémoires permanentes, épisodique et sémantique, sont en relation constante avec la mémoire de travail. Ces procédures sont appliquées aux contenus de la mémoire de travail et cette application peut entraîner de nouvelles connaissances déclaratives, créer de nouvelles règles de production ou modifier d’anciennes règles antérieurement stockées (figure 2-2). Quatre processus fondamentaux déterminent la dynamique du système : 1) le stockage (créer des représentations en mémoire permanente déclarative), 2) la récupération (retrouver une information en mémoire déclarative), 3) l’appariement ou le «matching» (comparer le contenu de la mémoire de travail à la partie condition des règles de production en mémoire procédurale), 4) l’exécution (transférer en mémoire de travail la partie action d’une règle de production pour laquelle un appariement a été réussi).
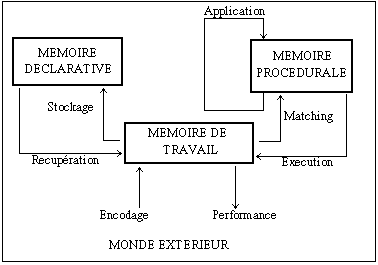
Bien que ce modèle ait permis, entre autres, une description plus précise des mécanismes psychologiques, offrant des moyens théoriques pour une simulation rigoureuse, il possède quelques imperfections et notamment il n’explique pas la façon dont se forment les représentations symboliques manipulées par le système à mémoire.
Le modèle d’ANDERSON est cependant particulièrement intéressant du point de vue de l’organisation des connaissances spatiales qui reprend le principe d’une dichotomie entre les connaissances déclaratives et les connaissances procédurales.
La dichotomie entre mémoire déclarative et mémoire procédurale renvoie à l’opposition courante entre le savoir et le savoir-faire. Les connaissances procédurales sont par nature plus proches de l’action concrète contrairement aux connaissances déclaratives. Elles spécifient des structures de contrôle directement utilisables dans la réalisation de l’action. En contrepartie, lorsqu’elles sont exécutées fréquemment et qu’elles s’automatisent, elles peuvent avoir perdu les connaissances déclaratives ou les raisons qui les ont fondées. Les connaissances procédurales peuvent avoir été acquises par l’action sans référence approfondie à des connaissances déclaratives. On peut connaître, parfaitement, un quartier uniquement par locomotion sans utilisation de carte.