12. 3. 2. La métaphore : l’analogie sémantique487
La correspondance voco-structurale de Lavoisier conduit à forger des termes de plus en plus difficilement énonçables. Bien que reprenant en partie le programme de Lavoisier, Auguste Laurent renonce à la règle du vocable simple, soulignant qu’il est rare de rencontrer en biochimie des êtres pouvant être dénommés de manière concise. De même le principe lavoisien de l’addition/association sera remplacé par la conception ensembliste de ce dernier, qui s’accommode plus difficilement des formations exogéniques savantes par division et association. Devant la complexité croissante des termes, Auguste Laurent appelle de ses voeux une terminologie simple, euphonique et en harmonie avec les noms habituels, transposable dans toutes les langues, facile à mémoriser. Les prémices de ce mouvement sont décelables dès le début du siècle, alors que les scientifiques subissent l’influence du romantisme. Certains chercheurs, dont Cabanis, se désolidarisent des principes analytiques que les Idéologues ont hérités de Condillac, et énoncent de nouvelles revendications quant au langage de la science :
‘En fin de compte, on assiste en médecine comme en botanique et en zoologie, à un retour en arrière, en faveur d’un impossible parler harmonieux, d’une « peinture parlée » selon l’expression de Cabanis. On se met à vanter un vocabulaire sans véritable contenu, sans surcharge, léger et clair, qui porterait seulement les marques des liens fondamentaux, une primitivité transparente (Dagognet, 1970 : 170)488.’Cabanis veut donner aux néologismes médicaux, entre autres fonctions, celle de traduire les liaisons entre les phénomènes : ce principe transposera avec autant d’efficacité la liaison entre les éléments que la condensation analytique. Afin d’illustrer son propos, il cite le terme pleurésie, qui, selon lui, évite la complexité jargonneuse d’un exogène gréco-latin, et retrace de manière élégante et abrégée le lien entre le symptôme et la maladie489. Car, au nom de l’usage, il s’insurge contre les locutions savantes et construites que Linné et Lavoiser avaient mises à l’honneur :
‘Il [le mot] devient souvent pédantesque, quelquefois ridicule, presque toujours difficile à fixer dans la mémoire, et d’un usage incommode (Cabanis, Du degré de certitude en médecine, T I, 1823 : 471 ; cité par Dagognet, 1970 : 170).’D’autre part, il convient de souligner que toutes les sciences ne se prêtent pas au travail nomenclatural caractéristique des sciences naturelles
et de la chimie, comme le souligne Auguste Comte :
‘Parmi les sciences où l’immense multitude des sujets considérés excite spontanément à la formation des nomenclatures spéciales, la chimie est la seule où, par sa nature, les phénomènes soient assez simples, assez uniformes, et en même temps assez déterminés, pour que la nomenclature rationnelle puisse être à la fois assez claire, rapide et complète, de façon à contribuer profondément au progrès général de la science (Comte, Cours de philosophie positive, 35e Leçon, III ; in Philosophie des sciences : 29-31).’À cela, il convient d’ajouter que le milieu du siècle voit apparaître des objets scientifiques que l’observation ne permet plus d’appréhender : la notion de vérité et les êtres mathématiques se sont dégagés du monde sensible ou intuitif490, la thermodynamique révolutionne les vieilles conceptions mécanistes et la théorie des champs, basée sur des phénomènes difficilement observables, implique l’utilisation de grandeurs non discrètes. Les sciences remettent en question l’interprétation littérale, comme l’indiquent les créations de la mathématique non euclidienne, de la physique non newtonienne, le dégagement du calcul intégral des limites de la notion intuitive de continuité, et l’autonomisation de l’analyse.
C’est donc une recherche tant sémantique qu’esthétique ou normative qui guide les pas de la terminogénie. Comment dénommer de manière claire, esthétique et motivée des phénomènes difficilement appréhendables ? Comme l’a montré Michel Le Guern (1973 : 71-75), la métaphore possède les trois fonctions attribuées au langage par la rhétorique latine – i. e. docere, placere et movere – et répond donc aux exigences des savants du temps. Dans le cas de la terminologie, c’est la première fonction, docere, qui prime :
‘Si la métaphore permet de donner un nom à une réalité à laquelle ne correspond pas encore un terme propre, elle permet aussi de désigner les réalités qui ne peuvent pas avoir de terme propre. Elle permet de briser les frontières du langage, de dire l’indicible. C’est par la métaphore que les mystiques expriment l’inexprimable, qu’ils traduisent en langage ce qui dépasse le langage. (...) L’effort du poète, qui veut traduire en mots une saisie de l’univers qui dépasse la logique commune et le langage commun, aboutit de la même manière à la métaphore. Dépasser par le langage ce que peut dire le langage de la toute simple information logique pour essayer de donner une information d’un ordre supérieur, voilà qui fournit (...) une des motivations les plus pressantes au processus métaphorique (Le Guern, 1973 : 72).’La métaphore est donc un moyen de dénommer l’inconnaissable. En effet, un changement dans la perception du rapport sens propre/sens figuré s’était produit au 18e siècle. Vico, en mettant en évidence l’antériorité du sens figuré par rapport au sens propre, avait démontré l’historicité de la métaphore comme principe lexicogénétique :
‘Lorsque les hommes ignorent les causes naturelles des choses, et lorsqu’ils ne peuvent pas même approximativement s’en rendre compte par la comparaison des choses semblables, dont les causes leur sont connues, ils attribuent aux choses leur propre nature (Vico, La science nouvelle, 1844 ; cité par Molino, 1979 b : 106)491.’La figure n’est plus perçue comme un écart, et la langue est désormais appréhendée comme un cimetière de métaphores mortes. Le Traité des tropes de Du Marsais (1730) introduit une conception qui ne relève plus de la seule rhétorique. Comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage (ou des différents sens dans lesquels on peut prendre un même mot dans une même langue), son auteur ne s’intéresse qu’aux figures de signification, auxquelles il assigne un rôle d’enrichissement lexical par la multiplication des sens des mots. Cette pensée sera prolongée par Beauzée et reprise par Fontanier qui montre le rôle de la métaphore dans les mécanismes de la structuration sémique (Les figures du discours (1821)). Plus tard, Chevallet (Origine et formation de la langue française (1853-1856)), Darmesteter (La vie des mots (1886)) et Bréal (Essai de sémantique (1897)) empruntent leur typologie à la rhétorique des figures pour analyser les changements sémantiques diachroniques (cf. Simon Bouquet (1997 : 225)).
La métaphore trouve ainsi peu à peu sa place au sein de la sémantique naissante : elle est désormais perçue comme un outil lexicogénétique adapté à la pensée, et donc, à la connaissance. La recherche d’un isomorphisme entre le langage et la pensée semble avoir trouvé une alternative aux principes analytiques de Condillac. Il convient donc de nous attacher désormais aux principes de création et de réception des dénominations métaphoriques au sein du champ scientifique.
La partie de la communauté scientifique qui s’intéresse à l’histoire et à la philosophie des sciences492 s’accorde à voir dans la dénomination métaphorique une heuristique puissante. L’argument le plus souvent invoqué, – et qui remonte à l’historien et philosophe italien Vico –, est que la métaphore permet de comprendre l’inconnu grâce au connu, de comprendre une expérience grâce à une autre expérience. En amont, la dénomination métaphorique constituerait un stade préparatoire à toute saisie conceptuelle. En aval, le schématisme de la saisie préconceptuelle qu’elle laisse affleurer dans le discours est jugé comme une aide pour l’apprenant. De même, certains mathématiciens du temps proposent l’utilisation de la métaphore dans un but heuristique, afin d’aider le processus de découverte493.
Ainsi, il est clair que des termes comme force (17e siècle) ou inertie (du latin inertia « indolence, paresse » (Kepler, 1609)) sont des signes de l’anthropomorphisme de la mécanique classique. Évoquons également le paradigme métaphorique de l’électricité : conductor (= conducteur), terme que Watson créa par métaphorisation (1737), current (= courant) apparait en 1747 à propos du courant électrique, charge (Franklin, 1747), circuit (1800), induction (1801) (du latin inductio « action d’amener ») pour désigner la transmission à distance de l’énergie électrique. Tous ces termes appartiennent au domaine //transport//, et permettent de réinterpréter des termes comme electrode (littéralement « chemin électrique »), anode (du grec αηοδος, littéralement « chemin vers le haut ») et cathode (du grec κατηοδος, littéralement « chemin vers le bas ») (Faraday, 1834), ion (du grec ιον, participe présent de ειναι « aller ») (Faraday, sur les conseils du philosophe des sciences Whewell, 1833), resistance (1878) (du latin restistentia, de resistere « s’arrêter, ne pas avancer davantage »). Il semblerait que le modèle de l’électricité ait été fortement marqué par la notion de déplacement, hypothèse qui se vérifie lorsque l’on se penche sur l’histoire de la discipline.
En effet, depuis le milieu du 18e siècle, l’électricité est perçue comme un fluide qui se propage (rapidement) grâce à des conducteurs ; plus tard, sera introduite la notion de circuit, c’est-à-dire de suite ininterrompue de conducteurs, qui constitue le chemin de déplacement de ce fluide. Avec la pile électrique, l’électricité, jusque-là statique, devient dynamique. Grâce à l’invention de Volta, la chimie progresse et on découvre que, dans une décomposition de solution chimique par l’électricité, les deux constituants (positif et négatif) cheminent en sens inverse (vers le haut et vers le bas) dans le liquide. L’ion est donc une particule qui vers le haut (anode) ou vers le bas (cathode), en empruntant des électrodes, des chemins pris par l’électricité.
L’hypothèse de Mary Hesse – qui appréhende la métaphore comme un des outils d’adaptation du langage à ce monde en perpétuelle expansion qu’est la science – se confirme donc (cf. Paul Ricoeur (1975 : 305-306)). Cependant, dans l’exemple que nous venons d’aborder, la motivation est saillante, dans la mesure où elle fait appel à l’expérience courante. Toutefois, force est de constater que les termes transparents sont ceux d’un emploi usuel (conducteur, charge, circuit, courant). Anode, cathode, électrode et ion sont d’une valeur heuristique beaucoup moins importante pour qui ne connaît pas le grec. Quant à résistance, il apparaît que la motivation qui émerge prioritairement n’est pas celle d’arrêt, mais de refus. La motivation de ces derniers termes ne transparaît donc qu’à la lumière des éléments les plus transparents du paradigme.
Il semblerait donc que l’heuristique liée à l’utilisation du vocabulaire courant soit une arme à double tranchant dans le cas des sciences, où il convient de différencier l’expérience courante et la réalité scientifique. La fausse heuristique des sensations entraîne des confusions entre les notions dont les spécialistes et les didacticiens se plaignent souvent. Michel Bruneaux (1984) évoque la constitution du champ disciplinaire de la thermodynamique et les conséquences des choix terminologiques de l’un des pionniers de la discipline, Sadi Carnot. En effet, dans son étude des phénomènes liés à la chaleur, celui-ci adopte des termes courants, intuitifs, et, dans le but d’être compris de tous (il fait lire le manuscrit des Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance (1824) par son frère pour être certain qu’il est compréhensible par un non-spécialiste), rédige dans un langage simple :
‘Cette discipline s’occupe de notions intuitives très fortement chargées de subjectivité telles que la température, la chaleur, le feu... L’apprentissage de la thermodynamique se fait sur ce substrat de connaissances de la vie courante et le langage scientifique n’en est pas dégagé (Bruneaux, 1984 : 81).’Michel Bruneaux (1984 : 82) souligne que le terme entropie, qui ne possède pas de référence intuitive, pose des problèmes de formulation moindre que des termes comme température ou chaleur.
Il apparaît cependant qu’une rupture soit advenue entre le début du siècle, période durant laquelle Sadi Carnot utilise un vocabulaire courant, et le milieu du siècle. Les scientifiques, face à des phénomènes totalement nouveaux et en opposition avec les modèles classiques, voire avec le sens commun, ne peuvent utiliser des métaphores se référant à l’expérience quotidienne494. La rupture n’est donc pas une rupture dans le mode de dénomination – on a toujours recours à la métaphore – mais dans l’utilisation de celui-ci. Les sémèmes-sources ne sont plus empruntés à l’expérience courante. Alors que la théorie de la chaleur visait essentiellement à rapprocher l’inconnu du connu, la thermodynamique allait tenter d’abandonner une heuristique qui peut parfois s’avérer encombrante et de dénommer de manière certes motivée, mais beaucoup plus symbolique495.
En effet, la thermodynamique se doit de se différencier de l’ancienne théorie calorique, tirée des impressions sensibles, et à laquelle adhère Sadi Carnot dans son ouvrage de 1824. Elle utilise des concepts qu’elle dénomme, comme le conseillera le physicien anglais James Clerck Maxwell (in Matter and energy (1894)), au moyen de termes simples et abstraits, comme energy (William Thomson, 1850) et Entropie (Rudolph Clausius, 1850).
Le concept d’énergie a reçu les appellations de Wirkungsfunction (fonction d’activité) par le physicien allemand Kirchhoff, innere Wärme des Körpers (chaleur intérieure des corps) par Zenner, Kraft (« force » dans l’expression die Erhaltung der Kraft (1847)) par le physicien et physiologiste allemand Helmholtz avant que le substantif energy, utilisé par William Thomson dans l’expression mechanical energy of a body in a given state (1850) ne soit adopté par la communauté internationale. Il semblerait que la découverte de la conservation de l’énergie (1ère loi de la thermodynamique qui estime que dans tout système isolé, le montant d’énergie est constant) soit à l’origine de la généralisation du terme énergie et de ses équivalents par calque, la notion d’invariance étant, selon les auteurs, à l’origine de ce choix.
Auparavant, la communauté scientifique se divise entre les utilisateurs du terme énergie (anglais, pour la plupart) et ceux de force (en général, allemands).
Ce dernier n’apparaît dans le vocabulaire de la physique qu’au 17e siècle, durant lequel il supplante le terme latin vis. La ligne de partage des eaux entre ces deux derniers termes correspond à celle du choix de la langue scripturaire, force (du bas latin fortia « acte de force ou de courage », de fortis « fort ») étant l’équivalent vulgaire de vis.
En effet, vis se structure sémiquement comme suit :
-
force, vigueur, puissance et plus particulièrement la force physique et morale (vertu),
-
violence, emploi de la force,
-
force des armes et les forces armées,
-
essence, caractère essentiel,
-
quantité, multitude, abondance.
En ceci, le terme latin possède la même structuration sémique que force en anglais.
Le terme force entre en anglais au 13e siècle par emprunt à l’ancien français force ou au latin fortia. Durant le moyen anglais, il désigne tout d’abord la force physique, puis morale, et l’intensité d’un effet. À la fin du 15e siècle, il sert à dénoter l’usage de la violence sur une personne ou une chose. Au 16e siècle, le nom prend le sens de « pouvoir d’affecter, d’influencer ou de contrôler » et s’emploie à propos d’une chose. À la même période, il désigne la force de frappe, la force armée. Au milieu du 16e siècle, il renvoie au caractère essentiel d’un document, d’un texte, d’une phrase, d’un symbole. Au 18e siècle, force désigne une grande quantité (they came in force : « ils sont venus en force »).
En grec, ενεργεια est la réalisation de l’être présent, l’activité immanente, actualisation au cours de laquelle la matière reçoit une forme. Il sera emprunté par le latin tardif et sera adapté sous la forme energia, puis, passera en français sous la forme énergie. L’anglais du 16e siècle l’empruntera au sens de « force ou vigueur d’expression ». C’est au 17e siècle que le nom adapté en energy prend le sens de « capacité de produire un effet » et « pouvoir exercé de manière active et efficiente ». Au 18e siècle, le nom prend le sens de « vigueur d’action ».
On constate que force et energy possèdent le même sème microgénérique /capacité physique/. ’Force’ se différencie de ’energy’ par le sème spécifique /intensité/ ; d’autre part, ’energy’ possède le sème spécifique /efficience/ qui le différencie de ’force’. Enfin, ’energy’ possède le sème spécifique /production/ alors que ’force’ possède le sème spécifique /modification/.
| ’force’ | ’energy’ |
| /intensité/ | /efficience/ |
| /modification/ | /production/ |
Le sème /intensité/ suppose une variation. ’Force’ possède donc le sème macrogénérique /+ changement/, ce qui n’est pas le cas de ’energy’. Il semblerait que ce sème soit à l’origine de l’abandon de force au profit de energy. D’autre part, le sème spécifique /production/ correspond à la définition scientifique de l’énergie :
‘ÉNERGIE : Capacité de produire du travail mécanique, appartenant à un corps ou à un système de corps. (Vocabulaire technique et critique de la philosophie).’L’allemand ’Kraft’ (« force, énergie, puissance », « pouvoir, intensité » mais aussi « vertu, efficacité ») peut ou ne pas posséder le sème macrogénérique /+ changement/, ce qui explique son emploi en allemand, y compris dans l’exposé sur la conservation de l’énergie (die Erhaltung der Kraft).
Le latin energia appartient en fait au vocabulaire scientifique depuis le 17e siècle, notamment dans les écrits de Galilée (energia en italien). Le médecin et physicien anglais Thomas Young le ré-utilise en 1803 pour désigner ce que l’on appelait la force vive (l’actuelle énergie cinétique), afin de souligner le caractère invariant de la grandeur désignée, estime Robert Locqueneux (1987 : 49). La même année, le père de Sadi Carnot, Lazare Carnot, utilise le nom travail pour désigner une forme d’énergie définie comme le produit d’une force par son déplacement, terme que le mathématicien français Gustave Gaspard Coriolis officialise en 1829. On constate donc l’évolution terminogénétique du siècle : ενεργεια « force en action » est dérivé de εργον « travail », ou « acte de force, efficacité ». Le choix d’un substantif savant – energy ne jouissait alors pas d’une diffusion aussi importante que de nos jours – contraste avec celui d’un substantif issu du lexique de base comme travail. L’adoption d’un mot du vocabulaire intellectuel répond d’une volonté de rupture avec les impressions sensibles, mais aussi avec la pratique anthropocentrique de la discipline (énergie possède moins de collocations humaines que travail). D’autre part, l’origine grecque du terme facilite son passage d’une langue à l’autre et permet non seulement d’éviter une fausse heuristique, mais également une mauvaise transposition interlinguistique496.
Le choix du terme Entropie (du grec εντροπη « transformation ») par Rudolph Clausius (in Abhandlungen über die mecanische Wärme Theorie, 1850) est lié à la relation que le concept ainsi dénoté entretient avec celui d’énergie. Ce physicien allemand constate que la chaleur ne peut passer d’elle-même d’un corps plus froid à un corps plus chaud sans cause externe. Il s’agit donc d’une découverte opposée au premier principe de la thermodynamique, qui postule une conservation de l’énergie. L’énergie qui ne peut être convertie en travail se dégrade, ou, en d’autres termes, l’entropie augmente. Si dans un système isolé, l’énergie est une quantité constante, l’entropie ne peut que croître, ou demeurer constante à l’état d’équilibre. En d’autres termes, l’entropie est une quantité en augmentation.
À l’époque de sa création, le terme entropie est interprété comme « retour en arrière ». En effet, εντροπη est issu deτροπος, deτρεπειν qui signifie « tourner » et de ε n « en, qui est dans », d’où la glose moderne liée à l’interprétation intuitive du phénomène comme un retour en arrière (de la chaleur). Il semblerait que la motivation du terme soit davantage dans le sème /gradation/, qui s’oppose au sème /constance/, afférent, car lié à l’acception scientifique de ’énergie’.
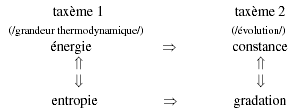
La paradigmatique ne se fonde pas sur l’acception notionnelle, mais sur l’acception conceptuelle. Le sème afférent /constance/, qui différencie les deux acceptions, suppose le sème macrogénérique /+ quantité/. Or, selon James Clerk Maxwell, le vocabulaire spécialisé se différencie du vocabulaire courant par la présence d’une mesure numérique (cf. Girolamo Ramunni (1988 : 137)), ou, en d’autres termes, le sème macrogénérique /+ quantité/ génère le sème générique afférent /langue scientifique/. Ainsi, ’entropie’ possède les sèmes macrogénériques /+ quantité/ et /+ changement/.
L’utilisation d’un élément du vocabulaire intellectuel dans un champ terminologique est motivé par des sèmes notionnels entretenant certaines similitudes avec des aspects prégnants de la définition conceptuelle. Les termes créés par paradigmatique ne sont pas motivés par un sème qui leur est inhérent, mais à un sème spécifique afférent lié à l’acception terminologique de l’élément du taxème à l’origine de la paradigmatique497. On peut donc considérer qu’il a une motivation relative sémique, soulignée par la motivation relative phonétique498 :
‘je proposerai donc d’appeler S l’entropie du corps, d’après le nom grec εντροπη, transformation. C’est à dessein que j’ai formé ce mot entropie, de manière qu’il se rapproche autant que possible du mot énergie ; car ces deux quantités ont une telle analogie dans leur signification physique qu’une certaine analogie de dénomination m’a paru utile (Clausius ; cité par Ramunni, 1988 : 148).’Il est surprenant de constater que Clausius adopte ici les préceptes de Humboldt :
‘Les mots étant toujours couplés à des concepts, il est naturel d’utiliser les voisinages phonétiques pour désigner les voisinages conceptuels. À toute perception, plus ou moins distincte, par l’esprit, de la généalogie du concept, doit correspondre alors une généalogie phonétique, en sorte qu’il y a convergence, pour ce qui touche à l’affinité, des uns et des autres (Humboldt, Introduction à l’OEuvre sur le Kavi, 17 ; 1835 : 213).’De l’analyse de ces deux termes de thermodynamique, il convient de montrer qu’il n’y a pas d’opposition entre le principe de dénomination métaphorique et celui de l’emprunt savant. Les procédés liés à l’adoption des langues classiques (facilité de traduction, caractère cryptique, composition à caractère prédicative) peut s’allier au choix de la métaphore (dénomination d’entités insécables, ou encore renvoyant à des réalités inconnues ou difficilement appréhendables), voire à la paradigmatique (motivations relatives phonétique et sémique).
Si un sème inhérent d’acception « courante » préside au choix d’un terme, le sème afférent socialement normé lié à la définition conceptuelle est à l’origine du choix d’un nouveau terme inclus dans le taxème. L’emprunt permet alors de sélectionner le sème-cible, sans parasitage des autres sèmes du mot, comme c’est le cas pour les mots issus du vocabulaire d’orientation générale. Il convient de noter que le choix de termes du fond classique réactive la dimension étymologique des emprunts plus récents par le biais de la paradigmatique. Il semblerait, pour reprendre la dichotomie de A.-J. Greimas, que les motivations figuratives des transferts anthropocentrés cèdent peu à peu la place à des motivations thématiques (cf. François Rastier (1987 : 117)). Ainsi, Lazare Carnot ou Coriolis – qui sont par ailleurs des ingénieurs de formation – choisissent des termes du vocabulaire courant. En revanche, William Thomson et Clausius optent pour un terme issu du fond classique (Entropie), ou, qui bien qu’adopté par les langues modernes, appartient au vocabulaire intellectuel (energy)499. D’autre part – et cet argument est le corollaire de l’argument en faveur de l’emprunt métaphorique – les termes issus du fond classiques s’exportent beaucoup plus facilement, et évitent la distorsion de sens liée à la traduction.
Étudions maintenant le caractère heuristique de termes métaphoriques créés à partir de sémèmes-sources savants. Le mathématicien et astronome irlandais Hamilton, polyglotte et latiniste averti, crée les termes vector (= vecteur, 1848), scalar (= scalaire, 1848) et tensor (= tenseur, 1853). Le vecteur et le scalaire constituent les deux parties des quaternions, nombres à quatre dimensions (w+xi+yj+zk, où w, x, y, z sont des nombres réels ; w est le scalaire du quaternion, xi+yj+zk en forment le vecteur) (de quaternio : en latin, groupe de quatre). Quant au tenseur, il s’agit de l’extension de la notion de vecteur.
Le terme radius vector (= rayon vecteur, d’après le latin) entre dans l’anglais de l’astronomie en 1753 pour désigner un segment de droite joignant un foyer (le plus souvent le centre du soleil) à une planète, puis est appliquée à la géométrie en 1796 pour désigner une droite reliant un point à une courbe. Hamilton emprunte l’adjectif du syntagme terminologique pour désigner une quantité orientée et matérialisée par une ligne reliant le point de départ et le point d’arrivée. En effet, vector signifie en latin « passager, celui qui transporte », de vehere « aller en char, transporter en char », sens qui n’a pu échapper à ce philologue émérite qu’est celui que l’on appelait le « Lagrange irlandais ». Le terme scalar est un emprunt au latin scalaris « de degrés, d’escaliers », dérivé de scala « échelle ». Hamilton traduit ainsi la notion d’échelle de valeur, de mesure sur une échelle graduée. C’est par le sème microgénérique /orientation/ que l’on instaure le lien entre les deux termes, qui appartiennent a priori à des taxèmes différents.
’scalar’ possède le sème inhérent /verticalité/ qui actualise le sème afférent /horizontalité/ de ’vector’.
En ce sens, ils semblent être une représentation mentale d’un repère graphique :
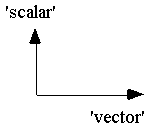
Les quaternions ne possédant pas de représentation graphique, il semblerait que ce sont les sèmes /verticalité/ et /horizontalité/ qui permettent une représentation mentale du concept, ou du moins l’opposition entre les deux composantes des quaternions.
Mais au plan conceptuel, le vecteur se différencie du scalaire en ce qu’il est une grandeur orientée. Il y a eu dissimilation du sème /verticalité/ de ’scalar’, et actualisation du sème /valeur/. Il y a donc une différence de sens. Dans ’Vector’, le sème afférent /horizontalité/ est généralisé en sème /orientation/ (liés aux notions de départ et d’arrivée), qui devient inhérent dans la définition conceptuelle. Dans leur utilisation mathématique, ’vector’ et ’scalar’ appartiennent au taxème //grandeur//. Le sème /valeur/, spécifique, étant subsumé par le sème microgénérique /grandeur/, on peut considérer que ’scalar’ possède une faible densité sémique. Le sème inhérent /orientation/ est donc la motivation de ’vector’, puisqu’il permet la spécification de cette grandeur par rapport à ’scalar’. Ce qui différencie les vecteurs des scalaires est donc leur orientation :
sg /grandeur/
Sps : /non orientée/ Spv /orientée/
Le terme tensor a été créé directement d’après le latin. Tensor vient de tendere « tendre », mais aussi « se diriger, tendre vers, se diriger vers, se porter vers ». Le sème /extension/ qui motive le choix du terme vient confirmer l’hypothèse d’une heuristique spatialisante, et laisse émerger une isotopie macrogénérique assurée par le sème macrogénérique /espace/. De surcroît, l’analyse naïve de ’tensor’ fait apparaître la même motivation que ’vector’, à savoir le sème afférent /horizontalité/.
Une analyse plus approfondie laisse cependant émerger le sème /orientation/, inhérent en latin (contrairement à ’vector’). Sa récurrence dans le couple ’vector’/’tensor’500 lui donne une prégnance qu’il n’avait pas dans le seul sémème ’vector’501. On constate cependant – qu’il s’agisse d’interprétations naïves ou de définitions terminologiques – que les motivations des termes ne sont perceptibles que pour un lecteur qui maîtrise le latin. L’impasse qui conduit à choisir entre heuristique fausse et métaphore opaque semble trouver sa solution dans l’isotopie502.
Le procédé métaphorique ne semble pas plus transparent que la construction exogénique savante et (plus ou moins) systématisée. En effet, pour qui maîtrise les règles de construction terminogénique de la discipline, ou qui a recours à un travail d’inférence paradigmatique, la motivation des mots construits est relativement accessible. En revanche, les catachrèses ne laissent émerger l’isotopie que pour qui domine le latin. Certes, en ce milieu de 19e siècle, c’est encore chose courante dans les cursus. Mais là encore, il semble qu’un surcroît de connaissances encyclopédiques soit nécessaire. Ainsi, l’isotopie macrogénérique évoquée ci-dessus, fruit de l’interprétation naïve, fournit une motivation autorisant une représentation mentale qui facilite la saisie notionnelle du concept en cours d’intégration. Elle s’avère cependant fausse par rapport à la réalité conceptuelle : les quaternions ne possèdent pas de représentation graphique possible, dans la mesure où ils appartiennent à des espaces à quatre dimensions (rappelons que la feuille est l’équivalent d’un plan, et ne possède que deux dimensions). L’isotopie microgénérique laisse affleurer la saisie conceptuelle, et permet de faire apparaître les motivations liées aux acceptions scientifiques. Mais on quitte dès lors le domaine de l’heuristique, dans la mesure où les sèmes afférents permettent de décoder la motivation. Dans son analyse des travaux de Husserl, Paul Ricoeur souligne la limitation du discours métaphorique :
‘la visée signifiante du concept ne s’arrache aux interprétations, aux schématisations, aux illustrations imageantes, que si l’on dispose d’avance d’un horizon de constitution, celui du logos spéculatif. En vertu de cette ouverture d’horizon, le concept devient capable de fonctionner sémantiquement par les seules vertus des propriétés configurationelles de l’espace dans lequel il s’inscrit (Ricoeur, 1975 : 382).’On pourrait alors inverser l’assertion de l’auteur de La métaphore vive. Si Paul Ricoeur (1975 : 251-252) attribue à la métaphore un pouvoir conceptuel appréciable, au sens où elle procède par recatégorisation, et permet, par la transgression ainsi effectuée, de redécrire le monde, ce processus est à usage quasi unique. La valeur heuristique de la métaphore, si souvent invoquée, n’existe que pour qui travaille sur le même sujet dans le même contexte503, et les informations qu’elle fournit ne se rapportent qu’aux procédures de pensées des créateurs.
En effet, cette saisie préconceptuelle, ce schématisme de la pensée en acte, qui laisse affleurer les lignes de construction des théories (cf. Paul Ricoeur (1975 : 253-254)), disparaît avec l’organisation du champ conceptuel (Ricoeur, 1975 : 380) ; la systématicité des articulations des discours spéculatifs remplace la schématisation de l’assimilation du discours prédicatif (cf. Paul Ricoeur (1975 : 382)). L’apprenant ou le scientifique d’une autre culture ou d’une autre époque qui étudie le même objet scientifique utilisera les définitions systématiques et n’aura pas recours à la motivation dans son maniement du concept. Ce point de vue est décelable dans cet aphorisme de Max Black qui estime que toute science commence par la métaphore et s’achève avec l’algèbre. Didier Nordon (1981 : 69) avance qu’au nom de l’heuristique, les mathématiciens préfèrent avoir recours aux mots courants pour dénommer les nouveaux objets mathématiques, en raison de leur transparence (voir également Nicolas Bourbaki (1960), Jacques Hadamard (1945), Henri Poincaré (1902, 1905)). Mais les témoignages évoqués demeurent d’une validité toute relative, dans la mesure où ils sont le fait de spécialistes. D’autre part, l’analyse de ces témoignages montre que les scientifiques eux-mêmes ne perçoivent pas, ou perçoivent mal la motivation de certains termes (cf. infra ; Jean Dieudonné ne perçoit pas la motivation de tribu, et fait une interprétation naïve de celle d’anneau). En d’autres termes, la métaphore ne donne pas le sens d’un mot, mais la manière dont la réalité est appréhendée par son créateur.
Ainsi, si l’on s’intéresse à certains termes mathématiques métaphoriques (ensemble (1847), anneau (1897), groupe (1830), couple (1903), corps (1871), classe (1903), tribu, clan (à partir de 1939, puisque attribués au groupe Bourbaki), loi, neutre, affinité (fin 19e)), on constate que leur utilisation n’entraîne pas la disparition de l’ordre métaphorique, sans pour autant faire apparaître ce que Paul Ricoeur (1975 : 379) appelle l’esquisse sémantique originelle.
Le terme Menge « ensemble » est utilisé pour la première fois en 1847 par Bolzano, mathématicien et théologien germanophone d’origine tchèque, dans son opuscule Paradoxien des Undendlichen, publié en 1851. Vers 1880, Georg Cantor, créateur de la théorie des ensembles (Megenlehre) influencée en de nombreux points par l’oeuvre de son prédécesseur qu’il connaît depuis 1870, adopte ce terme au détriment de celui de Mannigfaltigkeiten (1872) « multitude, diversité » qu’il utilisait jusqu’alors504. Menge, issu du germanique et vraisemblablement doté de la même racine que magma, apparaît avant le 8e siècle sous la forme managi, puis men(e)ge, du pronom manch, qui signifie « main, certain, tel, plus d’un ». Mais s’il signifie « quantité, multitude », il peut aussi prendre le sens de « tas, amas » dans un sémantisme quantitatif, et, secondairement, matériel dans l’expression mitten in der Menge : « au plus épais de la foule », ou le substantif Menschenmenge « foule, cohue » (en d’autres termes, « un amas de personnes »). En ceci, il est l’équivalent de l’expression française « un tas de ». De même, les verbes mengen, vermengen veulent dire « mélanger, mêler » (Menggestein « conglomérat » en géologie), les substantifs Gemenge et Menge signifient « mixture, mélange », sémantismes que l’on retrouve dans le grec magma qui désigne une grosse galette d’orge mêlée d’huile et d’eau, de μασσειν « pétrir », et μαξι qui signifie « ensemble ». À noter que certains ensembles sont parfois appelés magmas.
Ce choix renvoie à la perception d’une forme sur un fond, ou Gestalt. L’abandon du terme Mannigfaltigkeit souligne le passage d’une approche totalisatrice – i.e. additive – à une approche totalitaire – i.e. ensembliste –, ou, en d’autres termes, d’une approche analytique (un ensemble est la somme de ses parties) à une approche synthétique (un ensemble est le sous-ensemble d’un ensemble plus vaste). Dans l’infini du continu émergent des formes, issues d’une discontinuité qualitative comme l’indique la définition qu’André Delachet & Michel Queysanne donnent du concept d’ensemble :
‘En mathématiques, on désigne sous le nom d’ensemble une collection d’objets ou d’êtres arbitraires (...). L’essentiel est de définir les éléments de cette collection d’une façon suffisamment précise pour qu’on puisse les distinguer d’autres éléments auxquels ils peuvent être mêlés (Delachet & Queysanne, 1955 : 65).’Cette hypothèse est confirmée par la subdivision des multitudes en deux classes effectuée en 1899 par celui que Leopold Kronecker qualifia de corrupteur de la jeunesse : les multiplicités consistantes, qui peuvent être rassemblées en une unité, et qui donnent naissance aux ensembles, et les multiplicités inconsistantes, qui ne peuvent être conçues comme un objet unique sans contradiction. Il emprunte ce terme au logicien allemand Friedrich Schröder, qui l’utilise depuis 1895 (Vorlesungen über die Algebra der Logik ), à la suite des travaux de Christine Ladd-Franklin, logicienne américaine qui parle d’inconsistance (inconsistency) pour désigner une expression logiquement fausse (On the Algebra of Logic, 1883). Le terme est issu de la préfixation par le latin in-, préfixe négatif, de consistere de cum (« avec ») et sistere (dérivé de stare signifiant « placer, poser, (se) mettre, établir », mais aussi « comparaître devant un tribunal » et « (s’)arrêter »), qui reprend structuration sémique de sistere :
-
se mettre, se placer, se poser,
-
s’arrêter,
-
se tenir [de façon compacte, solide, par étroite union des éléments].
En anglais, le verbe to consist passe du sens de « rester ferme » à « exister », et, de là, à « avoir un type d’existence particulier », « avoir des qualités inhérentes particulières » ; au moment de son emprunt (16e siècle), il signifie « être composé de ». Le nom, outre l’emploi issu du troisième sémème de consistere, possède le sens « cohérence, uniformité ». À ce propos, il est signalé dans le Vocabulaire technique et critique de la philosophie que consistency est moins fort en anglais que coherence ou coherency (qui veulent également dire « cohésion » en physique). Une théorie consistante est une théorie non contradictoire, c’est-à-dire dont on ne peut prouver la déductibilité simultanée d’une formule et de sa négation. Il s’agit d’une différence de sens, comme l’indique cette remarque du Vocabulaire technique et critique de la philosophie :
‘Le mot anglais consistency au sens logique, vise uniquement l’accord de la pensée avec elle-même (to consist, s’accorder). Le mot français évoque de plus l’idée d’un contenu de pensée bien déterminé, d’une thèse qui se tienne, par analogie avec le sens physique du mot consistance, qui est le plus fondamental de notre langue. Peut être même l’idée de simple cohérence logique s’y est-elle introduite qu’à l’imitation des mots to consist, consistency (Vocabulaire technique et critique de la philosophie, note additive à l’article « Consistance »).’En français, il convient davantage de parler de différence d’acception, dans la mesure où le trait /accord/ n’apparaît que dans le terme, et ceci par calque sémantique de l’anglais, ce qui explique l’utilisation conjointe des termes consistance et non-contradiction. En effet, en français, consistance qui signifie « état d’un corps relativement à sa solidité, à la cohésion de ses parties » (PR) est d’abord synonyme de matière (14e siècle), puis, dès 1580, prend le sens d’« état de ce qui est ferme, solide », au sens de « immobilité, fermeté » ; l’emploi « état de fermeté d’un corps matériel » est enregistré en 1690 (RHLF). Seul l’emploi figuré dans des expressions comme un esprit sans consistance (i.e. « irrésolu ») renvoie au second sens anglais. C’est également le cas en allemand, où Widerspruchsfreiheit (littéralement « exemption de contradiction ») coexiste à Zusammenhang (« cohésion, continuité, corrélation, ordre »), terme influencé par le second sémème anglais, en ce sens qu’il n’accepte que des emplois figurés.
Il semblerait que ce soit le dernier sémème de consistere qui ait déterminé le choix de Georg Cantor :
D’autre part, il convient de noter que le même Cantor emploie dès 1879 l’adjectif dicht « épais, dru, touffu, serré, compact » pour qualifier certains ensembles (un ensemble A est dense (dicht) par rapport à B si tout point de B est un point adhérent à A ; i.e. si ces points font partie du voisinage des points de A ; ainsi, l’ensemble des rationnels est partout dense par rapport à l’ensemble des réels car il existe une infinité de rationnels entre deux réels). Les premières recherches de Cantor en trigonométrie et sur l’arithmétisation de l’infini appartiennent au domaine de l’analyse. En cela, il fait partie d’un courant mathématique du 19e siècle qui concourt à arithmétiser l’analyse – c’est-à-dire à élaborer une théorie des réels loin des bases intuitionnistes de la géométrie – et qui privilégie l’étude des relations et des propriétés des ensembles des entiers et des nombres rationnels. La définition d’un ensemble abstrait par Cantor porte essentiellement sur le sème /cohésion/. Cette approche est donc agrégative. Fraenkel, dans son ouvrage de 1953, Abstract set théorie, parle d’agrégat (aggregate), terme qui semble être une meilleure traduction de Menge que set « collection, jeu, assortiment », qui renvoie à une somme d’individualités, à une totalité et non à une totalisation, et qui ne respecte pas complètement le sémantisme agrégatif (au sens d’adhérence, d’ailleurs utilisée dans le domaine) du terme de départ : l’expression a set of renvoie aux individualités, et non à la multitude (au sens où elle constitue un être collectif), à la masse.
Le mot set est issu du latin secta via l’ancien français sette « groupe de gens » (14e siècle). Le sens actuel émerge au 16e siècle, sous l’influence du verbe to set, aspect causatif du verbe d’origine germanique to sit, dont le sens actuel est « poser, placer (ensemble) ».
Le terme est traduit en français par le substantif ensemble (1890). Issu du latin impérial insimul « à la fois, en même temps », cet adverbe sera substantivé en 1664 dans l’expression un tout-ensemble qui désigne, en art, l’unité d’une oeuvre générée par la bonne proportion de ses éléments. Au 18e siècle, l’adverbe substantivé prend le sens de « unité tenant au synchronisme des mouvements et à la collaboration des divers éléments » (PR) (et tout d’abord en parlant d’un corps de troupe : manoeuvrer avec un bel ensemble). Au milieu du 19e siècle, le sens est élargi à « la totalité des éléments constituant un tout » (PR) (l’ensemble de son oeuvre), puis, à la fin du siècle, aux « groupes de personnes, de choses réunies en un tout » (un ensemble architectural) (RHLF). L’analyse rapide de l’évolution du signifié montre clairement que les sémèmes perdent en compréhension pour gagner en extension : le sème /cohésion/ est omniprésent, mais le critère de perception des éléments en une unité (proportion, synchronisme et collaboration, constitution d’un tout) disparaissent peu à peu. Parallèlement, on constate que le mot qui s’applique tout d’abord à des objets uniques (une oeuvre, un corps de troupe), est peu à peu imputé à une multiplicité d’objets dont le facteur de cohésion n’est pas spécifié. C’est ce qui fait dire à René Baire en 1909 :
‘Le mot ensemble, à cause même de sa simplicité et de sa généralité, ne parait pas susceptible d’une définition précise. Tout au plus peut-on le remplacer par des synonymes, tels que collection, assemblage d’un nombre fini ou infini d’objets, ces objets étant en général des êtres mathématiques de même nature, tels que des nombres, des points de l’espace, des fonctions [...] (cité par Itard ; in Bouveresse, Itard & Sallé, 1977 : 120).’Alors que Menge possède un noyau sémique de /multitude/, ensemble renvoie plutôt à l’idée de structure, même si cette dernière disparaît peu à peu dans les sémèmes qui viennent s’adjoindre au signifié. Il convient de noter qu’insatisfait de la traduction française, Henri Poincaré lui préfère le terme originel de Menge. En fait, la traduction la plus proche de Menge serait, en français, masse, car, comme en anglais, le sème /agrégat/ ou /adhérence/ n’apparaît pas dans ensemble.
Le terme groupe, créé par le mathématicien français Évariste Galois en 1830, offre un certain nombre de similitudes avec Menge 506 . D’origine francique, ce terme est issu de °kruppa qui signifie « jabot, panse, bosse, masse arrondie ». Ce sémantisme est présent dans l’évolution de °kruppa en croupe, forme sous laquelle il est apparu en français. Groupe n’entrera en français qu’en 1668 par l’emprunt à l’italien du terme gruppo (fin 15e - début 16e siècle). Il apparaît dans la langue avec le sens italien : « réunion de plusieurs personnages, formant une unité organique dans une oeuvre d’art » (PR). Cette acception renvoie à un espace visuel, que l’on retrouve dans les collocations « groupe des trois Grâces », ou, plus tard « groupe d’arbres » (Chateaubriand) comme dans les définitions de bosquet (« groupe d’arbres plantés pour l’agrément » (PR)).
Le noyau sémique de groupe renvoie à une Gestalt, une forme se détachant sur un fond. À la discontinuité visuelle des premiers emplois succède une discontinuité qualitative que l’on retrouve dans le sens « réunion d’éléments formant un tout ». En effet, le mot groupe prend l’acception « ensemble d’êtres ou de choses ayant des caractères communs, qu’on utilise pour les classer », et, de là, « ensemble de symboles, de signifiants ayant une unité » (1732, en musique (RHLF)), puis celle de « ensemble de personnes ou de choses réunies en un même lieu », et à la fin du siècle « ensemble de personnes ayant un point commun (opinions, goûts, etc..) » (RHLF). De même, au 16e siècle, Menge prend le sens de « rassemblement, réunion de personnes », puis l’emploi « groupe social », et c’est au 17e siècle qu’il adoptera le sens « grande quantité ». Dès lors, il apparaît que les deux termes possèdent un sémantisme social, lié, le plus souvent, à des collocations. Groupe sera traduit par group en anglais et Grüppe en allemand, lexèmes qui possèdent une structuration sémique similaire. Cependant, alors que Menge suppose une fusion des éléments par adhérence, groupe implique un critère de réunion, à l’origine d’une classification.
L’évolution sémantique de ce dernier terme nous montre le développement parallèle de deux séries de sémèmes lié à ces deux traits dominants :
-
Ensemble de choses formant un tout (spatialement, auditivement, fonctionnellement) : arts (groupe en marbre, groupe des pharisiens), linguistique (groupe de mots), orthographe (groupe de lettres), musique (groupe de notes), armée (groupe de combat).
-
Ensemble de choses ayant une chose en commun (caractéristique, but, utilisation) : médecine (groupe sanguin), économie (groupe de pression, groupe financier), politique (groupe parlementaire), sociologie (groupe d’appartenance), arts, littérature et musique (groupe surréaliste, groupe des XX), technologie (groupe électrogène), sciences (groupe biologique, chimique, des langues sémitiques)507 508
Dès lors, ce qui différencie groupe de Menge, c’est la notion de structuration, ce qui, étant donné les origines mathématiques différentes de ces deux termes, est pleinement justifié. En effet, la notion de groupe est une notion algébrique, c’est-à-dire qu’elle est issue de la partie des mathématiques qui s’oriente alors vers l’étude des relations et des structures mathématiques abstraites. Les deux termes, bien que choisis indépendamment, représentent pleinement l’opposition entre les deux concepts mathématiques. En effet, Jean Itard souligne :
‘Un ensemble, pris dans un sens général, est un objet a priori informe qui ne prend quelque consistance qu’une fois structuré. Deux ensembles de même puissance509, comme celui des entiers positifs et celui des rationnels positifs, se distinguent l’un de l’autre par leurs propriétés caractéristiques ou ce que l’on appelle leurs structures (Itard ; in Bouveresse, Itard & Sallé, 1977 : 121).’Au nombre de ces structures figurent les structures algébriques, auxquelles appartiennent les monoïdes, les groupes, les anneaux et les corps, qui se définissent par le nombre de lois de composition interne dont elles sont dotées et par les caractéristiques de ces dernières (associativité, commutativité, existence d’un élément neutre pour ces lois).
En logique, le point le plus caractéristique de la notion de groupe (notée (< E, o, = >) ; où E est un groupe, o la loi de composition interne de ce groupe, et = la relation d’égalité) est, selon Jean-Blaise Grize (1967), l’existence d’un inverse (x’) associé à tout élément de la structure. En effet, celui-ci garantit le retour possible à un point de départ, et, par là même, une cohérence de l’ensemble :
Si pour tout x de E, ∃ (il existe) x’ tel que : x o x’ = e
ou x’ o x = e
où e est l’ élément neutre de la loi de composition interne (c’est-à-dire que x o e = x ou e o x = x )
Ainsi, pour tout x, y, z de E, x o y = z => x’ o z = y et z o y’ = x
Il est donc toujours possible de retrouver x à partir de z et de y, et y à partir de x et z (cf. Jean-Blaise Grize (1967 : 276-277)).
Cet inverse est appelé plus globalement un symétrique, ce qui signifie « réversible » en logique. Cette dénomination, fruit des origines géométriques de l’algèbre, est pleinement perceptible dans un repère orthonormé où l’élément neutre serait choisi comme origine.
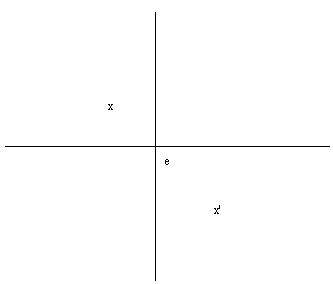
La symétrie algébrique est donc une symétrie ponctuelle métaphorique dans laquelle l’élément neutre occupe la fonction de point de symétrie.
Le terme est issu du grec συμμετρια « proportions, justes ou agréables proportions, commensurabilité » et a rarement le sens moderne. Cette notion de juste proportion, intimement liée à celles d’harmonie et de symétrie, est un point récurent des obsessions humaines, que l’on retrouve dans les arts, mais aussi dans l’organisation de la société : Platon, pour qui l’ordre et l’arrangement sont les deux traits qui donnent unité et valeur à l’homme mais aussi à la cité, veut étendre à la politique la notion d’égalité géométrique, et donne un fondement mathématique au tissu social. Daniel Parrochia souligne que, selon l’auteur de La République :
‘le législateur, s’il veut instaurer une véritable « harmonie » dans la cité, ne devra jamais se départir de l’ordre dont les nombres sont les Principes (Parrochia, 1991 : 36).’La notion de neutralité, acceptée depuis le 14e siècle, était appréhendée à la Renaissance comme le devoir des non-belligérants d’un conflit de rester impartiaux, sauf si l’une des deux parties violait le droit des neutres. Le juriste et homme de lettres hollandais Grotius fait entrer cette notion en philosophie politique (1625) ; au 18e siècle, elle sera développée dans son aspect juridique par Cornelius van Binkershoek, qui estime que les notions de justice et d’injustice ne concernent pas les neutres. Le terme élément neutre est traduit par calques dans les différentes langues (neutral element (anglais), neutrales Element (allemand)).
L’adjectif neutre est emprunté au latin neuter (utilisé en grammaire au sens de « ni masculin, ni féminin »), de ne uter « ni l’un ni l’autre ». Au début de la Renaissance, il est emprunté par les principales langues européennes dans son sens grammatical, et de là, entre dans les sciences naturelles (17e siècle). En zoologie et botanique, la notion abstraite de genre neutre se concrétise par la notion d’asexuation. Parallèlement à ce sens de nature grammaticale, se développe, à partir de la fin de la Renaissance, le sens « absence de parti », d’origine politique et juridique que l’on retrouve en chimie à partir de la fin du 17e siècle (neutre : « qui n’est ni acide, ni basique »), et dans diverses sciences au 19e siècle (électricité : « qui n’est ni positif, ni négatif » ; optique : « ne présentant aucun phénomène de polarisation » ; mécanique : « point où les forces d’extension et de compression sont en équilibre »). Le sens mathématique de ’neutre’ est clairement associé à la notion de droit international puisqu’un élément neutre n’intervient en aucune façon dans la transformation que la loi de composition interne fait subir à l’élément mathématique :
e est l’élément neutre de la loi de composition interne si :
x o e = x ou e o x = x
Le troisième élément définitoire des structures de groupe est l’associativité de la loi de composition interne, c’est-à-dire que :
x o (y o z) = (x o y) o z = x o y o z (1)
Le terme associativité (« caractère de ce qui est associatif », i.e. « de ce qui est relatif à l’association, la réunion ») est un terme iconique dont la motivation est aisément décelable à l’observation de l’égalité (1) : y peut être associé à z, et x à y sans que le résultat de l’opération en soit affecté. Mais la motivation de ce terme ne s’éclaire pleinement que lorsque l’on s’intéresse à son étymologie.
Le terme Associativity est créé par Hamilton en 1843 à partir du verbe latin associare, de ad « à » et socius « allié, partenaire, compagnon ». L’adjectif associate est entré dans le moyen anglais au sens de « lié par la camaraderie, la fonction, la dignité ». Au 17e siècle, il signifie « allié », et, au siècle suivant, « uni dans le même groupe ou la même catégorie ». Il est utilisé absolument au 16e siècle et désigne alors le partenaire, le compagnon, le camarade, le compagnon d’arme, puis le collègue, pour enfin dénommer le membre d’une association. Ce nom apparaît, directement tiré du latin médiéval ou par l’intermédiaire du français, au milieu du 16e siècle, et renvoie alors au fait d’associer ou d’être associé, mais aussi à la ligue. C’est au 17e siècle qu’il prend le sens de « corps de personnes réunies dans un but commun ». La notion de combinaison n’apparaît qu’au 19e siècle dans le participe passé associated. Le trait saillant de la famille lexicale est clairement social : les associations sont des groupements d’individus réunis en fonction d’un groupement d’intérêt ; associer quelqu’un consiste à la faire participer à une activité. On constate, à la lecture de l’égalité (1) que le regroupement de facteurs consécutifs n’affecte pas le résultat. Les individus mathématiques concourent, quel que soit leur regroupement (leur association), et le remplacement de celui-ci par le résultat de l’opération partielle effectuée sur eux, à obtenir le même résultat. Outre la communauté d’intérêt, cette absence de hiérarchie opératoire est caractéristique de l’association.
Un groupe est donc défini mathématiquement par des caractéristiques d’harmonie et de cohésion de la loi qui le structure. La collocation spécialisée loi de composition interne (1801) est due au mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss, dont l’approche fait abstraction de la nature des objets étudiés – pour lui, il suffit d’énumérer et de comparer les relations entre ceux-ci. Celui que l’on appelle le prince des mathématiciens écrit en latin et a tiré ce terme du nom compositio « action d’apparier », « composition d’un ouvrage, préparation », mais aussi « disposition, arrangement » et surtout « accommodement d’un différent ». Quant au terme loi, point n’est besoin de démontrer ses origines juridiques. Le terme lex sera traduit en anglais par law et en allemand par Gesetz, substantifs qui possèdent le même type d’acception. La loi de composition est donc la manière d’arranger, de combiner (harmonieusement) les objets mathématiques entre eux.
La cohésion du groupe soulignée plus haut est mise en évidence par le choix des termes algébriques définitoires, tous issus des domaines politique et juridique. Dans les structures d’anneau et de corps, cette cohésion est renforcée.
Les anneaux et les corps sont des ensemble dotés de deux lois de composition interne :
La loi + (addition) est une loi de groupe commutatif, c’est-à-dire que :
x + y = y + x (2)
La loi . (multiplication) est associative et distributive par rapport à l’addition, c’est-à-dire que :
x . (y + z) = x . y + x. z (3)
Dans le corps isolé de l’élément 0, la multiplication forme un groupe.
Tout comme le terme associativité, les termes commutativité et distributivité, créés par le mathématicien français Joseph Servois en 1815, sont dotés d’une motivation aisément décelable parce qu’iconique. Les éléments x et y peuvent être commutés (échanger leur place) sans que le résultat de l’opération en soit affecté. De même, l’élément x, qui est facteur de la somme (y+z), peut être distribué (réparti) auprès de chacun des éléments de cette somme (devenant ainsi le facteur de chacun des éléments de ladite somme) et laisser le résultat invariant ; ce trait est présent dans les acceptions logique et grammaticale de l’adjectif distributif (« qui, dans une répartition d’objets, désigne individuellement » (PR) ; ainsi, chaque est un adjectif distributif).
L’adjectif commutatif est formé par Oresme (vers 1370) sur le latin commutare (« changer entièrement » mais aussi « échanger », de cum « avec » et mutare « muter ») ou sur commutatio (« changement, mutation » et spécialement en rhétorique « réversion, répétition de mots dans un ordre inverse »). Ce terme, comme les autres mots issus de la même racine, est essentiellement utilisé dans des contextes scientifiques et didactiques. Commutation, après avoir été utilisé en ancien français comme synonyme de mutation, se spécialise également en droit au 17e siècle (commutation de peine) entraînant dans son sillage le verbe commuter qui n’entre dans l’usage qu’au 19e siècle ; commutation devient un terme de phonétique au 18e siècle (« substitution d’un phonème à un autre ») (RHLF). On constate que le sème /mutation/ a disparu rapidement au profit du sème /échange/, sème qui semble motiver le choix de Servois.
Le terme distributif est emprunté en 1350 au bas latin distributivus, et employé spécialement en grammaire (cf. supra), puis en droit au 17e siècle. L’adjectif latin est dérivé, tout comme le nom distributio (« division, répartition », emprunté en français sous la forme distribution), du verbe distribuere « répartir, partager, former en répartissant » (de dis- « dé- » et tribuere, dénominatif de tribus, qui signifie « répartir l’impôt (entre les tribus) », puis « accorder, concéder », « attribuer, affecter, répartir »). Le verbe distribuer entre dans la langue française sous la forme destribueir (1248), et prend sa forme actuelle en 1362, période à laquelle il signifie « donner une chose à plusieurs personnes prises séparément ». Au 16e siècle, il prend le sens de « répartir d’une certaine façon », puis, au 17e siècle, celui de « disposer, aménager ». Le nom distribution est clairement influencé par ce dernier emploi dans ses acceptions spécialisées : en architecture « agencement, disposition » (1547), en sciences naturelles « classer selon un certain ordre » (disposer dans une classification) (1749) (RHLF). Cependant, son entrée dans la langue française (1350) est marquée par son sens contributif, d’ordre étymologique. Le sème saillant de cette famille lexicale est /répartition/, et il se montre très actif dans l’emploi mathématique. Il convient également de signaler l’appartenance du terme au domaine /politique/.
En effet, dans sa philosophie politique, Platon distingue deux types d’égalités : celle qui distribue la même part à tous, et celle qui distribue à chacun en proportion de sa nature, seule forme d’égalité qui réalise l’équité (Les Lois). La définition de la justice comme une égalité de proportion est récurrente chez les philosophes grecs, et trouve son point d’aboutissement avec Aristote. Il donne une définition légale et égale à cette valeur, qu’il juge caractéristique de l’être humain, et détermine trois types de justices : la justice corrective, la justice commutative et la justice distributive. Cette dernière ne repose pas sur une égalité absolue, et consiste à rechercher l’égalité sociale par une distribution des biens et des honneurs proportionnelle à la valeur de chacun. Cette égalité proportionnelle qui consiste à traiter inégalement des individus inégaux est un des aspects de la recherche aristotélicienne des proportions arithmétiques (a ≠ b mais a/b = c/d). Bacon décèle l’analogie en 1605 :
‘...la règle – si inaequalibus aequalia addas, omniaerunt inaequalia [si tu ajoutes des choses égales à des choses inégales, le résultat sera des choses inégales], n’est pas un axiome aussi bien pour la justice que pour les mathématiques ? Et n’y a-t-il pas une véritable concordance entre la justice commutative et la justice distributive, et, respectivement, la proportion arithmétique et la proportion géométrique ? (...) Est-ce que la magie des Perses ne consistait pas à ramener ou à faire correspondre les principes et les structures de la nature aux règles d’organisation des gouvernements ? (Bacon, Du progrès et de la promotion des savoirs ; 1605 : 113-114).’L’analogie que le chancelier détermine est, bien qu’il s’en défende (puisqu’il ne cite pas Aristote, dont il rejette l’autorité), celle que le Stagirite expose dans son Éthique :
-
Une proportion (ou suite) arithmétique établit des rapports par différence :
a - b = c - d (4)
L’égalité (4) est équivalente à l’égalité a + d = c + b. On peut envisager les éléments d et c comme des choses échangées ; la contrepartie ne sera équilibrée que si b + d (+ signifie « équivalent »). Cette relation d’égalité, valable dans les seuls échanges, est la base même de la justice commutative, qui réside dans « l’égalité des choses échangées, dans l’équivalence des obligations et des charges stipulées dans les contrats » (Vocabulaire technique et critique de la philosophie, article « Justice commutative »). -
Une proportion (ou suite) géométrique établit les rapports par quotient :
a / b = c / d (5)
Il n’est pas nécessaire que b soit égal à d pour que l’égalité soit maintenue, mais plutôt que b ait le même rapport à a que celui que d entretient avec c. Il y a proportion à proprement parler (au sens que ce terme prend au 14e siècle). L’égalité (5) est équivalente a. d = c . b . On peut considérer b et d comme des choses réparties (entre a et c) ; il n’y a maintien de l’égalité que si b et d sont attribués en fonction du poids relatif de a et d. En termes de justice distributive, il y a « répartition des biens et des maux selon le mérite des personnes » (Vocabulaire technique et critique de la philosophie, article « Justice commutative »).
Il est dès lors troublant de constater que Servois a attribué ces deux termes, liés à des notions étroitement associées depuis l’Antiquité510, à des caractéristiques algébriques qui vont souvent de paire. D’autre part, même si Servois n’est pas un aristotélicien reconnu, il est encore plus troublant de voir ces termes, représentant des notions défendues par le père de la métrique du politique, attribués à des phénomènes mathématiques.
Les ressorts de la motivation servoisienne semblent encore plus proches de la définition juridique que l’analogie soulignée par Bacon. En effet, la justice commutative recherche l’égalité dans les échanges, ce qui, au plan notionnel est effectivement vrai dans le cas d’une loi de composition interne commutative : l’échange de places des éléments (i.e. le changement dans l’ordre de l’opération) est égalitaire (i.e. maintient l’égalité). D’autre part, la justice commutative exclut l’intervention d’un tiers ; or, l’égalité (2) est effectuée sans qu’un autre élément soit introduit.
La justice distributive vise une répartition des biens selon le mérite de chacun. Si l’on observe l’égalité (3), on constate que y et z sont tous les deux factorisés par x. Le résultat des deux multiplications partielles (x . y et x . z) est le fruit du seul poids relatif de chacun de ces deux éléments, et la distribution de la manne factorielle (Aristote et Saint Thomas n’appliquent la justice distributive qu’aux seuls biens et richesses) n’affecte pas l’égalité (i. e. maintient l’égalité). Enfin, la justice distributive implique l’intervention d’un tiers, garant de l’équité ; or, l’égalité (3) implique l’intervention d’un tiers : la multiplication. Celle-ci est distributive sur l’addition, c’est-à-dire qu’elle vise l’égale répartition des facteurs sur les deux éléments de la somme.
L’anneau et le corps sont donc deux structures qui visent au maintien de l’égalité et à la stabilité dans les relations entre les éléments qui les constituent. C’est dès lors l’isotopie /cohésion sociale/ qui se dessine dans la définition de ces trois structures algébriques. Cette hypothèse est également validée par les dénominations qui leur sont attribuées.
Anneau est la traduction française de Ring, terme créé par le mathématicien allemand David Hilbert en 1897. Ce terme a globalement la même structuration sémique que ses traductions française et anglaise (ring) :
-
cercle de matière dure qui sert à attacher ou à retenir (oeillet, maillon, chaînon, bouche, bague),
-
ce qui a la forme d’un anneau (cercle, boucle de cheveux, halo de lumière, cernes, aréole),
-
sens figuré appliqué au caractère d’enfermement, privilégié en français (ring de boxe, pool).
L’hypothèse d’une motivation matérielle, qui apparaît a priori, et qui constituerait un affinement des Gestalten suggérées par les termes Menge et groupe, disparaît quand on se reporte à l’intégralité de son sémantisme, souvent non mentionnée par les dictionnaires à l’entrée Ring. En effet, le mot peut également signifier « cartel, trust, syndicat », ou « cercle (au sens figuré) » (sémème qui apparaît en anglais au 19e siècle). En Suisse alémanique, il signifie « commune rurale ». Émerge alors un sémantisme social que l’étymologie du terme justifie. Issu de la racine germanique °hrenga « cercle, en forme de cercle » qui donna l’ancien saxon hring, puis l’ancien haut allemand (h)rinc et le moyen haut allemand rinc, mais aussi l’ancien anglais hring. Le germanique °harihring « rassemblement en forme de cercle » a donné, en français, harangue « discours public (que l’on donne à une assemblée, i.e. à un rassemblement en forme de cercle) » et, par métonymie du contenant pour le contenu, le nom allemand Rang « échelon, position », mais aussi « rang, classe ». Par transfert synecdochique, le groupe est apprécié comme une sous-partie d’un groupe plus important. Une approche structurale fait alors de ce sous-groupe une classe ou un rang. L’histoire de la dénomination terminologique renforce cette hypothèse. En effet, Gauss, qui découvrit cette structure algébrique, l’appela ordo, terme latin signifiant « rang, rangée », mais aussi « rang, classe sociale », sens qui étaye notre hypothèse. Ce terme sera repris par le mathématicien allemand Richard Dedekind sous la forme Ordnen (« rangement, classement ») pour désigner ce qui actuellement dénommé un sous-anneau (Untering, Teilring).
Le terme Körper, créé par Dedekind en 1872 (en français corps ; en anglais field), remonte au même étymon indo-européen °krp- que groupe, et entre dans le moyen haut allemand (13e siècle) par emprunt au latin corpus :
-
corps, cadavre,
-
chair du corps (métonymie du contenant pour le contenu),
-
individu (métonymie de la partie pour le tout),
-
ensemble d’objets ou d’individus.
Cet emprunt a été favorisé par l’Église (avec l’expression corpus christi) et la médecine, deux domaines s’exprimant en latin.
Le mot allemand présente l’organisation sémique suivante :
-
corps (humain),
-
solide (géométrie), physique (corps solide, liquide, gazeux),
-
groupement social (Körperschaft).
Le sémantisme de Körper développe essentiellement l’idée de corps solide, anatomique. En cela, sa structuration sémique est beaucoup moins complexe que celle de son équivalent français. Dans cette langue, le substantif, qui apparaît en 881 pour désigner l’organisme humain, est peu à peu appréhendé sous trois aspects différents qui reprennent globalement la structuration sémique de son étymon latin :
-
par synecdoque de la partie pour le tout, il devient une représentation de l’individu,
-
par synecdoque du tout pour la partie, il représente le tronc, l’abdomen,
-
par métaphore, car le corps représente un ensemble organisé d’organes, il renvoie à toute organisation à caractère plus ou moins structuré.
Le corps humain, considéré sous ses différents aspects (anatomique, matériel, visuel, comme une métonymie de l’être humain, par opposition aux biens matériels, par opposition à tête, du point de vue de sa motricité et de ses activités, en tant que centre de la sexualité) entraîne l’articulation de
différents sens dans lesquels se répartissent les acceptions spécialisées :
-
Élément-unité clairement délimité : marine (corps flottant, corps morts) ; justice (corps certain; corps du délit) ; religion (corps du christ ; en tant que la substancialisation de Dieu) ; anatomie (« élément anatomique présentant une relative indépendance liée à sa constitution cellulaire, sa fonction ») ; médecine (corps étranger) ; astronomie (corps céleste, corps planétaire).
-
Partie (centrale ou principale) d’une chose : marine (corps d’un bateau, corps de voile) ; héraldique (corps d’une devise) ; philosophie, psychologie et religion (vs âme) ; typographie (corps d’un caractère) ; anatomie (« partie centrale ; principale de certains os, muscles ou organes ») ; botanique (corps ligneux) ; architecture civile et militaire (corps de logis, corps de bâtiment, corps d’une place) ; technologie (corps de poulie, corps de charrue, corps de pompe...).
-
Ensemble (unitaire) : biologie (« ensemble des parties matérielles des êtres vivants organisés ») ; marine (corps de voilure) ; justice (corps de preuves); religion (corps de l’Église, corps du Christ (en tant que l’ensemble des chrétiens) ; sociologie (corps social, corps professionnel, corps enseignant, etc.) ; politique (corps constitué, corps judiciaire, etc.) ; architecture militaire (corps de place) ; art militaire (corps d’artillerie, corps d’infanterie, etc.) ; chimie et physique (« ensemble inorganique de molécules » (TLF)).
On constate un balancement incessant entre les trois sens qui s’articulent autour de la notion d’élément-unité, puisque l’on passe de la partie à l’ensemble. Ainsi, dans les acceptions courantes, le corps peut être considéré autant comme la représentation de l’individu que comme une de ses parties (vs tête), ou encore comme l’ensemble des individus ayant quelque chose en commun. C’est également le cas au sein d’une langue spéciale (en anatomie, le terme peut désigner une partie d’un organe ou un organe jouissant d’une certaine autonomie). Ce phénomène est particulièrement marqué dans quelques expressions comme corps de voile (« chacune des voiles principales d’un navire » (TLF))/corps de voilure (« ensemble des voiles du navire » (TLF)); corps d’une place (« la place (...) considérée, abstraction faite de ses dehors » (TLF)/corps de place (« ensemble des ouvrages constituant l’enceinte continue de la place » (TLF)) corps du Christ (substantialisation de Dieu/ensemble des chrétiens).
Également présent en latin et allemand (« cadavre » mais aussi « corps solide », « corps solide, gazeux, liquide » en allemand), le sème saillant /matérialité/ s’articule en français et en latin avec le sème /relation du tout à la partie/ (particulièrement souligné par les délimitations oppositionnelles très nombreuses : corps vs âme, corps vs tête, corps vs biens, corps vs vêtements). En revanche, cette articulation n’est pas observable en allemand. En effet, les vocables germaniques Leib « abdomen », Rumpf « tronc » et Leich « corps (anatomique), cadavre » sont demeurés très actifs, court-circuitant ainsi la structuration sémique observée en latin et en français. Le sémème /groupe social/ est vraisemblablement dû à l’acception religieuse « ensemble des chrétiens » et à l’emprunt de korporal « corporel » (16e siècle, utilisé dans la liturgie catholique), Korporal « caporal » (17e siècle), Korps « corps, corporation, (diplomatique, d’étudiant) » (17e siècle), et Korporation. (18e siècle). Tout comme en anglais et en français, ce sémème devient très actif en allemand au 19e siècle.
Le sème /organisation/, sous-jacent, émerge peu à peu. En effet, le sens ensembliste français et latin, mais également le sémème allemand /groupe social/ sous-tend la notion d’organisation : une collection d’objets, d’individus, est appréhendée comme un ensemble unitaire, un corps, dans la mesure où elle est structurée par des liens, quels qu’ils soient, à l’image du corps humain, ensemble organisé d’organes, d’os, de muscles. Un corps social ou une corporation ne sont-ils pas appelés organisation (Organisation en allemand) (cf. supra, 11. 1. 3.) ?
Le moyen anglais a adopté le mot corps (= corps, mais aussi « division militaire » (1711) et « ensemble de personnes appartenant à la même organisation ou agissant dans le même but » (1730)) qui a évolué en corpse (« corps vivant » (1707), « cadavre » (moyen anglais), « corpus » (1651), « fondation » (1580)). Durant cette période, beaucoup de dérivés (corporal, corporality, corporate, corporation, corporature, corpulence, corpulent, corpus) apparaissent. Cependant, corps et corpse seront rapidement supplantés par body, issu de l’ancien haut allemand potah, et qui possède une structuration sémique très proche du nom français corps. Fait surprenant, c’est le nom field qui est choisi pour traduire le terme mathématique Körper. Ce nom, issu de la base indo-européenne °plth qui a produit flat « plat » et place « endroit, lieu », signifie en ancien anglais « espace de terrain ouvert et plat, plaine ». Dans l’évolution du signifié, le sème saillant qui apparaît est celui d’/espace/, délimité ou non :
-
lieu ouvert quelle que soit sa destination (le champ, le gisement, l’espace de jeux d’extérieur, le terrain de sport, le champ de bataille, la réserve de chasse),
-
surface perçue dans son extension,
-
espace ou sphère d’action, espace sous l’influence d’une action (magnetic field, the field of a telescope).
Le sème /zone d’influence/, du dernier sens de field semble être celui qui a présidé au choix du terme, et ceci au détriment du sème /structure/. Dans le cas de la structure algébrique appelée field, cette influence est celle des lois de compositions. Cependant, le dernier sémème laisse apparaître le trait /structure/ puisque le critère de délimitation de l’espace est le passage d’une zone où s’exerce une action à celle où cette action ne s’exerce plus. Il y a donc une discontinuité qualitative, et donc, une forme structurée. Le terme anglais contribue donc à mettre à mal l’hypothèse d’une motivation matérielle pour renforcer celle de structure dans la mesure où il sous-tend le trait /espace structuré/.
La notion de structuration joue un rôle majeur dans la définition axiomatique des ensembles. Un ensemble est une collection d’unités perçue comme un tout. Un groupe est un ensemble doté d’une loi de composition interne associative, possédant un élément neutre, et telle que tout élément du groupe possède un symétrique. Si cette loi de composition est commutative, ce groupe est dit abélien. Un anneau est un ensemble doté de deux lois de compositions internes (+ et .). Il se conduit comme un groupe abélien par rapport à l’addition ; la multiplication est associative et distributive par rapport à l’addition. Un corps est un ensemble doté de deux lois de composition interne (+ et .).
On peut récapituler ainsi ces définitions :
| Groupe G |
| Anneau R |
| Corps K |
| Corps K* |
en d’autre termes :
| (est un) |
| L’ensemble M |
| Le groupe G |
| L’anneau R |
| Le corps K |
| Le corps K*511 |
On constate dès lors que ces ensembles sont définis par un degré croissant de structuration : un ensemble n’a pas nécessairement de loi de composition, un groupe en a une, les anneaux et les corps en possèdent deux. Le second critère est la détermination des lois : la loi du groupe n’est pas nécessairement définie (si c’est le cas, sa dénomination le précise, selon le principe aristotélicien de définition par genre et espèce : un groupe doté de l’addition est un groupe additif (ou abélien), un groupe doté de la multiplication est un groupe multiplicatif) ; les lois de l’anneau et du corps sont nécessairement définies (+, .). Le troisième critère est le degré de cohérence des lois : la multiplication de l’anneau ne possède ni élément neutre, ni symétrique, contrairement à la multiplication du corps. La structure algébrique tisse donc un réseau de relations de plus en plus dense entre les éléments (par les lois de composition qui créent des relations entre les éléments, et le principe de symétrie qui assure la cohérence des dites lois) qui assure la cohésion de l’ensemble.
Ce degré croissant de structuration, de cohésion et de précision transparaît dans le vocabulaire ensembliste où les quatre traits récurrents qui sont apparus au cours de cette étude émergent tant au plan notionnel que sensoriel :
| Menge |
| groupe |
| Ring |
| Körper |
On peut constater que, de Menge à groupe, puis Ring et enfin Körper, on passe progressivement d’un mode de cohésion agrégatif à un mode d’organisation structuré. Parallèlement, la conception additive à l’origine du concept d’ensemble – qui demeure présente dans Menge, bien que de manière moins saillante que dans Mannigfaltigkeit – cède peu à peu la place à une conception ensembliste, qui se manifeste par la perte progressive de saillance du sème /multitude/, peu à peu remplacé par le sème /unité/. Si à cette série on associe le terme magma qui désigne les ensembles dotés d’une loi de composition interne, c’est-à-dire la structure algébrique à placer avant le groupe sur le continuum, on constate que la logique de structuration croissante est respectée513.
L’isotopie sociale, sous-jacente, n’émerge que grâce aux dénominations des propriétés et caractéristiques de la structure algébrique proprement dite : la commutativité, l’associativité, la distributivité, l’existence d’un élément neutre pour l’opération et d’un symétrique pour tout élément de l’ensemble. Toutes ces dénominations sont empruntées au domaine politico-juridique, et leur motivation ne relève pas d’une pure convention créatrice d’indice, mais du prolongement de la pensée philosophique et mathématique, ainsi que l’a montré l’étude précédente. Comme la cité antique est un organisme collectif défini par sa loi, les groupes, les anneaux et les corps sont des structures algébriques définies par leurs lois de composition interne. La tentation d’une explication par la motivation matérialisante des dénominations algébriques disparaît à la lumière de l’isotopie mésogénérique politico-juridique, et se voit remplacée par une analogie d’origine sociale. Lorsque l’on sait qu’une grande partie de la terminologie de la théorie des ensembles se caractérise par une approche sociale des mathématiques (couple (1903), classe (1903), tribu, clan (à partir de 1939)514), l’hypothèse naïve est définitivement battue en brèche.
Dès lors, pourquoi la motivation prégnante de ces termes est-elle d’origine matérielle passant par une esquisse sémantique différente de celle du transfert originel ?
La raison en est double : d’une part, la notion d’ensemble n’est pas une notion purement algébrique. Ce sont les concepts d’anneau, de corps, de groupe, de commutativité, d’associativité qui possèdent une motivation sociale. L’élaboration de l’algèbre ensembliste et la définition axiomatique des concepts a fait progressivement émerger le sème /structure/, à l’origine du transfert analogique. Comme le soulignent Jean Molino, Françoise
Soublin & Joëlle Tamine :
‘La métaphore est l’outil grâce auquel le langage n’est pas un code, mais un système symbolique en perpétuelle activité et en incessante transformation (Molino, Soublin, Tamine, 1979 : 39).’D’autre part, l’hypothèse matérialisante nécessite un travail d’inférence moindre, qui fait appel à l’expérience quotidienne : George Lakoff & Mark Johnson (1985 : 68) soulignent que nous conceptualisons habituellement le non-physique en termes physiques. Ainsi, un spécialiste comme Jean Dieudonné, membre du groupe Bourbaki, fait lui-même le choix du travail interprétatif le moins coûteux : pour lui, Ring donne l’idée de quelque chose qui se referme (cf. Didier Nordon (1981 : 103)).
Dès lors, pourquoi cette série élaborée au cours du 19e siècle n’est-elle pas analysable pour un lecteur moderne ? Il s’agit là d’une question de stratégie d’interprétation. Comme la notion d’étymologie populaire de Saussure fonctionne sur une ressemblance formelle, la stratégie de décodage de la motivation fonctionne sur une ressemblance sémantique. Or, Saussure souligne :
‘L’étymologie populaire n’agit (...) que dans des conditions particulières et n’atteint que les mots rares, techniques ou étrangers, que les sujets s’assimilent imparfaitement (Saussure, Cours de linguistique générale ; 1916 : 241).’Les textes mathématiques fournissant la définition axiomatisée des objets de l’objet dénoté, il y a fort à parier qu’un étudiant en mathématiques, voire un enseignant qui n’est pas versé en histoire des sciences, ne mette pas en oeuvre de stratégie de décodage de la motivation des termes-clefs de la théorie des ensembles : puisque le sens lui est fourni, il n’a pas à le construire. A contrario, c’est parce que le groupe Bourbaki s’est particulièrement intéressé au problème de la terminologie – qu’il souhaitait éclairée et éclairante – et de son iconicité, qu’il a mis en place une stratégie d’interprétation qui lui a permis de décoder la motivation et de poursuivre la série en forgeant des termes comme tribu et clan.
D’autre part, comme le soulignent George Lakoff & Mark Johnson (1985 : 209), notre structuration conceptuelle est fondée sur notre expérience physique et notre culture. L’écart culturel ne permet pas de reconstruire correctement la motivation.
En effet, ce choix sociomorphe s’explique par les préoccupations sociétales de la période. En effet, la société subit alors une profonde mutation : de rurale, elle devient industrielle. En réaction à cette mutation qui ne manque pas de frapper les esprits, les philosophes, tant en France qu’en Allemagne (dont les figures les plus brillantes sont respectivement Comte et Hegel), attaquent la philosophie individualiste. La sociologie des grands groupes sociaux, dans la tradition de l’idéalisme allemand de société globale, fait écho au « tout social » d’Auguste Comte. De part et d’autre du Rhin, on recherche une autorité morale susceptible de retarder le changement sociétal comme de recréer l’ordre social perdu. Ces séquelles du romantisme correspondent pleinement à la philosophie positiviste, et Auguste Comte est loin de s’opposer au sociologue allemand Ferdinand Tönnies. Ce dernier définit en 1887 la différence entre la communauté (Gemeinschaft), fondée sur des relations de solidarité, et la société (Gesellschaft), où les relations sont bâties sur l’échange, et qui constituent les deux extrema de l’évolution de la société du temps. Émile Durkheim oppose la solidarité mécanique entre êtres semblables des sociétés traditionnelles à la solidarité organique entre individus différents et complémentaires de la société émergente. En effet, par réaction à la lente désagrégation de la communauté, et dans un souci de maintien de la cohésion sociale, la fin du 19e siècle voit resurgir les rassemblements volontaires, les grandes associations (c’est la période de l’AIT, internationale socialiste), mais aussi le corporatisme d’État.
Bien que Durkheim et Tönnies en arrivent à des conclusions opposées, leur typologie est la même. Or, il est troublant de constater les correspondances entre les communautés, les sociétés mécaniques, et les ensembles, multitudes non hiérarchisées d’individus agrégés ; de même, la société émergeant au 19e siècle se définit par les liens d’échange et de complémentarité, notions qui ne sont pas sans rappeler les concepts mathématiques de commutativité et de symétricité.
Enfin, l’hypothèse matérialisante est souvent émise à partir d’un seul terme, particulièrement marquant, au sens où il marque une rupture d’isotopie particulièrement importante, comme anneau ou corps, ce que fait Jean Dieudonné. Mais il s’agit ici d’un système métaphorique cohérent qui vise à conceptualiser la découverte mathématique. Comme le soulignent les auteurs de Les métaphores dans la vie quotidienne (Lakoff & Johnson, 1985 : 126 et 160), dans ce type de structuration métaphorique, l’interprétation d’un seul des éléments du réseau métaphorique ne fournit pas de réponse heuristique.
Ce phénomène explique pourquoi, lors des tentatives de motivation des termes anneau et corps, la métaphore matérialisante est inférée :
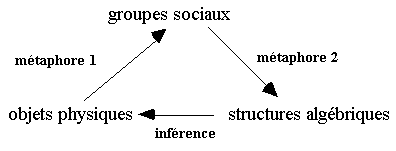
Ou, en d’autres termes :
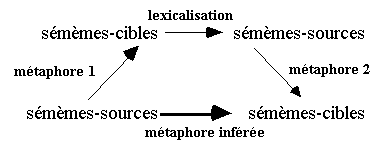
L’isotopie étudiée ici peut être considérée comme ce que Max Black appelle un archétype (c’est-à-dire une métaphore de même rang que le modèle)515. L’archétype possède deux caractéristiques spécifiques et solidaires : son caractère radical et son caractère systématique. En effet, l’isotopie sociomorphe possède la double caractéristique de radicalité (les transferts métaphoriques reprennent les théories d’Aristote), et de systématicité (l’ensemble des termes cités précédemment). Dans le cas du seul triplet de termes groupe, anneau et corps, cet archétype ne peut transparaître, puisque ni sa radicalité, ni sa systématicité n’apparaissent.
Cette étude de l’emploi de la métaphore dans un contexte terminogénétique nous indique clairement que les vertus heuristiques et cognitives traditionnellement attribuées à la métaphore ne sont effectives que dans la mesure où la métaphore est archétypique, c’est-à-dire si sa systématicité permet l’organisation d’un champ notionnel ou conceptuel. Elle possède alors toutes les caractéristiques des métaphores de la vie quotidienne analysées par George Lakoff & Mark Johnson (1985). Cependant, ces propriétés ne sont valides que si une stratégie d’interprétation est mise en oeuvre. Si cette stratégie d’interprétation n’est pas conduite de manière rigoureuse, la transposition d’une langue à l’autre des termes métaphoriques, ou le décodage de la métaphore peuvent conduire à une heuristique faussée. En effet, l’interprétation est un parcours de reconstitution de la motivation d’autant beaucoup plus coûteux que l’émetteur et le récepteur sont culturellement distants (en terme de maîtrise du domaine, d’époque et de pays)516.
Il convient de souligner un autre point, lié au précédent ; on constate que les seuls termes qui ne posent pas de problèmes majeurs ont une insertion linguistique commune. Ainsi, commutativité passe facilement d’une langue à l’autre car il est issu du latin et simplement adapté dans les langues d’accueil ; associativité et distributivité sont adaptés d’autant plus facilement que des termes de la même famille ont été adoptés auparavant (assoziieren entre en allemand au milieu du 16e siècle, associatif apparaît en français en 1488, distribute entre en anglais au 15e siècle, distributiv est emprunté par l’allemand du 18e siècle) ; de même, groupe est traduit de manière satisfaisante car il est emprunté depuis le 17e siècle en anglais et le 18e siècle en allemand. Ainsi, l’origine de Ring, commune à l’allemand et à l’anglais, en facilite la transposition de l’une à l’autre.
Le recours au latin semble donc un procédé facilitant la migration terminologique. Cependant, l’étude de la réception du terme Körper nous fait émettre quelques restrictions à cette hypothèse. Ce terme d’origine latine est traduit en anglais par un terme totalement différent étymologiquement et sémantiquement, en dépit de l’existence d’un équivalent dans la langue d’arrivée. La simple conservation adaptative ne semble pas être la règle pour tous les mots issus du fonds classique. En effet, les termes d’un usage courant, et qui, par là même, ne sont plus interprétés comme appartenant à celui-ci, perdent de leur caractère international, comme ils perdent leur capacité de sélection sémique (cf. supra). Dès lors, le problème de la fausse heuristique du vocabulaire commun rejoint celui de l’internationalisation des termes.
Les systèmes terminologiques métaphoriques et morphologiques ont ceci en commun qu’ils résultent d’une démarche iconique. Bien loin des recherches pluriséculaires de langue directe ou parfaite, le début de la période contemporaine utilise la notion de système. À la recherche de l’orthonomie succède la construction d’une motivation générée grâce à l’organisation du lexique scientifique en champs terminologiques517. La démarche taxinomique, qui associe un lexique organisé à la classification d’un domaine de la connaissance, en est la pierre fondatrice.
L’utilisation du système morphologique en chimie et dans les sciences du vivant a amplement démontré la capacité structurante de celui-ci. En ce qui concerne le système métaphorique, les correspondances établies entre modèle et métaphore archétype montrent que les relations entre les éléments du réseau métaphorique permettent de mettre en évidence la structure du concept. Toutefois, alors que le système morphologique fonctionne par différentiation (notion de valeur), le système métaphorique repose sur la complémentarité : l’isotopie n’apparaît que lorsque tous ses termes constitutifs sont pris en compte (notion de systématicité).
Cependant, les auteurs s’accordent à voir dans le système métaphorique un outil d’une efficience toute relative en matière de structuration conceptuelle et terminologique : Hedwig Konrad estime que la dénomination métaphorique, en ce qu’elle fonctionne par épuration sémique, ne met pas en évidence la structure des concepts (Konrad, 1939 ; cité par Ricoeur, 1975 : 137) et Rostislav Kocoureck (1982 : 170) considère que la métaphore terminologique souffre d’un manque de systémicité.
En effet, la motivation de celle-ci n’est effective que pour qui en possède les clefs de construction, obtenues dans la grande majorité des cas – il est rare que les auteurs explicitent leurs choix terminologénétiques – au prix d’un travail de reconstruction plus hypothétique que formel518. En revanche, les clefs de décodage du système morphologique sont plus aisées à déterminer en raison de son fonctionnement essentiellement computatoire. Il semble donc que les positions courantes sur l’opacité et la transparence des systèmes dénominatoires (les exogènes sont inintelligibles pour qui ne maîtrise pas les langues classiques ; les termes issus du vocabulaire courant sont d’une grande accessibilité) doivent être modulées. Le critère de la compétence lexicale, argument traditionnellement invoqué en la matière, doit être en fait inversé en matière de terminologie : l’expérience permet de déterminer le mode de fonctionnement du système morphologique par comparaison systématique, alors qu’elle conduit souvent à des phénomènes proches de l’étymologie populaire pour les termes métaphoriques.
Cependant, il convient de se défier des oppositions tranchées entre systèmes de dénomination – le couple énergie/entropie en est un exemple – comme de l’association systématique fonds classique/système morphologique et fonds vernaculaire/système métaphorique (comme le montrent les termes scalar et vector). L’analogie sémantique et morphologique, outil le plus puissant de la terminogénie et de l’arpentage de la pensée, se défie des frontières strictes.
Car force est de souligner la vitalité du langage, qui s’auto-génère et recrée un système : création de formants et de lexèmes, constitution de principes lexicogénétiques et de modes de signification. En ce début de période contemporaine, la terminologie n’est pas sans posséder certaines conjonctions avec les conceptions des linguistes du temps – la langue est une entité dotée d’un fonctionnement autonome, d’une faculté productrice et structurante – qui s’opposent à la vision des classiques qui n’y voyaient qu’un instrument de communication, ou un simple vêtement de la pensée.