INTRODUCTION
Après les débats sur la rénovation de l’art chrétien en France qui suivirent la première guerre mondiale et aboutirent à la reconnaissance d’une architecture moderne de tradition française, dont l’église du Raincy d’Auguste Perret symbolisa la réussite, la question de l’émergence d’une architecture sacrée contemporaine resurgit au sortir de la seconde guerre mondiale, en des termes beaucoup plus complexes que durant l’entre-deux-guerres.
Confrontés durant les années cinquante à d’importantes évolutions de la pratique religieuse mais aussi à des transformations sociales et urbaines spectaculaires, les responsables de la construction des églises en France furent conduits à remettre en cause la conception « triomphante » de l’édifice cultuel qui avait prévalu jusque là.
Aux questions soulevées par la reconstruction s’enchaînèrent celles découlant de l’accélération de la migration des populations rurales vers les villes1, de l’urbanisation rapide des grandes agglomérations, du développement des migrations - cycliques - lors des congés d’été ou d’hiver ou - définitives - à l’occasion de changements d’emploi, de la banalisation des départs vers la campagne lors des week-ends, toutes pratiques favorisées par la vulgarisation de l’usage de l’automobile.
Ces différents phénomènes, caractérisés par une mobilité sociale et géographique en plein essor, se répercutèrent sur les modes de pratique religieuse. Le mouvement de déchristianisation - notion contestée par les spécialistes qui parlent plus volontiers à ce sujet de signes de régression de la pratique cultuelle – devint particulièrement sensible dans les villes, conduisant à la remise en cause du fonctionnement paroissial ancestral.
Durant cette période, l’Eglise catholique s’engagea, lors du deuxième Concile du Vatican, dans une démarche d’ouverture au monde contemporain marquée par la reconnaissance du monde oecuménique et par l’accroissement de la place des laïcs dans l’Eglise. Dans ce cadre, on reconsidéra le caractère sacré du lieu de culte tout en soulignant l’importance primordiale de la communauté des fidèles.
Ces nouvelles orientations liturgiques fournirent un cadre idéologique à des recherches architecturales parfois iconoclastes. Les avatars dont fut alors l’objet l’église-bâtiment qu’on imagina démontable, mobile, provisoire, polyvalente, banalisée voire immatérielle, répondaient aux questions fondamentales que se posait le clergé. Il s’agissait de concevoir des lieux de culte dans un esprit à l’opposé de l’image de l’église conventionnelle – visible, monumentale, décorée, pérenne – afin de créer un cadre favorable à l’émergence d’une pastorale adaptée aux conditions contemporaines de vie et qui tienne compte de la présence désormais minoritaire des communautés catholiques dans la cité.
Ces changements d’orientation quant à la nature de l’église et à sa situation dans la ville, trouvent certaines prémisses dans les bouleversements techniques, sociaux et religieux provoqués par la révolution industrielle mais aussi, de manière plus sourde quoique très réelle, dans ceux causés par les deux guerres mondiales.
L’un des symptômes de ces mutations profondes s’est manifesté alors par l’irruption, dans le propos de responsables politiques et de sociologues mais aussi dans ceux d’artistes, d’architectes et, plus curieusement, d’ecclésiastiques, de termes comme ‘mobilité’, ‘dynamique’ ou ‘accélération’. Ces termes qui renvoient aux idées de vitesse, de changement, de mouvement, font directement écho au développement considérable dont furent l’objet les sciences et les techniques liées au déplacement des hommes et des biens durant la première moitié du XXème siècle.
La Grande Guerre s’accompagna, comme on sait, de progrès spectaculaires dans les performances des chemins de fer, de l’automobile, de la marine et de l’aviation. Simultanément, les villes constituèrent des objectifs militaires à part entière qu’elles fussent situées à proximité ou éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de la ligne de front. Les villes et les villages, même lorsqu’ils n’étaient pas liés au système défensif du pays, furent bombardés et les églises devinrent une cible privilégiée pour les artilleurs. Ainsi, l’extension du champ des combats aux cités s’accompagna de la destruction d’édifices dont la monumentalité et l’ancienneté semblaient, jusque là, constituer le symbole de leur pérennité et de leur unité.
L’aspect spectaculaire de ces destructions fut d’ailleurs exploité pour servir la cause des Alliés comme en témoigne la lecture de La France héroïque et ses Alliés, ouvrage publié par les éditions Larousse à partir de 19162. Le texte introductif souligne que la guerre qui débute, rompt avec ce qui est connu car « ‘toutes les découvertes, tous les engins de la science moderne ont été mis au service d’un kaiser (...) qui est, sous son vernis de civilisé, le fils de Gengis Khan et d’Attila ’»3.
La preuve de la « barbarie » de l’ennemi se voulait montrée, plutôt que démontrée, par des photographies, non de cadavres, mais de villages, de villes et d’églises prises pour cibles par les artilleurs. Les différents commentaires insistent sur la destruction des édifices de culte comme le montre cette description du bombardement de Soissons en septembre 1914 : « ‘Une des flèches de la vieille église de Saint-Jean des Vignes est en partie abattue, les verrières de la cathédrale sont crevées, les chapelles mutilées, une partie du porche éventré’ »4. Les images de la cathédrale de Reims incendiée (fig. 1), ou de la basilique Notre-Dame de Brébières à Albert5 et de sa vierge penchée (fig. 2) furent d’ailleurs abondamment publiées durant la Grande Guerre pour servir la cause des Alliés.
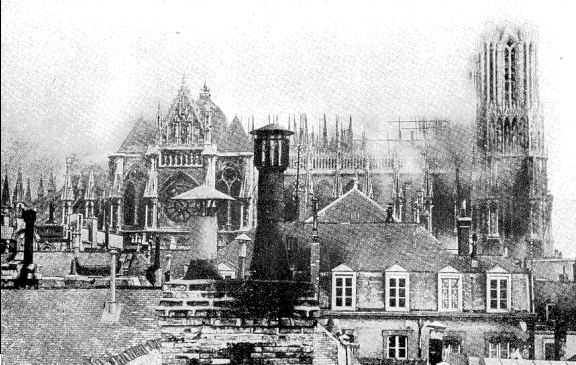

La diffusion d’images qui montraient que désormais les églises constituaient des cibles privilégiées, eut probablement une certaine influence sur les architectes, du moins sur leur inconscient. Les villes anéanties, les églises étrangement défigurées révélaient que la cité n’était plus désormais à l’abri des conflits mais constituait, au contraire, une cible dont les clochers constituaient des repères décisifs6 (fig. 3 et 4).
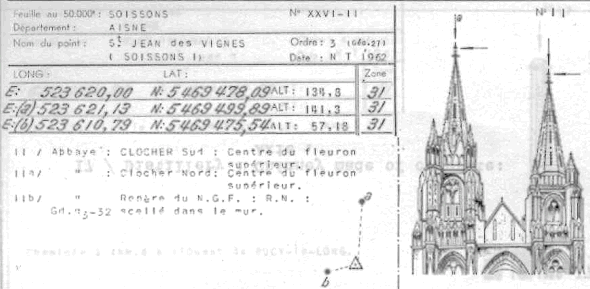
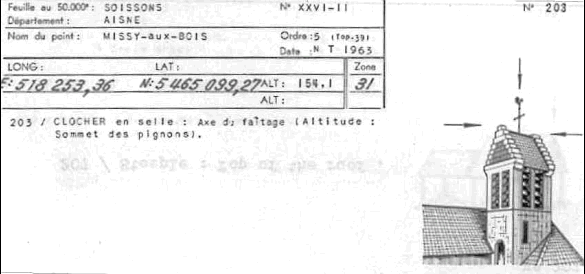
Ces destructions choquèrent sans doute aussi les soldats de la Grande Guerre qui, dans leur grande majorité, étaient des catholiques imprégnés de la religion vécue au quotidien dans les paroisses.
De nombreux prêtres furent d’ailleurs mobilisés et leur présence sur les lignes du front s’accompagna par la réalisation de dispositifs liturgiques et de lieux de culte adaptés à la zone de guerre7
En effet, la célébration des offices à proximité du front impliquait une grande prudence. Les dispositifs nécessaires au culte étaient réduits au minimum pour ne pas être la cible d’attaques et pour accompagner le déplacement des troupes. Les offices se déroulaient le plus souvent en plein air et dans les clairières (fig. 5). Les objets liturgiques étaient contenus dans une valise-chapelle. Chaque aumônier était doté de ce type de chapelle portative avec laquelle il se déplaçait parfois dans les tranchées pour donner le viatique aux combattants (fig. 6). En retrait des tranchées, on édifia des chapelles de fortune qui, pour échapper aux tirs, se firent discrètes (fig. 7), se calfeutrèrent, s’enterrèrent (fig. 8) ou furent installées de manière précaire dans des bâtiments prévus pour d’autres usages.

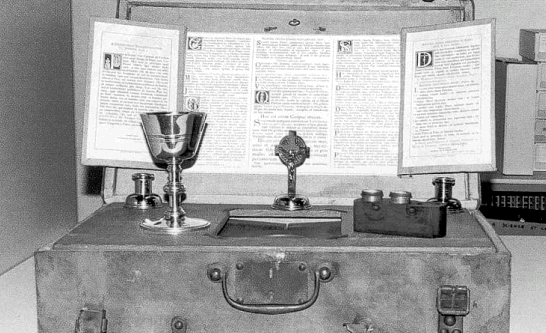
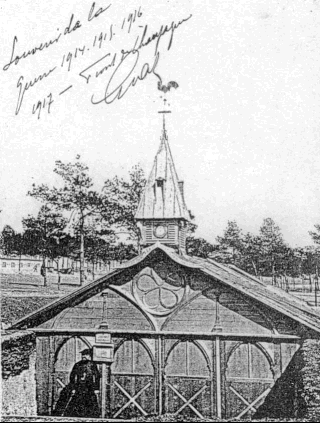

Afin de s’adapter à la rapidité des déplacements autorisés par l’usage de moyens de transport mécanique, l’église fut parfois motorisée comme le montre l’auto-chapelle que l’armée belge utilisa sur le secteur de l’Yser, assemblage monstrueux d’un véhicule automobile et d’un autel sulpicien (fig. 9 et 10).


Une fois la paix rétablie, des édifices provisoires furent de nouveau utilisés dans les anciennes zones de front mais, cette fois-ci, comme substitut des églises détruites. Ces constructions précaires laissèrent place aux églises ou aux chapelles qui furent édifiées dans le cadre des politiques de Reconstitution des Régions dévastées. La guerre avait été interprétée comme une sanction consécutive à l’affaiblissement de la pratique religieuse, la paix devait donc être le moment de rétablir des valeurs anciennes. « ‘Il dépend de nous que les leçons de la guerre ne soient pas perdues’ », proclame Maurice Denis lors d’une conférence en 1919, « ‘dans la France de demain, la société chrétienne aura sa place toute grande. Il y aura donc un art chrétien. (...) Il faut que nos provinces ravagées se recouvrent, comme autrefois, d’une blanche parure d’églises neuves’ »8 Les églises reconstruites renouèrent donc avec les codes architecturaux traditionnels. Ce qui répondait d’ailleurs au rappel à l’ordre du pape Pie XI qui, dans un discours prononcé en 1932, à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle pinacothèque vaticane s’était plaint « ‘de ce qu’il soit donné à des églises d’art moderne la forme d’un hangar, d’un stand, d’une usine ou d’un théâtre ’»9.
De fait la silhouette fuselée de certaines églises reconstruites comme celle de l’église Saint-Martin d’Hénin-Beaumont réalisée en 1932 par Maurice Boutterin (fig. 11) ou, mieux encore, celle de Saint-Laurent-Blangy réalisée en 1927 par Paul Decaux (fig. 12), semble directement inspirée du profil aérodynamique des obus, des cartouches ou des premières casemates de béton armé ; comme si les courbes tendues de ces monuments, au demeurant parfaitement statiques, cherchaient à exalter les formes dynamiques et la puissance destructrice des engins qui furent la cause de leur édification10.
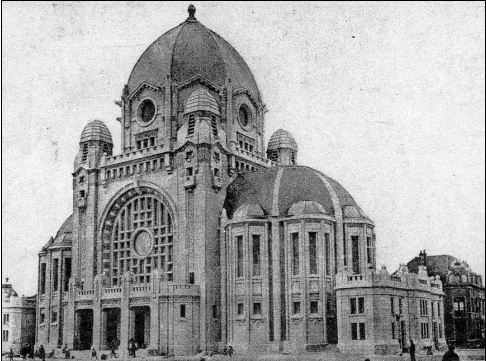

Cependant, le désir d’effacer au plus vite les marques laissées par les années de guerre en reconstruisant « à l’identique », la faiblesse des ressources disponibles, conduisirent à l’adoption de projets qui furent parfois contestés. En témoigne ce bilan désabusé, publié en 1934 dans Le Grand Hebdomadaire Illustré : « ‘Il aurait semblé que dans la région du Nord où tant d’églises avaient été détruites au cours de l’invasion et de l’occupation, la situation aurait permis une transformation des édifices religieux. Il n’en a rien été, et la plupart des églises reconstruites, souvent sur leurs fondations, n’ont rien montré de nouveau sauf peut-être la substitution de la brique à la pierre dont on se servait dans les siècles antérieurs. La rapidité avec laquelle il a fallu agir pour les nécessités du culte à l’étroit dans les granges et les baraquements, a été pour beaucoup dans ce défaut de recherche. Il fallait faire vite, au meilleur compte possible’ »11
Les curés mobilisés aux côtés des populations ouvrières découvrirent quelles étaient les conditions de vie dans les lotissements des banlieues pauvres situés à l’écart du fonctionnement des paroisses et prirent la mesure de l’état de déchristianisation dans lequel se trouvaient leurs habitants. Une fois la paix rétablie, cette découverte favorisa l’apparition d’un mouvement missionnaire dans la banlieue parisienne. Des curés s’installèrent dans les quartiers qui surgissaient de manière anarchique et s’employèrent à édifier des lieux de culte, modestes baraquements parfois réalisés à l’aide d’anciennes chapelles provisoires des zones dévastées.
Durant l’entre-deux-guerres et pendant l’Occupation, tout particulièrement au sein du clergé catholique impliqué dans l’action en milieu ouvrier, émergea l’idée qu’une nouvelle évangélisation de la France s’avérait nécessaire12. Ce mouvement s’inspirait des textes du pape Pie XI13, ‘pape des missions’ relus pour être appliqués aux missions urbaines. « ‘Le bouleversement social né de la guerre, amena autour des grandes villes, dans les centres miniers ou industriels la formation d’agglomérations souvent très importantes’ », résume en 1933 René Gobillot, « ‘devant tant d’âmes sans églises et sans prêtres, il a fallu songer à organiser dans les cités nouvelles et les villages renaissants la vie spirituelle. De là sont nés, autour de Paris, l’oeuvre des nouvelles paroisses et, sur les anciens champs de bataille la grande relève des églises du front ’»14.
Cependant, les édifices précaires réalisés dans la banlieue de Paris par les curés qui animaient ces missions urbaines furent peu à peu remplacés, dans le cadre des « Chantiers du Cardinal », par des églises traditionnelles. L’objectif était de rétablir dès que possible les conditions habituelles de l’apostolat : maillage paroissial satisfaisant et églises visibles dans la ville.
Au sortir de la deuxième guerre mondiale, la tâche que constituait la reconstruction des églises sinistrées était, par son ampleur, comparable à celle qu’avait connu la France vingt-cinq ans plus tôt. Le nombre d’édifices religieux qu’il fallait réparer ou reconstruire était d’environ 4 000, soit un nombre approximativement équivalent à celui de la guerre de 1914-1918. Par contre, la répartition géographique des églises sinistrées différait de celle de la guerre précédente. Les édifices concernés se répartissaient sur une très grande surface du territoire français au lieu d’être concentrés sur les départements du Nord et de l’Est.
Quant aux enjeux, ils n’étaient plus les mêmes. La guerre n’apparaissait plus comme une épreuve cathartique vécue à l’échelle nationale mais comme un cataclysme historique et universel. Le progrès – technique ou social – fut alors perçu, dans une perspective mythique, comme la voie rédemptrice et définitivement bénéfique qui s’offrait à l’humanité.
Cependant, même si, au lendemain de la guerre, on écrivit encore à propos de la reconstruction de quartiers entiers de villes anciennes comme Rouen, Caen ou Saint-Malo que « ne point pasticher serait un crime »15, les responsables de la reconstruction des églises se réjouirent, en dressant de premiers bilans, qu’à la différence de l’entre-deux-guerres la grande majorité des églises reconstruites ne se réduisaient pas à de simples pastiches. Paul Koch, architecte-conseil pour la reconstruction des édifices cultuels, affirmait en 1956 : « ‘un point semble acquis : à une ou deux exceptions près, le pastiche des anciens styles est abandonné’ »16. Il ajoutait que le dépouillement architectural des nouvelles églises constituait une première étape vers la pureté des formes et des lignes tandis qu’il observait : « ‘la recherche de nouvelles formes d’expression et l’adaptation de modes constructifs en usage dans l’architecture profane sont de plus en plus nombreuses’ »17.
Confrontée, durant les années cinquante, à l’urbanisation des grandes villes et à la multiplication des « grands ensembles », l’Eglise catholique éprouva de grandes difficultés à suivre le rythme des constructions et à maintenir le maillage paroissial traditionnel par l’édification, en parallèle, de nouveaux lieux de culte.
Les pères Couturier et Régamey, animateurs de la revue dominicaine L’Art Sacré déploraient alors que les plus grands monuments religieux étaient désormais les pires (Lourdes, Fourvière, Lisieux) et qu’aucune des cent vingt églises bâties autour de Paris dans le cadre des Chantiers du Cardinal n’avait été confiée à Perret, Mallet-Stevens, Tony Garnier ou Le Corbusier, les plus grands noms de l’architecture française de l’époque. Le père Couturier proposa donc que désormais celles-ci soient confiées aux grands architectes et artistes contemporains. « On a une cathédrale à bâtir ? » questionne-t-il, « ‘on se dira : “ il doit y avoir au monde un architecte qui est le plus grand architecte du monde. C’est celui-là que nous devons découvrir. Nous lui confierons la cathédrale, car c’est celui-là qui en est digne et qui en est capable”’ »18. Cet appel aux Maîtres aboutira au point d’orgue de l’inventivité plastique en matière d’architecture religieuse que constitue Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp (1955) de Le Corbusier.
En 1971, le bénédictin Frédéric Debuyst ne remet pas en cause la qualité architecturale de Ronchamp qu’il qualifie « d’exceptionnelle réussite », mais, en revanche, il déplore l’influence de ce monument sur l’architecture religieuse de l’époque. Ce que pointe Debuyst n’est pas le réemploi abâtardi des trouvailles de Le Corbusier, même s’il considère que Ronchamp était fait pour être admiré et non pour être imité, mais il regrette que cette oeuvre ait ouvert la voie à une architecture qui apparaît comme la traduction extériorisée du sacré de son concepteur au détriment du sacré proprement chrétien résidant dans la célébration de la messe. Debuyst déplore également que l’expressivité de l’oeuvre de Le Corbusier ait donné de nouvelles lettres de noblesse à l’idée de monumentalité architecturale au détriment du courant, alors naissant en France, favorable à une architecture ecclésiale simple, ouverte et sobre. « ‘Il faut avoir le courage de rappeler ici le prix dont nous avons payé certaines expériences, par exemple l’exceptionnelle réussite de Ronchamp », écrit-il, « En France, en Allemagne et peut-être surtout en Suisse, elle a provoqué une véritable explosion de formes organicistes, une vague de monumentalité dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle a retardé de plusieurs années l’avènement de cette « maison de l’assemblée chrétienne » que nous appelons de nos voeux et qui correspond à un besoin spirituel dont l’importance est sans commune mesure avec notre soif de baroquisme’ ». Il conclut : « ‘Avant Ronchamp on pouvait croire que certains excès étaient à jamais impossibles. Après Ronchamp tout est devenu possible’ »19.
Paul Winniger dénonçait dès 1957 « le complexe du monument » des chrétiens et souhaitait qu’ils se contentent de « ‘salles en éléments préfabriqués, solides, aptes à de multiples usages’ ». Durant les années soixante, le dominicain Jean Capellades déploya dans L’Art Sacré un prosélytisme en faveur des salles polyvalentes avec cloisons mobiles, sans caractère architectural particulier, comme le Centre paroissial Saint-Michel (1966) ou la Maison du Peuple Chrétien-église Saint-Luc (1967) tous deux à Nantes. Malgré tout, on continua à édifier des églises à l’architecture spectaculaire dont les formes traduisaient un goût prononcé pour une expressivité plastique proche de l’abstraction lyrique20. L’église Stella-Matutina (1965) à Saint-Cloud de l’architecte Alain Bourbonnais (fig. 13) ou encore l’église Saint-Vincent-Sainte-Jeanne-d’Arc (1979) à Rouen de Louis Arretche (fig. 14) en constituent deux exemples remarquables. Cependant, ce type d’architecture ne faisait plus l’unanimité. Ainsi, le choix de Saint-Vincent-Sainte-Jeanne-d’Arc, comme le rapportent Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire, donna lieu au cours des années soixante « ‘à toute une bataille menée par la municipalité et les sociétés locales contre certains groupes contestataires’ »21.


En effet, la conception d’églises de taille imposante fut peu à peu remise en cause au profit de réalisations économiques, jugées, dans l’esprit qui animait les débats de la période pré-conciliaire, plus en accord avec le message évangélique. On envisagea alors la réalisation d’églises provisoires ou démontables. Comme l’écrit l’historien René Rémond « ‘Tous les signes d’appartenance et de visibilité sont passés au crible d’une exigence d’authenticité qui vise à mettre à nu le spécifique chrétien. Par exemple, convenait-il encore, dans la seconde moitié du XXème siècle, de construire des églises ? Edifier à grands frais un bâtiment qui n’aurait pas d’autre destination que la célébration de quelques offices alors que tant d’hommes manquent du nécessaire, n’est-ce pas porter un contre témoignage ? Dieu demande d’être honoré d’abord par la charité à l’égard des pauvres. Aussi certains suggèrent-ils d’orienter plutôt la politique de construction vers des centres partagés avec d’autres confessions ’»22.
Le prosélytisme déployé en faveur de la conception d’églises économiques, et donc forcément modestes, suscita néanmoins une certaine réticence des architectes. En effet, l’idée que l’église pouvait ne plus être qu’une construction temporaire, discrète, peu visible, conçue pour être transformée - voire déplacée - renversait un certain nombre de « lampes » de l’architecture religieuse, au sens que donnait Ruskin à ce terme, comme, par exemple, la massivité de la construction, la pérennité des formes, le caractère sacré et intangible de l’église, le clocher surplombant les toits de la ville, « lampes » sur lesquelles était fondée la culture architecturale.
Pour la plupart des architectes, la conception et la construction d’une église constituait un moment privilégié. En effet, il s’agissait d’une commande exceptionnelle qui leur permettait de vérifier que l’essence de l’architecture touchait au sacré, à l’intemporel et au monumental.
Ce qui au départ se limitait à la recherche de solutions permettant de faire face rapidement et malgré des moyens limités à la pénurie de lieux de culte dans les zones d’urbanisation nouvelle, prit l’ampleur d’une réflexion de fond sur la nature et la place de l’église dans la ville moderne. Le caractère provisoire ou semi-permanent que l’on demandait aux nouvelles églises sembla rapidement moins signifier que l’on envisageait de les remplacer dès que possible par des constructions définitives plus ambitieuses que de chercher, au contraire, à exprimer le caractère précaire et temporaire de la présence de la communauté catholique dans la ville par une architecture amovible ou polyvalente. Au lieu d’affirmer par la monumentalité la pérennité de l’installation de l’église dans un territoire, il s’agissait à l’inverse de souligner la fragilité temporelle de sa présence, de signifier l’abandon de toute velléité de domination du monde religieux sur la cité.
Cependant, la mobilité croissante des populations alimenta également les réflexions des responsables catholiques tout comme celles de ceux qui avaient en charge l’aménagement du territoire.
Un comité baptisé « Groupe 1985 » fut ainsi créé en 1962 par le gouvernement « ‘pour éclairer les orientations générales du Vème Plan’ ». Ce comité composé de personnalités comme Eugène Claudius-Petit ou Paul Delouvrier rendit en 1964 un rapport dont un chapitre était consacré à la question de la mobilité. Ce rapport soulignait que l’on observait une tendance récente à l’accroissement de la mobilité dans de nombreux domaines : celle des hommes, des objets ou encore des équipements.
En février 1965, l’année même où s’achevait le Concile Vatican II, le clergé français fit écho aux préoccupations gouvernementales en organisant un colloque interconfessionnel dans les locaux de l’UNESCO à Paris. Ce colloque présidé par Monseigneur de Vaumas, président du Comité National des Constructions d’Eglises (C.N.C.E.), associait des personnalités des différentes confessions présentes en France mais aussi des responsables – politiques et hauts fonctionnaires - de la planification urbaine23. A cette occasion, les perspectives de développement démographique des villes françaises furent évoquées. On prévoyait le doublement de la population pour l’an 2000. Les autorités religieuses étaient encouragées à mesurer les conséquences, en terme de programmation de lieux de culte, de l’urbanisation accélérée des villes, mais aussi à se montrer sensible à la « révolution automobile » en cours. Pour répondre à ce phénomène, plutôt que d’édifier de nouvelles églises dans les quartiers en cours de construction dont on craignait la désertification lors des week-ends, on envisagea la construction de grands édifices de culte à la sortie des villes.
Le développement des vacances d’été et d’hiver préoccupait également le clergé français. En effet, des millions de Français prenaient l’habitude de quitter les villes l’été pour passer plusieurs semaines au bord des plages. Se posait le problème de l’absence sur place d’équipements religieux adaptés. On suggéra alors de créer un nouveau type de mission tourné vers les populations estivales en les confiant, par exemple, à des « pères campeurs ».
Aux questions soulevées par la mobilité géographique se superposait la variabilité de la pratique religieuse durant la semaine et l’année. Si la mobilité de l’édifice religieux sembla parfois constituer une réponse possible au premier aspect de ce problème, la mobilité des cloisons et du mobilier apparut comme un moyen d’ouvrir le lieu de culte sur le monde extérieur, d’en socialiser l’usage. La polyvalence de l’architecture visait à optimiser le fonctionnement de l’église mais aussi, et peut être essentiellement, à l’inscrire au plus près de la vie sociale.
Les projets d’installation d’églises nomades et discrètes à l’extérieur des villes trahissaient peut être également un sentiment de défiance, inconscient, à l’égard de la cité historique. Après tout, les deux guerres mondiales avaient montré que désormais les villes étaient désignées comme des objectifs militaires à part entière et qu’elles avaient définitivement perdu leur valeur de refuge pour les populations civiles.
La Guerre Froide (les bombardiers transcontinentaux porteurs de bombes atomiques) puis la stratégie de l’équilibre de la terreur (le déploiement de fusées intercontinentales) radicalisèrent cette évolution. Les grandes villes constituèrent désormais l’objectif ouvertement désigné des missiles qu’ils étaient à même d’atteindre en quelques minutes.
De ce point de vue, les recherches visant à l’allégement croissant des matériaux, la quête d’une architecture tendant vers l’immatérialité, peuvent être lues non seulement comme l’expression du désir, ancestral, de se libérer de la pesanteur mais encore comme celui d’atteindre à des créations purement spirituelles à l’abri de tout souffle destructeur.
La compréhension des ressorts qui ont conduits à la recherche d’une architecture religieuse à l’antipode de la conception traditionnelle nécessite d’interroger, quand cela est encore possible, la mémoire de ses acteurs, d’identifier et de travailler sur des archives peu exploitées ou méconnues. En effet, cette tendance quoique demeurée marginale et dont les projets sont parfois restés au stade du dessin ou simplement de l’intention, est néanmoins révélatrice des espoirs et des inquiétudes, parfois ambigus, parfois paradoxaux, d’une époque en tension entre l’espoir suscité par les situations modernes qui furent au coeur des débats du Concile Vatican II, et l’angoisse résultant de la stratégie de la terreur alors développée par les deux superpuissances.