1.4.2 le français
Le français moderne est issu de la variante connue sous le nom de ’langue d’oïl’ au travers des mutations linguistiques spécifiques qui ont affecté les parlers de l’Ile de France (Bourciez, 1971). D’après Vaissière (1991), les plus importantes de ces mutations concernent la relation entre la prosodie des mots latins (i.e., l’opposition de quantité dans le système vocalique et la présence d’un accent mélodique) et les changements produits ensuite dans le français moderne.
Le français moderne possède un consonantisme relativement stable en termes de nombre de phonèmes et de fonctionnalité des oppositions. En revanche, son vocalisme est le plus fluctuant des cinq idiomes qui font l’objet de la présente description. Nous y consacrerons la première partie de ce paragraphe.
 /, /e/~/ε/, /oe/~/ø/, /a/~/
/, /e/~/ε/, /oe/~/ø/, /a/~/
 / et /
/ et /
 /~/
/~/
 /) et par la présence d’un segment connu sous le nom de e caduc, dont le statut phonémique et les réalisations phonétiques échappent à toute tentative de structuration. A présent, le système vocalique français est incontestablement le plus complexe au sein des idiomes latins, de par son nombre élevé d’oppositions phonémiques et l’existence de quatre axes vocaliques, à savoir antérieur, postérieur, antérieur-arrondi et central. Il est aussi le plus sujet à des changements qui vont dans le sens de la réduction des oppositions.
/) et par la présence d’un segment connu sous le nom de e caduc, dont le statut phonémique et les réalisations phonétiques échappent à toute tentative de structuration. A présent, le système vocalique français est incontestablement le plus complexe au sein des idiomes latins, de par son nombre élevé d’oppositions phonémiques et l’existence de quatre axes vocaliques, à savoir antérieur, postérieur, antérieur-arrondi et central. Il est aussi le plus sujet à des changements qui vont dans le sens de la réduction des oppositions.De ce fait, la représentation des phonèmes du système vocalique français est particulièrement difficile. Nous avons trouvé une solution dans le système minimal proposé par Walter (1977). Il est ’sûr’ dans la mesure où il fait état des oppositions fondamentales et nullement sujettes à des controverses.
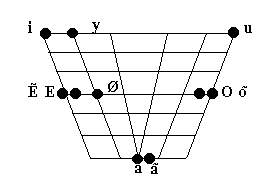
 / est exclue d’emblée par Walter qui, faisant remarquer l’extrême faiblesse de son rendement, la réduit à un seul phonème /a/. Le timbre central /
/ est exclue d’emblée par Walter qui, faisant remarquer l’extrême faiblesse de son rendement, la réduit à un seul phonème /a/. Le timbre central /
 / n’est pas considéré non plus, pouvant être défini phonétiquement en tant que réalisation d’un phonème déjà existant dans la langue, ce qui réduit les axes du système au nombre de trois. Le système articulé autour du trait nasalité est réduit à trois phonèmes, ce qui montre le caractère instable de l’opposition /
/ n’est pas considéré non plus, pouvant être défini phonétiquement en tant que réalisation d’un phonème déjà existant dans la langue, ce qui réduit les axes du système au nombre de trois. Le système articulé autour du trait nasalité est réduit à trois phonèmes, ce qui montre le caractère instable de l’opposition /
 /~/
/~/
 /. Par conséquent, nous pouvons adopter - à l’instar de Walter (1977) - un système phonémique de dix unités, escorté de quatre oppositions supplémentaires potentielles et d’un segment adjacent central au statut et rôle incertains. Enfin, la tâche de décrire cette organisation vocalique dans sa forme élargie (i.e., qui prenne en compte les oppositions supplémentaires à rendement faible) est complexifiée par la présence d’au moins deux géolectes, divisant la France en deux régions, une première réunissant le Midi et le Nord (désormais N/S), et une seconde, centrale. Dans ce qui suit, nous allons survoler brièvement cette problématique11.
/. Par conséquent, nous pouvons adopter - à l’instar de Walter (1977) - un système phonémique de dix unités, escorté de quatre oppositions supplémentaires potentielles et d’un segment adjacent central au statut et rôle incertains. Enfin, la tâche de décrire cette organisation vocalique dans sa forme élargie (i.e., qui prenne en compte les oppositions supplémentaires à rendement faible) est complexifiée par la présence d’au moins deux géolectes, divisant la France en deux régions, une première réunissant le Midi et le Nord (désormais N/S), et une seconde, centrale. Dans ce qui suit, nous allons survoler brièvement cette problématique11. e] vs. ’près’ [p
e] vs. ’près’ [p
 ε]), mais neutralisées au profit de [ε] en syllabe fermée. Cependant, d’après Rossi & Lambert-Drache (1987), la situation serait plus complexe dans la mesure où les réalisations seraient soumises à un nombre de facteurs qui transcendent la distribution dans les deux lectes mentionnés. Les facteurs cités par Rossi & Lambert-Drache sont relatifs à la forme de la syllabe, à l’accentuation, à la position de la voyelle dans le mot, à l’influence de l’aperture de la voyelle sur la réalisation désaccentuée, à l’harmonie vocalique, entre autres, pour ne citer que les conditions les plus représentatives. Néanmoins, une analyse statistique en composantes principales de la totalité des facteurs permet aux auteurs de réduire les conditions d’occurrence des deux voyelles [e] et [ε] à trois principales qui concernent l’effet d’aperture en position accentuée, la forme de la syllabe et l’harmonie vocalique. Par ailleurs, la combinaison de ces trois premiers facteurs est également importante. Malgré cela, Rossi & Lambert-Drache soulignent que la maîtrise du fonctionnement de l’opposition n’est toujours pas atteinte et la mise en évidence des principales règles qui la gouvernent ne peut guère empêcher une variabilité manifeste.
ε]), mais neutralisées au profit de [ε] en syllabe fermée. Cependant, d’après Rossi & Lambert-Drache (1987), la situation serait plus complexe dans la mesure où les réalisations seraient soumises à un nombre de facteurs qui transcendent la distribution dans les deux lectes mentionnés. Les facteurs cités par Rossi & Lambert-Drache sont relatifs à la forme de la syllabe, à l’accentuation, à la position de la voyelle dans le mot, à l’influence de l’aperture de la voyelle sur la réalisation désaccentuée, à l’harmonie vocalique, entre autres, pour ne citer que les conditions les plus représentatives. Néanmoins, une analyse statistique en composantes principales de la totalité des facteurs permet aux auteurs de réduire les conditions d’occurrence des deux voyelles [e] et [ε] à trois principales qui concernent l’effet d’aperture en position accentuée, la forme de la syllabe et l’harmonie vocalique. Par ailleurs, la combinaison de ces trois premiers facteurs est également importante. Malgré cela, Rossi & Lambert-Drache soulignent que la maîtrise du fonctionnement de l’opposition n’est toujours pas atteinte et la mise en évidence des principales règles qui la gouvernent ne peut guère empêcher une variabilité manifeste. /, fait preuve d’une distribution géographiquement différenciée. La zone N/S bénéficie d’un seul phonème /ο/ qui est réalisé comme /ο/ en syllabe ouverte et comme /
/, fait preuve d’une distribution géographiquement différenciée. La zone N/S bénéficie d’un seul phonème /ο/ qui est réalisé comme /ο/ en syllabe ouverte et comme /
 / en syllabe fermée. Dans la zone centrale, l’opposition est neutralisée en syllabe ouverte en faveur de [ο], tandis qu’en syllabe fermée l’occurrence de chacun des deux segments est permise.
/ en syllabe fermée. Dans la zone centrale, l’opposition est neutralisée en syllabe ouverte en faveur de [ο], tandis qu’en syllabe fermée l’occurrence de chacun des deux segments est permise. / sont encore d’actualité, mais leur rendement est infime. D’après Wioland (1985), /oe/~/ø/ était l’opposition la moins fonctionnelle mise en évidence par ses enquêtes. L’existence d’un seul phonème /ø/ et de ses deux variantes combinatoires, à savoir /ø/ en syllabe ouverte et /oe/ en syllabe fermée, pour ce qui est de la zone N/S est généralement acceptée. Le second géolecte posséderait, lui, [ø] en syllabe ouverte et, dans quelques contextes, en syllabe fermée (par exemple, /-z/ dans ’heureuse’), le reste des contextes de type fermé étant couvert par sa contrepartie ouverte [oe]. La paire /α/~/
/ sont encore d’actualité, mais leur rendement est infime. D’après Wioland (1985), /oe/~/ø/ était l’opposition la moins fonctionnelle mise en évidence par ses enquêtes. L’existence d’un seul phonème /ø/ et de ses deux variantes combinatoires, à savoir /ø/ en syllabe ouverte et /oe/ en syllabe fermée, pour ce qui est de la zone N/S est généralement acceptée. Le second géolecte posséderait, lui, [ø] en syllabe ouverte et, dans quelques contextes, en syllabe fermée (par exemple, /-z/ dans ’heureuse’), le reste des contextes de type fermé étant couvert par sa contrepartie ouverte [oe]. La paire /α/~/
 / connaît une extrême variabilité inter-individus (Walter, 1977). Il semblerait que les habitants de Lyon et de ses alentours fassent encore une nette différence entre ’patte’ [pat] et ’pâte’ [p
/ connaît une extrême variabilité inter-individus (Walter, 1977). Il semblerait que les habitants de Lyon et de ses alentours fassent encore une nette différence entre ’patte’ [pat] et ’pâte’ [p
 t], alors qu’ailleurs l’occurrence de l’opposition est beaucoup moins systématique et sujette à des fluctuations liées aux locuteurs ou aux lexèmes. En raison de cette inconsistance distributionnelle, Walter exclue un possible archiphonème /A/ du système vocalique français.
t], alors qu’ailleurs l’occurrence de l’opposition est beaucoup moins systématique et sujette à des fluctuations liées aux locuteurs ou aux lexèmes. En raison de cette inconsistance distributionnelle, Walter exclue un possible archiphonème /A/ du système vocalique français. ] ou [ø]. Il critique ces deux opinions en ce qui concerne les réalisations du e
caduc, en éliminant la seconde possibilité (Bazylko, 1981). Depuis, le e caduc n’a pas cessé de susciter des débats quant à sa nature, aussi bien phonémique que phonétique. Les controverses conce<rnent sa susceptibilité de tomber dans certains contextes, mais aussi les contraintes qui empêchent sa chute, sa nature phonétique (s’identifie-t-il avec [ø] ou [oe] ou est-il question d’une voyelle distincte ?) ou, encore, sa source (y a-t-il une voyelle sous-jacente /
] ou [ø]. Il critique ces deux opinions en ce qui concerne les réalisations du e
caduc, en éliminant la seconde possibilité (Bazylko, 1981). Depuis, le e caduc n’a pas cessé de susciter des débats quant à sa nature, aussi bien phonémique que phonétique. Les controverses conce<rnent sa susceptibilité de tomber dans certains contextes, mais aussi les contraintes qui empêchent sa chute, sa nature phonétique (s’identifie-t-il avec [ø] ou [oe] ou est-il question d’une voyelle distincte ?) ou, encore, sa source (y a-t-il une voyelle sous-jacente /
 / qui possède des attributs précis ?).
/ qui possède des attributs précis ?).Le e caduc – appelé aussi ’voyelle indéterminée’ (Tilkov, 1989), ’lubrifiant phonétique’ (Martinet,1972) ou, encore, e muet – soulève, comme nous venons de le préciser, aussi bien des problèmes phonologiques que phonétiques. En conséquence, on peut se demander s’il s’agit d’un phonème indépendant ou bien d’une variante d’un autre phonème du système, et notamment de /ø/ en raison de la proximité de leurs timbres. Adopter cette dernière interprétation est préférable et ce ne serait pas une innovation (voir, entre autres, Walter, 1977). Cependant, l’instabilité de son occurrence, qui est permise dans toutes les situations où soit en fin de mot monosyllabique ou polysyllabique, soit en syllabe ouverte non finale, un graphème e existe, rend la tâche irréalisable. En revanche, l’assimiler au schwa semble être un abus, compte tenu du fait que du point de vue phonologique le e caduc ne remplit que partiellement les fonctions d’une telle unité, qui a un rôle épenthétique et qui est susceptible de syncope.
 ], distincte de [ø] et [oe], tandis que d’autres soutiennent le point de vue contraire, qui est celui d’argumenter une similarité de timbre avec les deux voyelles antérieures arrondies12. Le sujet est loin d’être épuisé et la solution ne semble pas être unique. Nous avons plutôt le sentiment de nous trouver devant un phénomène en pleine et continue mutation, et cela à la fois d’un point de vue phonologique et phonétique. Les règles qui gouvernent ces mutations semblent être diverses et confuses. Aussi s’agit-il peut être de phénomènes plus vastes qui concernent le vocalisme français tout entier, qui renvoient à la discussion sur le rendement de certaines oppositions. Ces phénomènes affectent davantage le niveau intermédiaire extrêmement riche d’aperture moyenne, d’où la difficulté de fonctionnement distinctif. De ce fait, il semble qu’une propension vers une simplification des distinctions d’après un critère utilitaire soit en train de se manifester. Toutefois, cette tendance n’est guère récente. Cette prédisposition n’est pas non plus unique au sein des idiomes néo-latins, car d’autres langues, dont principalement l’italien et le portugais, en témoignent également.
], distincte de [ø] et [oe], tandis que d’autres soutiennent le point de vue contraire, qui est celui d’argumenter une similarité de timbre avec les deux voyelles antérieures arrondies12. Le sujet est loin d’être épuisé et la solution ne semble pas être unique. Nous avons plutôt le sentiment de nous trouver devant un phénomène en pleine et continue mutation, et cela à la fois d’un point de vue phonologique et phonétique. Les règles qui gouvernent ces mutations semblent être diverses et confuses. Aussi s’agit-il peut être de phénomènes plus vastes qui concernent le vocalisme français tout entier, qui renvoient à la discussion sur le rendement de certaines oppositions. Ces phénomènes affectent davantage le niveau intermédiaire extrêmement riche d’aperture moyenne, d’où la difficulté de fonctionnement distinctif. De ce fait, il semble qu’une propension vers une simplification des distinctions d’après un critère utilitaire soit en train de se manifester. Toutefois, cette tendance n’est guère récente. Cette prédisposition n’est pas non plus unique au sein des idiomes néo-latins, car d’autres langues, dont principalement l’italien et le portugais, en témoignent également.Enfin, le français est l’une des deux LR discutées dans cette section possédant des voyelles nasales phonologiques, mais aussi l’une des six langues européennes faisant état de ce type de segments, par ailleurs présents dans le polonais, l’albanais, l’irlandais, le gaélique et le breton (Sampson, 1999). Historiquement, il est généralement accepté que la nasalité soit le résultat d’une assimilation phonétique régressive. Elle s’est développée comme résultat de la perte de la consonne nasale postvocalique qui est responsable du déclenchement du processus. L’origine et les conditions d’évolution de la nasalité en français sont des plus claires, ce qui ne semble pas être le cas pour le portugais, ou encore moins pour d’autres langues romanes présentant sporadiquement le phénomène (Posner, 1996)13.
 /. Il fait état du rendement très faible de l’opposition /e/~/oe/, car basée sur une opposition d’arrondissement, dont le caractère distinctif n’est pas des plus importants. Certains linguistes dont Léon (1996, pp. 203) sont plus drastiques tout en affirmant que ‘’le passage de /oe’
‘’
‘/ à /a’
‘’
‘/ semble être aujourd’hui définitivement entériné’.’
/. Il fait état du rendement très faible de l’opposition /e/~/oe/, car basée sur une opposition d’arrondissement, dont le caractère distinctif n’est pas des plus importants. Certains linguistes dont Léon (1996, pp. 203) sont plus drastiques tout en affirmant que ‘’le passage de /oe’
‘’
‘/ à /a’
‘’
‘/ semble être aujourd’hui définitivement entériné’.’
En revanche, l’opposition /a/~/ο/ fait preuve de plus de vitalité (Martinet, 1945 ; Walter, 1977 ; entre autres). Toutefois, nous avons l’impression que cette vitalité est décroissante, car elle semble être de moins en moins fréquente dans la prononciation des jeunes lyonnais (notamment ceux issus de l’immigration arabophone).
Quoi qu’il en soit, il semble que le système nasal soit, lui aussi, en évolution vers une structure plus que simplifiée, puisque réduite à deux phonèmes, voire un seul selon Léon (1983), qui signale la tendance parisienne de supprimer l’opposition /ε/~/a/ au profit d’un segment [a] unique.
Si le système vocalique soulève un nombre aussi important de complications, en revanche le consonantisme est - à quelques exceptions près - l’un des plus simples dans le groupe linguistique étudié ici. Le tableau des phonèmes consonantiques du français ci-dessous fait consensus dans la linguistique française.
| Bilabiales | Labio-dentales | Dentales (Alvéol.) | (Post) Alvéol. | Palatales | Vélaires | |
| Occlusives | P b | T d | K g | |||
| Affriquées | ||||||
| Fricatives | F v | S z |

|
|||
| Nasales | m | n |

|
N | ||
| Latérales | L | |||||
| Vibrantes | r | |||||
| Semi-C/V | j | w |
Dans sa structure actuelle, le système est quasi-prototypique (voir paragraphe 1.3.). Néanmoins, quelques items semblent requérir des précisions additionnelles, il s’agit des phonèmes /N/, /l/, /r/, /j/ et /w/. Ainsi, la vélaire nasale /N/ est acquise récemment, grâce notamment aux emprunts de l’anglais, tels que, par exemple, ’parking’ [parkiN] ou ’jogging’ [jogiN]. Son rendement est réduit, car le nombre de lexèmes permettant son apparition se restreint strictement aux emprunts anglophones. Par conséquent, son statut phonémique dans le système (considéré comme tel par Walter, 1977) nous semble discutable.
Les consonnes /l/ et /r/ sont considérées comme étant ’hors système’ par Walter (1977), en raison du fait qu’elles ne partagent aucun trait avec les autres unités du système. Le phonème /ρ/, défini comme une vibrante apicale, donne lieu à trois variantes libres.
D’après Chafcouloff (1985), ces variantes sont liées à plusieurs facteurs, tels le contexte vocalique, la position et la prédominance de la source sonore. Il en résulte ainsi une variante vocalique qui apparaît en position initiale, une variante constrictive voisée, résultante de la combinaison de deux sources d’excitation, une source glottale et une source de bruit, et enfin, une variante constrictive sourde, réalisée en finale et représentant entre autres, la norme du français méridional.
 ], qui, en dehors de l’initiale, se retrouve à l’intérieur d’un groupe consonantique (Chafcouloff & Autesserre, 1998). Elle semble être un héritage des contraintes phonotactiques d’occurrence de la variante battue alvéolaire qui l’a précédée dans la langue. En position intervocalique, le battement ne se manifeste plus et la variante qui remplace [
], qui, en dehors de l’initiale, se retrouve à l’intérieur d’un groupe consonantique (Chafcouloff & Autesserre, 1998). Elle semble être un héritage des contraintes phonotactiques d’occurrence de la variante battue alvéolaire qui l’a précédée dans la langue. En position intervocalique, le battement ne se manifeste plus et la variante qui remplace [
 ] est une constrictive [
] est une constrictive [
 ], dont la réalisation peut aller jusqu’à une approximante [
], dont la réalisation peut aller jusqu’à une approximante [
 ]. Enfin, une variante réellement perçue comme fricative est susceptible d’apparaître en position finale d’énoncé, car l’interruption du voisement favorise la prééminence de la source de bruit.
]. Enfin, une variante réellement perçue comme fricative est susceptible d’apparaître en position finale d’énoncé, car l’interruption du voisement favorise la prééminence de la source de bruit. ], dont uniquement /j/ et /w/ disposent d’un statut phonémique. Les linguistes acceptent l’opinion selon laquelle, devant une voyelle, les trois segments [j], [w] et [
], dont uniquement /j/ et /w/ disposent d’un statut phonémique. Les linguistes acceptent l’opinion selon laquelle, devant une voyelle, les trois segments [j], [w] et [
 ] sont des semi-voyelles et représentent des variantes combinatoires des phonèmes vocaliques correspondants /i/, /u/ et /y/ (Walter, 1977, Léon, 1992, Carton, 1974 ; entre autres).
] sont des semi-voyelles et représentent des variantes combinatoires des phonèmes vocaliques correspondants /i/, /u/ et /y/ (Walter, 1977, Léon, 1992, Carton, 1974 ; entre autres). e] dans ’suer’ [s
e] dans ’suer’ [s
 e], ’nuée’ [n
e], ’nuée’ [n
 e], [
e], [
 i] dans ’lui’ [l
i] dans ’lui’ [l
 i] ; [je] dans ’scier’ [sje], ’nier’ [nie], [aj] dans ’aille’ [aj] ; [we] dans ’souhait’ [swe], ’louer’ [lwe], ’vouer’ [vwe], etc.). Néanmoins, [j] est susceptible d’avoir un comportement consonantique en fin de syllabe où, d’après Walter (1977), il est distinct du phonème vocalique /i/14.
i] ; [je] dans ’scier’ [sje], ’nier’ [nie], [aj] dans ’aille’ [aj] ; [we] dans ’souhait’ [swe], ’louer’ [lwe], ’vouer’ [vwe], etc.). Néanmoins, [j] est susceptible d’avoir un comportement consonantique en fin de syllabe où, d’après Walter (1977), il est distinct du phonème vocalique /i/14.Quant aux caractéristiques prosodiques du français, elles sont telles que nous pouvons affirmer une fois de plus la différence de cette langue par rapport aux autres langues romanes. La particularité supra-segmentale principale est liée à son accent final fixe. Cet accent trouve sa manifestation au niveau syntagmatique où il n’a un rôle distinctif ni au niveau des mots, ni au niveau des morphèmes (Di Cristo, 1998). En effet, selon Di Cristo, le français possède un seul accent rythmique, que l’auteur caractérise aussi de logique, objectif, d’intensité, normal et interne et qui est régulièrement assigné à la dernière syllabe pleine du dernier item lexical du syntagme ou du groupe accentuel15. En revanche, pour d’autres linguistes comme Vaissière (1991), le français, comparé à l’anglais, est une ’langue de frontière’, voire une langue qui ne possède aucun accent (Rossi, cité par Di Cristo, 1998), tandis que pour Dell (1984) la véritable règle d’assignation de l’accent en français serait liée à un principe d’eurythmicité. Cette règle serait donc indépendante de la structure syntaxique et aurait comme effet de permettre à l’accent d’apparaître de la meilleure façon possible pour équilibrer les phrases du point de vue rythmique.
Enfin, d’autres données sur les particularités supra-segmentales des LR soutiennent l’unicité du français parmi ses parents latins. Ainsi, Martin (1997 ; 1999 ; entre autres) réalise une analyse du système d’assignation de l’accent dans quatre langues romanes (français, italien, espagnol et portugais) et dans une optique phono-syntaxique. L’italien, l’espagnol et le portugais possèdent des règles d’assignation de l’accent comparables, mais différentes de celles du français. En français, l’accent est fixe sur la dernière syllabe d’un syntagme et sa manifestation acoustique consiste en une durée plus importante de la syllabe sous accent ou, éventuellement, dans une pente prononcée de la courbe mélodique. En revanche, les trois autres idiomes néo-latins possèdent des accents variables qui ne se trouvent pas nécessairement assignés à la dernière syllabe d’un syntagme. Pour ce qui est de la courbe mélodique, Martin signale la similarité des contours mélodiques des syntagmes en espagnol, en italien et en portugais qui sont généralement montants sur la première syllabe accentuée.
A l’instar de ces auteurs, il nous semble légitime d’affirmer qu’à côté des spécificités segmentales et notamment vocaliques, le français se différencie des autres langues romanes par ses particularités prosodiques dont le développement est unique au sein de la famille des langues néo-latines. Ces particularités concernent notamment le statut de l’accent qui est fixe selon certains auteurs ou inexistant selon d’autres, comme nous venons de le voir. Quoi qu’il en soit, ces différences au niveau prosodique situent le français à l’écart des tendances caractéristiques de la romanité.
Au terme de cette discussion sur le français, nous allons résumer les principaux aspects que nous avons pu remarquer. Il faut tout d’abord noter que la caractéristique essentielle du français concerne l’équilibre interne conféré à la langue par un vocalisme ample et mouvant et par un consonantisme quasi-prototypique. La spécificité sonore de cette langue est donc imprimée par une grande diversité vocalique, doublée par le caractère rare de son axe antérieur arrondi parmi les langues du monde (Vallée, 1994).
Cette unicité est renforcée par la présence de la nasalité vocalique et notamment par celle des nasales d’aperture moyenne qui, selon Ruhlen (1974), se retrouvent dans uniquement trois langues du monde (les deux autres étant des dialectes bretons). Enfin, l’accent fixe est également caractéristique du français et il rend cette langue unique aussi bien parmi ses soeurs latines que parmi les autres langues européennes.