c). Réalisme social et trame narrative : les allers et retours
La Gueule ouverte est une fiction qui peut être divisée en trois grands moments, qui correspondent justement aux principaux déplacements de la mère malade.
Tout d’abord, elle est chez elle, à Paris et est encore valide ; elle reçoit son fils à manger et discute de sa vie et notamment de l’époque passée avec Roger, le garçu (Hubert Deschamps), son ex-mari qui vit encore en Auvergne.
La deuxième grande séquence est la vie à l’hôpital et la dégradation de son état de santé ; les amis, son fils Philippe, Nathalie et le garçu viennent la voir encore consciente. La réunion familiale prend forme au fil des plans.
Enfin, la vie en Auvergne est le troisième moment important du récit. Monique très affaiblie voire inconsciente a été recueillie par le garçu qui en a désormais la charge. Philippe rejoint son père pour l’aider à s’en occuper tandis que Nathalie fait une brève apparition.
C’est cette dernière partie qui va plus particulièrement nous intéresser car elle reflète l’organisation générale du récit de ce film.
Du point de vue de la structure générale, cette partie du récit est composée ainsi :
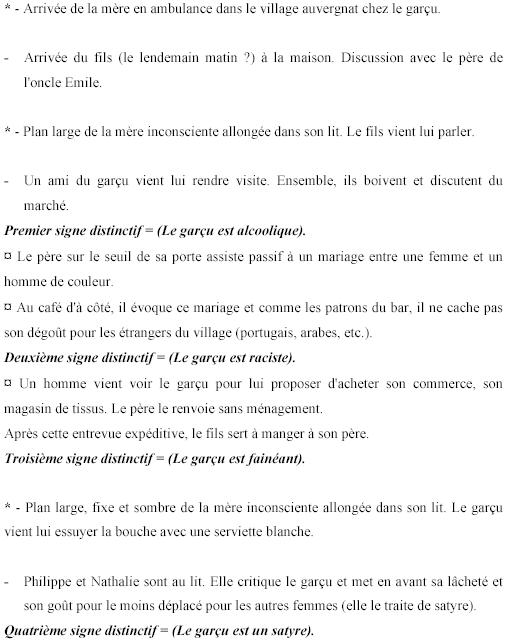
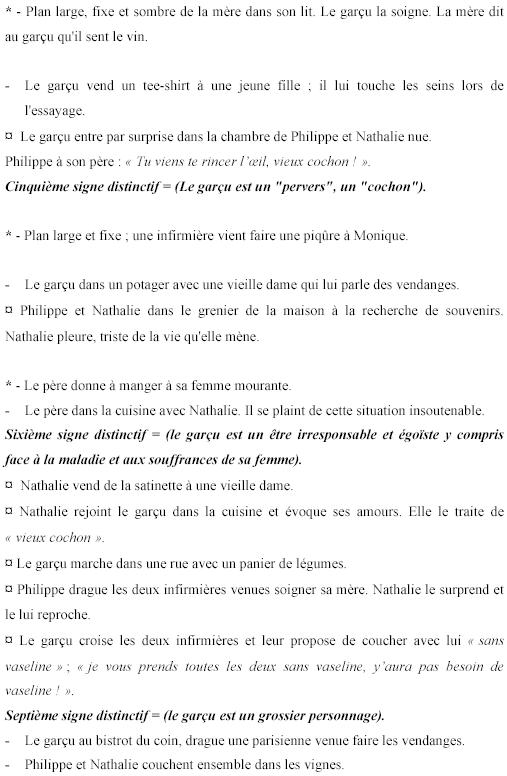
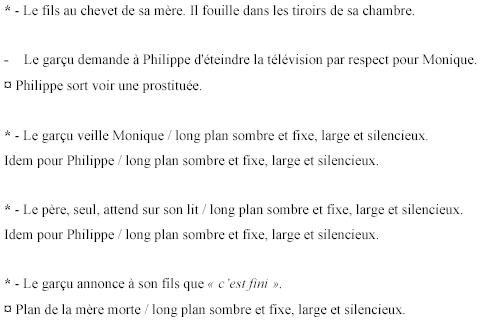
Que nous inspire ce long découpage séquentiel ?
Le découpage de cette longue séquence en Auvergne soulève plusieurs idées.
Nous pouvons tout d’abord constater que le récit s’organise de manière flagrante sur les bases d’allers et retours (de déplacements) quasi constants entre des séquences montrant la mère mourante dans sa chambre (souvent en un seul plan) et des séquences de vie quotidienne dont le garçu assure le déroulement (il est au centre des actions et on le suit à travers le village lors de ses diverses promenades).
Ainsi, se mettent en place clairement deux catégories ou deux niveaux narratifs.
Le premier niveau est constitué de longs plans (désignés par un (*) dans notre découpage), tous sombres, fixes et très larges où l’on assiste impuissants (comme les personnages du film) à la mort lente de la mère.
Le second niveau est constitué de séquences qui n’influencent en rien le premier niveau et qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Le récit est donc fondé sur ce(s) déplacement(s) incessant(s) ; à savoir que l’on nous montre la mère dans sa chambre et ensuite on revient à une scène banale de la vie quotidienne menée par le garçu qui devient de ce fait le principal personnage du film.
Ces allers et retours réguliers mettent en avant non seulement, une trame narrative claire (la maladie de la mère et l’accentuation de ses souffrances) mais également une série de séquences plutôt réalistes (qui présentent le réalisme social de la vie quotidienne et banale du garçu en Auvergne).
Pouvons-nous vraiment avancer que les scènes de vie quotidienne vécues par le garçu sont des moments qui relèvent plus d’une esthétique documentaire ?
Qu’est-ce qui nous permet également d’avancer que les scènes où l’on voit la mère mourante dans sa chambre, assurent la seule trame narrative (et du coup l’identité fictionnelle (?)) du film ?
Ainsi, ne nous trompons pas de sujet quant à la question du réalisme chez Pialat qui n’a de cesse, dans La Gueule ouverte, de proposer deux niveaux narratifs se succédant à travers le parcours de la mère mourante et celui du père dont les activités quotidiennes ne sont pas forcément rattachées à une documentarisation du film.
Ces moments, qui présentent le père dans sa vie en Auvergne, relèvent bien d’une fiction mais sont tellement réalistes et non-narratifs, qu’ils pourraient être considérés, au premier abord, comme des passages documentaires.
Alors, au lieu de rentrer dans des réflexions qui mettent en perspective les notions de « réalisme » et de « documentaire » au sein d’une fiction au cinéma, relevons que, chez Pialat, tout film est une fiction contenant différents niveaux dont certains sont non-narratifs.
Aussi, par souci de ne pas nous égarer dans des réflexions que certains ont souvent mis en avant, quant au sujet du documentaire, de la fiction et de leur association, revenons à l’analyse que nous avions commencé à mener avec notre découpage proposé en amont, car comme le note très bien Guy Gauthier158, la part documentaire (chez Pialat) doit sans doute se chercher dans une démarche de tournage mis en avant par le montage plus que dans une étude du récit, dont le contenu fait davantage référence à une esthétique réaliste qu’à une esthétique documentaire.
Nous avancions que le récit s’organisait sur l’alternance régulière de séquences montrant la mère au lit et le père au sein du village.
Or, rien, c’est-à-dire aucun événement, ne vient bousculer une certaine quotidienneté et l’authenticité d’une vie vécue dans le paisible village auvergnat.
Comme l’a noté André Bazin et nous retrouvons Pialat dans ses écrits, Vittorio de Sica a construit son film Voleur de bicyclette sans enjeu dramatique soutenu ; le drame a par conséquent une autre place et une autre fonction dans le récit qui engendrent l’idée d’une certaine pureté du cinéma.
‘ « C’est le mérite de de Sica et de Zavattini. Leur Voleur de bicyclette est construit comme une tragédie, à chaux et à sable. Pas une image qui ne soit chargée d’une force dramatique.Le film se déroule sur le plan de l’accidentel pur : la pluie, les séminaristes, les quakers catholiques, le restaurant...Tous ces événements, semble-t-il, sont interchangeables, aucune volonté ne paraît les organiser selon un spectre dramatique. La scène dans le quartier des voleurs est significative. Nous ne sommes même plus très sûrs que le type poursuivi par l’ouvrier soit bien le voleur du vélo et nous ne saurons jamais si sa crise d’épilepsie était simulée ou véridique. En tant qu’ « action » cet épisode serait un non-sens, puisqu’il ne mène nulle part, si son intérêt romanesque, sa valeur de fait ne lui restituait par surcroît un sens dramatique. C’est en effet au-delà et parallèlement que l’action se constitue, moins comme une tension que par « sommation » des événements. Spectacle si l’on veut, et quel spectacle !, Voleur de bicyclette ne dépend pourtant plus en rien des mathématiques élémentaires du drame, l’action n’y préexiste pas comme une essence, elle découle de l’existence préalable du récit, elle est l’« intégrale » de la réalité. La réussite suprême de de Sica dont d’autres n’ont fait jusqu’à présent que s’approcher de plus ou moins près, c’est d’avoir su trouver la dialectique cinématographique capable de dépasser la contradiction de l’action spectaculaire et de l’événement. Par là, Voleur de bicyclette est un des premiers exemples de cinéma pur. » 159 ’
Ainsi, les scènes montrant la vie du père au coeur du village, sont comme sous-tendues et presque dépendantes des scènes montrant la mère mourante, car l’attente de sa mort est le moteur du récit. On sait que dès que la mère mourra, le film se terminera et le garçu retournera à la vie qui était la sienne avant qu’elle ne vienne ; il stoppera tous les soins apportés à sa femme alitée pour se consacrer uniquement à ses occupations quotidiennes. C’est dans ce sens que les scènes de la mère au lit représentent la trame narrative du film ; cette attente devient un enjeu à sa manière, dans la mesure où elle supporte tout le reste du film. La vie du garçu s’organise autour de la toilette et des soins qu’il doit assumer vis-à-vis de sa femme et la narration du coup, s’organise aussi autour de cette attente. Le véritable sujet du film est-il la vie d’un homme en Auvergne ou la mort lente et douloureuse de sa femme venue le rejoindre malgré elle ?
‘ « La vocation de chroniqueur de Pialat s’affirme ici de manière triple puisqu’il nous offre une chronique à la fois provinciale, sociale et familiale (cette dernière l’emportant sur les autres et les résumant).Chronique provinciale, d’abord, qui nous permet de retrouver l’univers arrêté de L’Enfance nue et de quelques scènes de Nous ne vieillirons pas ensemble. La boutique paternelle avec ses rares clients ouvre sur une place de village dont le seul point de vie est constitué par le bistrot local, d’un « modernisme » absurdement daté, lieu de ralliement de parisiennes venues « faire les vendanges », et porteuses, à mots couverts, de promesses sexuelles dont la réalisation apparaît au père de Philippe plus problématique à chaque nouvelle saison. Il se greffe sur ce film un rappel non négligeable de l’expérience de Pialat dans le documentaire ; de son double passé de monteur et de documentariste, le cinéaste n’a, on le sait, guère retenu que la première en l’amplifiant par le biais d’une dramatisation minime, constamment tenue dans des limites strictes. Inversement, les évocation de ces rites de café, de ces repas (rappelons les scènes si proches de L’Enfance nue) sont autant de points d’ancrage, de moyens d’asseoir et de vérifier par le concret (et en particulier par l’appel aux non-professionnels) la réalité des événements toujours singuliers que son cinéma recrée. » 160 ’
La vie du garçu est (devient par la force des choses) le sujet (principal) du film (la mort de la mère est ainsi reléguée au second plan) mais le déplacement s’opère également à autre niveau : la vie que vit Nathalie semble être celle que Monique a vécue trente ou quarante auparavant lorsqu’elle vivait encore avec le garçu. A travers Nathalie et à travers la vie qu’elle mène avec Philippe (le fils du garçu), on comprend le passé douloureux de la femme qui est en train de mourir. Le fils ressemble au père et cela semble être une fatalité chez Pialat. Les choses sont là et se répètent quoi qu’on y fasse. Plusieurs fois, Nathalie dira à Philippe qu’il ressemble à son père : preuve aussi qu’elle en a conscience.
Le « déplacement » est ici synonyme de « reproduction » inconsciente et l’on s’attardera sur cette idée dans la dernière partie de notre travail.
‘ « Chronique sociale aussi, puisque nous y retrouvons ces milieux modestes si rarement évoqués de manière aussi précise avec leurs vertus (la lucidité douloureuse et souvent impatiente des femmes, jeunes ou vieilles) et leurs aspects les plus médiocres (la mesquinerie, l’étroitesse d’esprit, et cette résignation attentiste entrecoupée de brusques élans de rage égoïste et velléitaire). (...)Dans cette famille étroitement fermée sur elle-même, minée par des haines sourdes ressassées à l’infini sous une forme codée, elliptique, les situations des deux femmes se répondent curieusement. Au ressentiment de Monique à l’égard d’un mari infidèle correspond celui, méprisant et plus agressif de l’épouse jeune (Nathalie), qui voit se profiler en son partenaire l’ombre du vieillard pitoyable et grotesque qui « traîne sa vie » de fille en fille, de cuite en cuite. » 161 ’
La deuxième idée forte qui ressort de ce découpage est liée à la fluidité de certaines séquences qui s’enchaînent les unes après les autres comme pour ancrer encore un peu plus un réalisme social propre à la vie que mène le garçu en Auvergne. La chronologie temporelle est respectée le plus souvent et affirme l’idée d’une certaine réalité quotidienne vécue par chaque personnage. Ainsi, il est fréquent de voir s’écouler une journée entière dans le village où l’on voit, par exemple, le garçu aller au bar ou discuter avec des amis avant de clore la journée par un retour au sein de la maison, où seront mis en place les soins et les visites tardives accordés à Monique.
De nombreux signes nous font croire que des séquences sont liées temporellement les unes aux autres. Un seul exemple : le garçu demande à Philippe d’éteindre la télévision par respect pour sa mère malade ; ce dernier n’apprécie pas et va à l’hôtel pour retrouver une prostituée. On suppose que ces deux plans sont liés et que la réaction de Philippe est la réponse à la réflexion de son père. Il fuit la maison, s’en va à l’hôtel trouver de la compagnie pour fuir son père et l’ambiance qu’il fait régner dans sa propre maison.
La journée est donc rythmée par ce genre de situations liées les unes aux autres et le récit récupère également ce rythme ’journée / soirée’ en alternant donc les deux niveaux narratifs évoqués précédemment.
Des enchaînements réguliers (matérialisés par le signe « ¤ » dans notre découpage) matérialisent cette continuité temporelle et ancrent encore davantage cette idée de quotidienneté.
Prenons l’exemple du plan où l’on voit le père marcher avec un panier de légumes dans le village. Juste après ce plan, on voit Philippe discuter dans la cuisine avec deux infirmières venues soigner sa mère (Nathalie viendra dans le même plan et après le départ des infirmières, reprocher à Philippe son attitude vis-à-vis de ces deux femmes). Succèdera à ces deux plans un dernier qui montre le père avec son panier, qui rencontre les deux infirmières sur son chemin.
On constate donc que ces trois plans sont rivés les uns aux autres car ils sont le résultat d’une construction spatio-temporelle précise. On imagine ainsi que, lors du trajet du père à travers le village, le fils aura, pendant ce temps (montage alterné) discuté avec deux personnes qui retrouveront juste après le père sur le seuil de sa maison.
Le déroulement du temps est travaillé de manière à ce que l’ellipse temporelle ou tout problème de cohésion spatiale soient évités. Le réalisme se met en place grâce à ce travail de cohérence et d’unité spatio-temporelles. Mais plus encore, on constate que le père et le fils ont la même réaction vis-à-vis de ces infirmières, remarque qui aura son importance dans la suite et fin de notre progression.
Dans le même type de réflexions, souvenons-nous de la promenade familiale sur les bords de la rivière dans Van Gogh.
La caméra se déplace de petits groupes en petits groupes et du coup, ces déplacements spatiaux engendrent une sorte de fluidité temporelle qui nous fait croire et accepter l’idée que ces personnages parlent en même temps de choses différentes dans des endroits différents. Théo discute avec Gachet, Vincent avec une autre personne, etc. et tous le font au même moment. Mais, nous reviendrons plus loin sur ce travail de la temporalité à mettre en relation étroite avec une construction particulière de l’espace filmique car certains exemples précis nous interpellent déjà, en nous faisant penser que cette cohérence peut être aussi teintée parfois d’une déconstruction que l’auteur impose volontairement au spectateur, par le biais d’un travail intéressant sur ses personnages et sur leur évolution au sein du temps et de l’espace filmiques.
Abordons à présent le dernier point que soulève ce découpage.
Il met en avant, comme nous l’avons indiqué, des signes distinctifs relatifs au caractère du personnage interprété par Hubert Deschamps (le garçu). Ainsi, si ces scènes de vie quotidiennes n’apportent rien d’un point de vue narratif ou plutôt, si ces scènes ne contribuent pas réellement à faire progresser un récit basé essentiellement, comme
nous l’avons dit, sur l’attente de la mort de Monique162, elles contribuent fortement à affirmer les caractères et personnalités propres à chacun des personnages (en l’occurrence Nathalie, le garçu et Philippe) qui entourent la mère. C’est dans ce sens, dans l’enchaînement d’événements déterminants, que ces scènes apportent une contribution narrative au film ; elles ne font pas vraiment évoluer le récit mais elles lui apportent une sorte de consistance narrative.
Difficile aussi de ne pas penser à nouveau à Bazin et à ses écrits sur le cinéma italien ; cinéma qui présenterait selon lui (et comme chez Pialat) des faits, des signes plus que des événements (dramatiques) comme support de la narration néoréaliste :
‘ « L’unité du récit cinématographique dans Païsa n’est pas le « plan », point de vue abstrait sur la réalité qu’on analyse, mais le « fait ». Fragment de réalité brute, en lui-même multiple et équivoque, dont le « sens » se dégage seulement a posteriori grâce à d’autres « faits » entre lesquels l’esprit établit des rapports. Sans doute le metteur en scène a bien choisi ces « faits », mais en respectant leur intégrité de « fait ». Le gros plan du bouton de porte auquel je faisais allusion tout à l’heure était moins un fait qu’un signe dégagé a priori et par la caméra, et qui n’avait pas plus d’indépendance sémantique qu’une préposition dans la phrase. C’est le contraire du marais ou de la mort des paysans.Mais la nature de « l’image-fait » n’est pas seulement d’entretenir avec d’autres « images-faits » les rapports inventés par l’esprit. Ce sont là en quelque sorte les propriétés centrifuges de l’image, celles qui permettent de constituer le récit. Considérée en elle-même, chaque image n’étant qu’un fragment de réalité antérieur au sens, toute la surface de l’écran doit présenter une égale densité concrète. C’est encore le contraire de la mise en scène genre « bouton de porte » où la couleur du ripolin, l’épaisseur de la crasse sur le bois à hauteur de main, le brillant du métal, l’usure du pène sont autant de faits parfaitement inutiles, des parasites concrets de l’abstraction qu’il siéra d’éliminer.
Dans Païsa (et je rappelle que j’entends par là, à des degrés divers, la plupart des films italiens), le gros plan du bouton de porte serait remplacé par « l’image-fait » d’une porte dont toutes les caractéristiques concrètes seraient également apparentes. Pour cette même raison la conduite des acteurs veillera à ne jamais dissocier leur jeu du décor ou de celui des autres personnages. L’homme lui-même n’est qu’un fait parmi d’autres auquel aucune importance privilégiée ne saurait être donnée a priori. » 163 ’
On apprend petit à petit au fil des scènes et par le corps (les gestes remplacent tout dialogue ou tout recours à la psychologie)164, que le garçu (comme son fils d’ailleurs, Nathalie le soulèvera) est un alcoolique (nombreux sont les plans où on le voit au
bar), un ’satyre’ (par trois fois, il se permettra des actes douteux avec des femmes comme par exemple avec la jeune fille qui viendra acheter un maillot et qu’il se permettra de toucher au niveau des seins), qui aime les femmes, qui est raciste (il parlera de sa haine des étrangers avec le patron du bar et sa femme) et désagréable avec son entourage (il sera plus que désagréable avec la personne qui lui proposera d’acheter son commerce). Au fil du temps et au fil des faits, le personnage se dévoile comme un être particulièrement irresponsable et égoïste, ce qui accentue indirectement (ou par déplacement) le passé douloureux et les souffrances de Monique dont on comprendra aussi par les autres personnages et leurs dires, qu’elle n’aura pas eu une vie facile à ses côtés. C’est donc par le dévoilement d’un caractère (celui du garçu), par la représentation de sa personnalité au quotidien ou dans des scènes quotidiennes, par son rapport à l’espace (visites au bar, promenades dans le villages, etc.) et par les dires et les détails avancés par les autres personnages extérieurs (Philippe et Nathalie) que l’on apprend finalement ce qu’a été la vraie vie de Monique. C’est donc par un effet de déplacement ou de vases communicants entre plusieurs personnages que l’on comprend au bout du compte la vie d’une mourante qui ne peut s’exprimer.
La psychologie des personnages importe moins que leurs signes distinctifs comportementaux. La parole n’est plus ; Monique ne peut raconter sa vie, elle nous est donc racontée au présent et plus encore, au quotidien à travers les actions et attitudes d’un être désespérant qui incarne physiquement (par les « faits » et l’« apparence ») toutes les souffrances et les ratés de la vie de son ex-femme.
Au final, nous sommes face à des faits et non face à des événements ; l’événement importe peu dans la construction narrative. Les signes, les détails et les scènes présentant la réalité quotidienne du garçu ne contribuent en rien à une évolution narrative du film, fondée davantage sur une accumulation de faits - que Bazin voyait aussi chez Rosselini -, que sur une succession linéaire ou chronologique d’événements165.
‘ « D’ordinaire, sans doute, le cinéaste ne montre pas tout - aussi bien est-ce possible -, mais son choix et ses omissions tendent cependant à reconstituer un processus logique où l’esprit passe sans peine des causes aux effets. La technique de Rossellini conserve assurément une certaine intelligibilité à la succession des faits, mais ceux-ci n’engrènent pas l’un sur l’autre comme une chaîne sur un pignon. L’esprit doit enjamber d’un fait à l’autre, comme on saute de pierre en pierre pour traverser une rivière. Il arrive que le pied hésite à choisir entre deux rochers, ou qu’il manque la pierre ou qu’il glisse sur l’une d ‘elles. Ainsi fait notre esprit. C’est que l’essence des pierres n’est pas de permettre aux voyageurs de traverser les rivières sans se mouiller les pieds, non plus que celle des côtes du melon de faciliter le partage équitable par le pater familias. Les faits sont les faits, notre imagination les utilise, mais ils n’ont pas pour fonction a priori de la servir. » 166 ’Sauter de pierre en pierre, traverser la rivière, errer 167 au sein du flux narratif filmique : tel est le déplacement du spectateur, telle est la démarche à accomplir face à un film de Pialat qui nous propose justement de passer, d’évoluer sans se mouiller les pieds d’une trame narrative (le plus souvent déjà consumée ou dévoilée par avance) à une démonstration purement réaliste, qui convoque aussi la question d’une identité documentaire au sein d’une oeuvre hybridée.
La Gueule ouverte propose cette ouverture et donne au spectateur la possibilité ou le devoir de franchir le cap des frontières établies entre deux histoires, deux fictions réalistes (celle de la mère et celle du père qui se retrouveront dans la même maison), dont la force narrative n’existe plus pour l’une et l’autre, comme si le réalisme documentaire du film avait rogné ou altéré brusquement toute perspective de mouvement, de changement, de bouleversement au sein du récit.
Le verre de vin pris à table très tôt dans la matinée, sa démarche lente et son dos courbée, sa nonchalance, la manière qu’il a de parler aux autres, sont autant d’attitudes précises qui contribuent à la construction psychologique du personnage. Son corps parle pour lui : lorsque le personnage fume, boit son verre de vin, fait la vaisselle ou lorsqu’il s’introduit dans la chambre de son fils et de sa belle-fille...autant de comportements physiques, de signes significatifs d’un état d’esprit, d’un caractère et d’un réalisme social finalement très prononcés.168
Chaque signe réaliste (relatif au personnage et à son milieu) devient un élément narratif à sa manière car il raconte l’histoire d’un homme, non plus à travers ses « actions » mais bien à travers ses faits et gestes ; chaque scène où l’on voit Monique allongée dans son lit devient une description atroce de la mort, de toute mort quelle qu’elle soit.
Raconter, décrire sous la vision la plus réaliste qui soit, toute histoire qui n’échappera pas aux règles de la fiction, c’est aussi et surtout pour le cinéaste, le moyen d’imposer ou de proposer à sa narration, un regard et une démarche documentaire, que nous allons tenter d’étudier dès à présent.