6.2.5 Dernières objections
Il ne reste donc guère que deux objections possibles au maintien de Patusan à Patusan :
- Joseph Conrad n’a jamais visité le Sarawak
- Le Patusan du roman est sous autorité néerlandaise.
La première de ces deux assertions est indubitable. Alors que la Sarawak Gazette liste chaque mois dans ses rubriques ‘Passengers’ ou ‘Our Notes’ tous les passagers occidentaux qui empruntent l’un des bateaux desservant l’Etat au départ ou à l’arrivée, jamais le nom de Conrad, Konrad, Korzeniowski, ou patronyme approchant, ne se lit dans les numéros consultés sur microfilm à la Sarawak Museum Library, et qui s’étendent de 1879 à 1902 sur trois bobines.
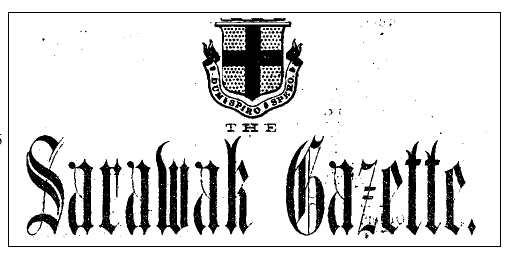
Mais cela prouve seulement que le savoir de Conrad sur le Sarawak à l’époque de Lord Jim était purement livresque : personne ne songe à contester ce point, qui confirmerait plutôt, tant l’écrivain craignait d’être pris en défaut sur sa connaissance de l’Archipel, que Patusan soit resté là où il l’a trouvé.
La deuxième assertion serait plus décisive : « He traded in so many [native States], and in some districts – as in Patusan, for instance – his firm was the only one to have an agency by special permit from the Dutch authorities » (Conrad 1900, p.227) ; « He had obtained from the Dutch government a special authorisation to export five hundred kegs of it to Patusan » (Ibid., p.362).
Patusan serait donc sous domination néerlandaise, ce qui nous ferait quitter le Sarawak pour revenir du côté indonésien… et rendrait tout à fait incompréhensible ces questions des délégués locaux : « Were the Dutch coming to take the country ? » (Ibid., p.252). Car si Patusan est batave, pourquoi les Néerlandais ont-ils encore besoin de « prendre » le pays ?
On aurait d’autant plus de mal à bâtir (ou à détruire) une thèse sur une fondation aussi vacillante, qu’on ne sait trop si les « authorisation » et « permit » délivrés par les Néerlandais sont des permis d’importer les marchandises et les armes dans un Patusan qu’ils contrôleraient, ou seulement de les exporter (« a special authorisation to export » (p.362)) à partir de Semarang vers un Patusan indépendant.
Il semble de plus que, vue d’Europe, où Conrad escompte son lectorat, la distinction entre les parties non encore britannique (Charles Brooke règne toujours à titre privé) et néerlandaise de l’Asie du Sud-Est ne soit pas plus nette que, vue d’Asie, la distinction entre Angleterre et Ecosse :
‘His late benefactor, it is true, was a Scot – even to the length of being called Alexander M’Neil – and Jim came from a long way south of the Tweed ; but at a distance of six or seven thousand miles Great Britain, though never diminished, looks foreshortened enough even to its own children to rob such details of their importance. (Conrad 1900, p.230)’C’est qu’en effet le ‘Treaty Between the Britannic and Netherland Governments’ (signé à Londres le 17 mars 1824) ne mentionne pas Bornéo (cf supra, 5.4.1), « and thus left its relation to the Dutch and British spheres of influence ambiguous » (Andaya 1982, p.125). Du moins, aussi ambigu que l’est sur ce point le texte conradien, bien qu’ensuite les Pays-Bas reconnussent le Sarawak…
Ces dernières objections sont donc fort peu conclusives. On ne voit toujours pas nettement pourquoi Patusan ne pourrait pas être à Patusan.
Aussi, jusqu’à preuve du contraire, tiendra-t-on ici que les « noms de pays » restent tous significatifs, sans qu’il soit besoin de pousser trop loin la subtilité.
Car on pourrait encore remarquer que le choix du Batang Lupar comme lieu métaphorique du « passage » de Jim d’un stade à un autre (en franchissant cette « brêche » exploitée d’Ovide à Paul Auster en passant par Shakespeare et la Chanson de Roland) est plus judicieux qu’il ne semble si l’on songe à une carte de Bornéo dressée par Fra Mauro. « The spectacular bore on the Batang Lupar » en effet, « which does indeed wreak havoc on its passage », aurait fait croire au navigateur italien du XIVe siècle Odoric de Pordenone (franciscain parti entre 1316 et 1318 et arrivé en Chine par bateau en 1322), que l’estuaire du fleuve était en réalité une « dead sea, which rushed ever southward carrying death and destruction with it » (Nicholl 1980, p.200). « Odoric had only heard of [the bore] and presumed that it was continual and not tidal, in which case it must have had an outlet » (Ibid.). Il est vrai que Thomas Suárez situe la « mare mortuum » d’Odoric dans ce qui semble être le Golfe de Siam ; mais c’est qu’il mêle le récit de ce dernier à celui d’Ibn Battuta (Suárez 1999, p.105). Quoi qu’il en soit, c’est l’hypothèse d’un Batang Lupar trans-bornéen que retient le moine bénédictin Fra Mauro quand, dans son abbaye de San Michele, sur l’île de Murano à Venise, il dessine sa carte de « Giava Major » (Bornéo), entre 1433 et 1459 (Figure 7). Les contours de la côte nord ne sont pas si loin de la vérité, mais le Batang Lupar fait comme le fleuve Congo de Diego Cão qui croyait en 1484 y avoir enfin trouvé le passage vers les Indes à travers l’Afrique (Dyson 1991, p.69) : il transperce la terre de part en part, formant ainsi une brêche vers un autre monde (inconnu en Asie, et pour cause !).
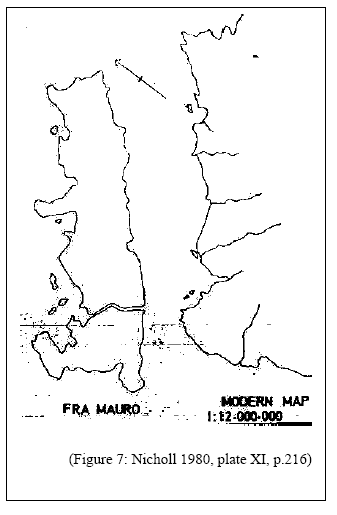
Cependant, comme rien ne dit que Conrad eût connaissance d’Odoric, de Fra Mauro, ou même de Diego Cão 250 , ce n’est là sans doute qu’une coïncidence, troublante mais sans portée.