b) Le choix du français dans les registres consulaires.
Le bas Moyen-âge est le moment où se mettent en place des conditions favorables à l’expansion d’un français commun. Il n’y a pas d’unité dans la langue en France, mais plutôt la coexistence de dialectes 411 . Lorsque l’on évoque cette situation, il faut reprendre une distinction mise notamment en évidence par les travaux de C.Th. Gossen, qui est faite entre la scripta régionale, langue écrite, colorée de traits dialectaux, mais restant lisible cependant dans tout le domaine de langue française, et le dialecte parlé, le parler local tel qu’on devait le pratiquer parallèlement, auquel nous ne pouvons avoir accès, mais dont on peut supposer qu’il possédait des caractères nettement plus marqués que la scripta correspondante, puisqu’on sait que la communication entre locuteurs de provinces différentes était parfois difficile 412 .
L’expansion du « francien », c’est-à-dire du français d’Ile de France qui s’impose comme le français commun par l’intermédiaire de la royauté et du fait de la centralisation de l’appareil judiciaire, provoque le recul des scripta locales 413 . Les provinces qui entourent Paris sont les premières à perdre leurs traits dialectaux ; d’une manière générale, dans le Nord, les scripta régionales s’atténuent au profit du français; en revanche dans le domaine francoprovençal, une certaine concurrence existe entre une scripta dialectale marquée nettement de traits francoprovencaux, et une scripta beaucoup plus « francisée » 414 .
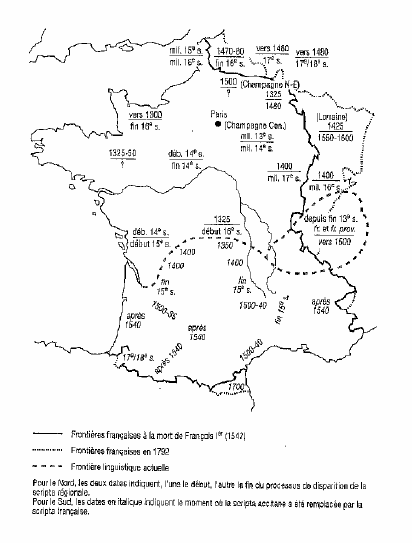
Il est difficile de définir la limite de l’aire du francoprovençal : en effet il ne recouvre pas un pays, n’a jamais été associé à une nation, ni à une province. La zone francoprovençale est pour reprendre une expression de P. Gardette, « un puzzle » 416 au moyen-âge : cette zone comprend le comté de Forez, le comté de Lyon, les comtés de Bresse et Bugey qui dépendent tantôt de la Bourgogne, tantôt de la Savoie, un morceau du Dauphiné, la Savoie, et des cantons suisses sur lesquels l’Empire étend son influence. Ces espaces sont sous protection soit du roi, soit de l’empereur, ou passent par mariages sous la domination de la Bourgogne, de la Savoie ou du Bourbonnais. Leurs frontières restent globalement floues et sont le sujet de multiples débats, notamment pour toute la zone nord, la frontière de la Saône et de la Suisse 417 .
Le francoprovençal constitue comme l’occitan une langue à part entière ; il est la langue maternelle des Lyonnais, le français étant véritablement une seconde langue. Pourquoi les conseillers de Lyon ont-ils choisi de faire écrire les registres des délibérations de la ville en français ? Pour comprendre leurs motifs, il convient de comparer la situation de Lyon à celle d’autres villes de France au XVe siècle : on excepte la moitié Nord de la France, car dans les villes du Bassin parisien, le francien a déjà largement pénétré à cette époque et remplacé les dialectes.
Dans le domaine occitan et provençal, le français a du mal à s’implanter et plus encore à supplanter le latin ou l’occitan dans les documents municipaux avant le XVIe siècle : en 1443, les gens de Millau adressent au Dauphin une supplique en rouergat ; celle-ci étant, pour ce motif, mal accueillie, le conseil de ville est obligé de se mettre en quête d’un secrétaire expert en français 418 . A Albi, les consuls n’adoptent le français qu’en 1540 dans les délibérations municipales, et en 1542 dans les comptes ; à Toulon, le latin est abandonné dans les délibérations en 1540, le provençal dans les comptes en 1545. A Bayonne, Béziers ou Digne, les documents sont soit en latin, soit en dialecte ; à Montpellier la chronique municipale, dite le Thalamus, n’est écrite qu’à partir de 1495 en français ; Arles ne commence qu’en 1503 à employer le français dans les délibérations municipales ; à Marseille, le provençal s’emploie encore à la mairie après 1540.
André Brun en conclut que l’essor du français est lié aux conditions de sa viabilité : les grandes agglomérations, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, l’aident à prendre racine, constituant à la fois un foyer d’appel et un pôle de dispersion. Plus les villes se « convertissent » tard au français, moins celui-ci pénètre dans les régions. Dans la vallée du Rhône, Avignon, qui n’appartient pas au roi de France, se francise plus rapidement que bien des villes du Midi : ville carrefour, ville d’affaires, elle attire marchands et étudiants. Dès 1448, ses statuts sont traduits en français ; à partir des années 1460 on joue des farces et des moralités en français 419 . Comment se fait l’acquisition du français dans un temps où il n’y a pas d’écoles pour l’apprendre ? Elle est liée aux relations et aux échanges : on apprend la langue par méthode directe, en voyageant ; les notaires sont aussi des agents actifs de la diffusion du français dans ces régions.
Le francoprovençal ne se laisse pas plus facilement abandonner que l’occitan ou le provençal, puisque les délibérations consulaires de Grenoble restent en francoprovençal jusqu’en 1538 420 . Il s’agit d’abord d’une question de situation géographique, les provinces frontalières du francien connaissent une évolution différente, qu’elles soient occitanes ou francoprovençales 421 : la Basse–Auvergne, le Forez, le Lyonnais, le Dauphiné septentrional sont francisés depuis la fin du XIVe siècle. L’exemple de la Basse Auvergne, très étudié par A. Lodge 422 , J.P. Chambon et Ph. Olivier 423 , est très comparable à la situation de Lyon. Il existe une différence sensible entre Haute et Basse Auvergne. Les principales villes de la région clermontoise adoptent partiellement le français : vers 1340 à Riom, 1360 à Clermont et Montferrand. Les autres villes de Basse Auvergne l’utilisent fin XIVe-début XVe siècle. La situation est différente en Haute Auvergne, le français reste rare dans les villes avant les deux premiers tiers du XVe siècle. Le changement est encore plus tardif pour toutes les administrations religieuses ou seigneuriales, surtout en milieu rural, puisqu’il n’arrive pas avant le milieu du XVIe siècle. L’abandon précoce de l’occitan dans la région clermontoise se passe entre 1380 et 1410, ailleurs en Basse Auvergne vers 1420 424 ; en Haute Auvergne c’est seulement un siècle plus tard que l’occitan disparaît 425 . Les explications de ces différences sont essentiellement politiques 426 : Jean duc de Berry, apanagiste de l’Auvergne de 1360 à 1416, contribue à la francisation du langage par l’exemple, la mode, par la présence de ses nombreux officiers, ses déplacements dans ses nombreuses résidences dans les villes de Basse Auvergne. Le renforcement de l’influence royale au XVe siècle, notamment par la création du bailliage de Monferrand en 1425 ancre le français dans les pratiques écrites. Riom est la « capitale » de Jean de Berry, depuis laquelle s’exerce sur les villes voisines une grande pression du français ; Aurillac ou Saint-Flour sont trop éloignées pour ressentir une quelconque influence. Cette résistance au français en Occitanie et en Provence est peut-être le fait d’une volonté identitaire : face au pouvoir royal de plus en plus pressant, les communautés s’affirment en conservant leur identité linguistique. La guerre de cent ans a certainement aussi freiné considérablement la pénétration du français de la chancellerie royale.
Le Lyonnais correspond à la partie la plus occidentale du domaine francoprovençal. C’est un choix réfléchi qui conduit les conseillers de la ville à adopter le français dans leurs registres de délibérations. Pour comprendre comment s’est passé ce changement, il convient de faire le point sur la situation de l’écrit avant l’arrivée du français.
P. Gardette 427 , A. Brun 428 , P. Durdilly 429 et E. Philippon 430 ont mené sur des documents lyonnais des XIIIe-XVe siècles, une série de recherches qui portent sur le lexique mais aussi sur la phonétique. Les textes étudiés sont en majorité rédigés en latin, mais il s’en trouve aussi quelques uns en dialecte ainsi qu’en français, bien qu’un peu moins connus 431 . Ces études ont montré que les écrits en français apparaissent dans le dernier tiers du XIVe siècle et après 1350, on passe rapidement de textes dialectaux francisés 432 à des textes français, mêlés de formes et de mots de dialecte 433 . P. Gardette explique que l’on peut donner assez précisément la date à laquelle le français a remplacé le francoprovençal, du moins dans les documents administratifs, puisqu’en 1361 les procès-verbaux d’élections du conseil communal de la ville de Lyon sont en français 434 .
Travaillant lui aussi sur le francoprovençal, Z. Marzys insiste sur le fait que « textes dialectaux et textes français n’appartiennent pas à deux langues distinctes, mais à un continuum où la limite entre dialecte et langue standard se trouve pratiquement effacée. Et le passage d’un type de scripta à l’autre ne s’opère pas comme dans le Midi par substitution mais bien plutôt comme dans le Nord par une évolution continue » 435 . Cette « évolution continue » explique qu’il n’y ait pas une brusque rupture dans les textes lyonnais, mais une persistance du francoprovençal au sein des écrits en français. J. Rossiaud 436 a montré, en étudiant le Livre du Vaillant de 1387, le bilinguisme qui caractérise les élites lyonnaises à la fin du XIVe siècle : ce livre est rédigé en français parsemé de dialectalismes, ce qui fait dire à l’auteur que vers 1400 « les élites urbaines n’ont pas encore du français la familiarité qu’imaginait A. Brun ». Cette situation dialectale perdure : P. Durdilly donne l’exemple de documents dialectaux datés de 1430, comme par exemple la quittance de Guillaume de Grange, secrétaire d’Ainay :
‘« paya le dit Poncet de saint Barthélemy a mey, segretaire d’Enay, treys lampie d’uello que il me devit pour lo servir de la dessus dita vigny, pour lo servir du terme de la Saint Martin mil CCCCXXIX, du qua serveir je lo quitte et de tout lo teyn passa. Escrip et segniat de ma mant, lo premier jor de julliet mil CCCCXXX » 437 .’Les registres de la ville restent un cas particulier puisque s’ils sont rédigés en français dès 1416, ce qui n’est pas le cas de tous les documents du consulat. Les pièces de la comptabilité écrites en langue lyonnaise ne sont pas rares même dans les dernières années du XIVe siècle, comme par exemple les dépenses de 1389 à l’occasion de l’entrée du roi Charles VI 438 . Il faut aussi faire attention à ne pas juger certains documents seulement d’après leurs premières lignes, ainsi le registre de comptes de Jean Tibout (1390-1400) débute par un préambule en français, puis on trouve la plus grande variété : notes et quittances en latin lorsqu’elles sont écrites par le prieur ou les frères d’un couvent, latin ou français lorsqu’elles proviennent d’un notaire, pur dialecte quand le scribe a recopié les notes d’un particulier. Cette situation se prolonge assez longtemps au XVe siècle : la comptabilité de François Loup en 1430 conserve encore de nombreux documents dialectaux ; P. Durdilly cite aussi comme exemples un document datant de 1429, rédigé par Pierre Pochon et Pierre Gontier 439 , et un autre datant de 1446 440 qui sont toujours rédigés en dialecte 441 . L’emploi du parler régional est relativement fréquent dans les documents de la fin du XIVe siècle. Il est évident que l’usage du français n’est pas aisé pour tous, mais à cette date le français est sans doute considéré comme une langue supérieure puisque l’on s’applique à écrire en français dans les registres. Le dialecte n’a pas perdu ses droits, les particuliers, quels qu’ils soient, l’écrivent naturellement.
Le choix du français dans les délibérations est un acte politique, une façon de souligner le rapprochement avec l’autorité royale en imitant la langue de sa chancellerie. En ce sens Lyon évolue de la même manière que la Savoie : la francisation de la cour va de pair avec le rapprochement par mariage avec la France 442 . Lyon diffuse ensuite le français dans toute sa région 443 ; le développement du français à partir de cette métropole n’a rien de surprenant, comme le souligne Ch. Schmitt, « Lyon seul a façonné cette aire linguistique à toutes les époques : pendant la romanisation par le latin plus pur, à la période romane par son indépendance et sa force intérieure, au Moyen-âge et à l’époque moderne par l’adoption et la diffusion de la langue de Paris » 444 .