4/ Whilma : un art d’attente et de mémoire
Pour rencontrer Whilma, femme âgée, il me fallait quitter la ville et rejoindre l’univers si particulier des réserves. Whilma m’avait été « recommandée » par une association de grand-mères engagées les « Intercultural Grandmothers », dont faisait partie la mère d’une amie. Cette association réunit des grand-mères de la région, de toutes origines et de toutes confessions religieuses. Elles confrontent dans le cadre de cette association leurs parcours, leurs histoires de vie, et voyagent à travers toute la province et même le pays afin de faire circuler leurs idées : entraide, respect, éducation. Elles aident au soutien scolaire des enfants sur les réserves comme en ville, elles donnent l’exemple d’une réconciliation possible, elles « construisent des ponts », selon leur propre expression. Whilma avait ainsi de temps à autre participé à leurs réunions.
J’ai donc pris contact avec elle, et elle m’a fixé rendez-vous chez elle, sur la réserve de Carry the kettle, à une quarantaine de kilomètres de Regina. J’étais déjà venu sur cette réserve avec Brian, mon premier contact, ami et informateur cree, que j’avais rencontré lors de mon tout premier séjour à Regina, et qui avait quelques cousins résidant à cet endroit. J’avais même participé là à ma première sweat lodge.
Lorsque l’on arrive sur les réserves de Saskatchewan, on entre dans une sorte d’aire «sauvage», très peu entretenue, avec très peu de moyens. Les routes se transforment immédiatement au passage du panneau indiquant « Indian Reservation », du macadam à la terre, aux cailloux plus ou moins petits ou hostiles, des champs cultivés aux herbes folles de la « prairie ». Le paysage vous inscrit dans l’instant, dans une immensité plane parsemée de joncs très hauts et de très peu d’arbres.
Quelques flaques et étangs où les oiseaux se massent, et, parfois, au détour de longues «routes» sinueuses (je devrais plutôt dire chemins), des petites maisons en préfabriqué semblent surgir de nulle part.
Après l’architecture monolithique, presque stalinienne de Regina dans sa partie la plus récente, où les avenues immenses doivent être traversées presque en courant pour échapper aux voitures (ou plutôt aux énormes quatre-quatre et autres pick-up), l’espace de la réserve donne une impression de liberté, mais aussi d’abandon. Cet univers semble livré à lui-même, en marge tant géographique, qu’économique ou même sentimentale, en friche. Généralement, on est accueilli par des carcasses de voitures rouillées et des chiens aboyant à tout rompre. Les maisons, surtout en hiver, ont l’air seul, abandonné, mélancolique : une sensation de bout du monde.
La maison de Whilma ne ressemble pas à ces maisons-là, elle fait figure d’exception sur la réserve : aux fenêtres, des rideaux, sur les rebords, des bacs à fleurs, autour de la maison, un jardinet entretenu tant bien que mal dans les rudesses de l’hiver des Plaines. La cour est étrangement ordonnée : chacun sa place, l’herbe d’un côté, la terre de l’autre.
Nous garons la voiture (une amie m’accompagne, car je n’ai pas le droit de conduire, et les bus ne desservent pas les réserves), et Whilma pointe son nez, attirée par le bruit, derrière la double porte caractéristique des pays froids. Elle nous fait un petit signe de la main nous appelant à entrer. Nous montons la rampe qui mène à la porte : la plupart des maisons des réserves sont ainsi faites pour isoler un peu le préfabriqué du sol. Il n’y a pas de sous-sol, mais la maison est surélevée, comme sur pilotis. Nous pénétrons dans l’entrée, qui se trouve être la cuisine. Il fait un peu plus chaud, pas tant que ça. Contrairement à l’habitude que j’ai prise en ville de me déchausser en entrant, ici on ne le demande pas : le sol est froid.
Whilma nous serre la main. Je me souviendrai toujours de cette première poignée de main, cela m’avait frappée : enfin une poigne ferme ! En Saskatchewan, les poignées de main sont bien souvent molles et presque timides. Pas celle de Whilma. Elle est toute petite, toute ronde et ridée comme une vieille pomme, comme on le dit dans les contes. Une pomme qui a grandi au grand air, ces rides-là se reconnaissent aisément.
Elle nous fait asseoir autour de sa table de cuisine, et propose les traditionnels thé ou café qu’on vous sert toujours dans les Plaines, quelle que soit l’heure, quelle que soit la saison. La cuisine est moderne, le frigidaire « américain », c’est-à-dire de taille géante, les tasses celles que l’on trouve dans toutes les grandes surfaces, l’une d’entre elles avec un aigle peint, dans un style que l’on trouve beaucoup en Saskatchewan dans les maisons indiennes, sur les tableaux, les tee-shirts, les couvertures, la vaisselle : ce que j’appelle le style « Johnny », en référence aux tee-shirts que portent en France les bikers, fans de Johnny Hallyday. Un dessin « sauvage », aux couleurs tranchées, proche de la bande dessinée, avec des décors évoquant la « wilderness » américaine : aigles, loups aux crocs acérés, ou hurlant face à une lune bleutée et immense, ou encore d’autres animaux non domestiqués, et des Indiens, fiers guerriers emplumés, eux aussi symboles de l’Amérique indomptée…
Une fois bue la première tasse de thé, Whilma nous invite à passer au salon. Nous n’avons pour l’instant que peu parlé, simplement fait les présentations et expliqué ma présence.
Lorsque j’annonce que je suis française, la réaction est bien souvent la même, de surprise et de fierté mêlées : « tu viens jusqu’ici pour me voir, pour me parler ? », et puis de prime abord on imagine souvent que je suis canadienne, comme tout le monde ici est susceptible de venir d’ailleurs : on me pense vénézuélienne ou peut-être même un peu indienne. Mon physique est même devenu un sujet de plaisanterie avec Brian. Il a pris pour habitude, et je crois même qu’il s’agit aujourd’hui d’un de ses « joke » préférés, de me présenter comme sa cousine, indienne ou métisse, venue d’une réserve du Québec : cela explique mon accent et fait appel au fait que je suis française…
Pour Brian, c’est un demi mensonge, puisqu’il me considère un peu comme sa fille, et que, finalement pour lui, français ou québécois, c’est un peu la même chose ! Et les gens le croient la plupart du temps : bien sûr ce ne serait pas vraiment une plaisanterie si Brian ou moi ne craquaient pas et ne révélaient rapidement la supercherie : ce qui l’amuse, c’est de piéger son vieux copain, son cousin…
Cependant, après cette étape, tout est changé : mes interlocuteurs sont troublés et à présent curieux de moi. Finalement, son stratagème m’aide, je crois, à faire passer la pilule : « je suis française et anthropologue ». Dans cette alliance d’identités, de catégories, de « cases » où me ranger, la France, c’est ce qui sauve : « tu es venue de si loin pour nous parler ! », et l’ethnologue c’est ce qui condamne : « Encore un, mais vous n’aurez donc jamais fini ! Allez donc étudier les vôtres ! ».
Les débuts de conversation sont ainsi toujours un peu les mêmes. L’étape suivante est de demander des nouvelles de sa famille, de parler du temps. Parler du temps qu’il fait est essentiel en Saskatchewan, peut-être encore plus avec les Amérindiens : ce n’est pas une conversation normée, qui sert simplement à introduire un processus de communication, c’est véritablement un sujet qui intéresse, et qui prouve l’intérêt porté au pays, à la région et donc aux difficultés qu’éprouvent « les gens d’ici ». « Global warming » est l’expression qui revient sans cesse, avec jeunes et vieux amérindiens : c’est une préoccupation, une inquiétude qui plane. On s’inquiète du fait que les oiseaux ne soient pas déjà partis ou revenus selon les saisons, que les lacs soient de plus en plus souvent asséchés et désertés. Brian dirait : « Mother Earth souffre. Elle nous parle et nous n’entendons pas sa voix. »
Les fermiers ont tous déserté la région, « blancs ou rouges », ceux qui restent survivent grâce aux aides ponctuelles de la province (la plus pauvre du Canada).
Tous les hommes de la réserve ont du se « reconvertir » (les politiques gouvernementales avaient fait des Indiens sur les réserves des agriculteurs, les fixant définitivement sur ces territoires), rien ne pousse, ou ce qui pousse se vend pour rien. Tous les fils de Whilma sont au chômage (ils sont trois), comme la plupart des autres hommes de la réserve. Ils vivent de petits boulots au noir, savent tout faire, de la mécanique à la maçonnerie en passant par la livraison de journaux. Pour travailler, il faut aller « en ville », à Regina, à plus de 50 km de là. Comme je le disais, pas de trains, pas de bus, il faut avoir une voiture : c’est en grande partie pour ça que fleurissent les carcasses sur les réserves. On récupère les voitures à l’agonie, ou abandonnées, et on essaie tant bien que mal d’en retaper une en utilisant les « corps » des autres…qu’on abandonne là où on les a dépouillés.
Beaucoup de jeunes se tuent avec ces « phantom cars », voitures fantômes comme on les appelle. Beaucoup meurent aussi sur le bord des routes en faisant du stop ou en marchant pour aller en ville : ils se font renverser, parfois saouls, parfois « simplement » invisibles, ils font de mauvaises rencontres et ne reviennent jamais, parfois certains meurent même de froid en essayant de rentrer. Cela n’arrive pas si rarement : presque une fois par an, un jeune meurt ainsi à la nuit tombée.
Whilma et les autres n’en parlent pas avec misérabilisme, ils en parlent simplement parce que c’est leur vie, et qu’ils en sont presque perpétuellement tristes. Pourtant, la grande majorité d’entre eux ne voudrait pour rien au monde quitter la réserve et vivre en ville : beaucoup croient que ce serait pire, ils redoutent la violence et le racisme ou, tout simplement, ils ne seraient pas chez eux et « entre eux » et, bien sûr, les aides sociales ne seraient pas les mêmes. Ici, ils peuvent s’entourer de toute la famille : les belles filles, les beaux-frères, les cousins, les grands-oncles. Chacun sur la réserve connaît tous ceux qui y vivent, à qui appartient chaque maison, qui est le fils ou le cousin de qui. Parfois ils s’y perdent eux aussi, mais personne n’est anonyme.
Après le thé, nous nous installons au salon : une pièce assez grande, carrée, avec des banquettes, canapés ou fauteuils tout le tour : un « cercle » pour s’asseoir. Mais, contrairement aux habitudes européennes, pas de table au centre de ce « cercle ». Mary Ann dit qu’ainsi la parole circule mieux, sans obstacle. A ces mots, je repense au « talking circle », technique utilisée dans la résolution des conflits tribaux ou, tout simplement, lors des assemblées de « gestion » des affaires courantes des tribus, clans ou familles.
On s’asseoit en cercle, à égalité dans la discussion, un tour de parole est organisé, parfois relayé par l’utilisation d’une « pierre de parole », un petit caillou que l’on se passe avec la main droite, et que l’on transfère dans le poing gauche pour prendre la parole : côté cœur, pour que les mots soient ceux du cœur et de la sincérité.
Au début, ce « vide », qui fait ressentir chacun comme éloigné à une extrémité de la pièce, me gêne. Puis, au fur et à mesure des conversations et des regards, le vide s’efface et laisse place au plein de cet espace laissé libre aux émotions, aux regards, aux gestes, à tout ce qui circule, se transmet entre nous sans que nous nous touchions.
Whilma a sorti pour moi de ses placards quelques exemples inachevés des broderies qu’elle a en cours : une paire de mocassins pour une petite fille qui va danser bientôt (au printemps) pour la première fois en pow-wow, et une rosace qu’elle a commencé il y a longtemps pour une de ses belles filles, mais qu’elle n’a pas encore pris le temps d’achever. Cette notion de temps revient sans cesse dans sa bouche.
Il faut du temps pour broder : non seulement du temps « temporel », mesurable, mais aussi du « temps dans sa tête », c'est-à-dire de l’espace, de la tranquillité d’esprit lui permettant de fournir la concentration nécessaire à la broderie. Non seulement aux gestes précis pour broder, mais aussi à la réflexion menée pour choisir les motifs, les couleurs et leur association. Elle m’explique qu’elle doit mûrir ses idées, laisser « décanter » ses inspirations, afin de faire les choix vraiment appropriés selon la personne pour laquelle elle brode. Elle me dit que c’est comme une cuisine qui se fait dans sa tête : c’est toujours meilleur quand ça cuit longtemps. Et puis, quand on fait un nouveau plat, on doit toujours tester, et réfléchir aux herbes ou épices qu’on va associer pour trouver le bon goût. Pour que le plat ait vraiment une saveur propre. Sinon, autant suivre une recette bien connue dont on est sûr de la réussite. Autrement dit, sinon, autant refaire un motif classique, connu, déjà éprouvé et apprécié comme une référence.
Pour me montrer, Whilma saisit la peau d’orignal entre ces mains étonnamment larges pour sa petite taille, d’abord de ses deux mains pour bien sentir la matière et la taille de la pièce, son épaisseur aussi, puis d’une seule main, se saisissant d’un piquant teint de l’autre. Ses doigts eux aussi sont courts et épais et le piquant disparaît presque entre son pouce et son index.
Elle le lève de sa main droite à hauteur des yeux et l’examine, « c’est un bon piquant » dit-elle : elle s’assure en cet instant d’expertise de sa texture, de sa longueur, le jauge pour l’accepter ou non. La peau d’orignal est posée sur ses genoux. Elle dépose les piquants choisis dans un petit bol d’eau posé à côté d’elle sur un guéridon.
Ensuite, elle porte le piquant à sa bouche et le coince entre ses dents de devant. Elle le fait glisser sur toute sa longueur de l’intérieur vers l’extérieur de sa bouche : elle semble presque l’engloutir puis le retire d’un air concentré, en veillant à exercer une pression régulière de sa mâchoire pour l’aplatir de façon homogène et expulser ainsi tout l’air contenu, mais sans pour autant le rayer ou, pire, le briser.
Ce geste, elle semble aujourd’hui le faire sans vraiment avoir à se concentrer. Machinalement. Cependant, elle se souvient avoir dû l’apprendre avec application, avant qu’il ne s’imprime dans sa forme la plus parfaite dans sa mémoire, comme une vieille habitude qui fonctionne bien. Sa mère lui a appris, « kayâs », « il y a longtemps », « autrefois » en cree. Elle se souvient de sa mère et de sa grand-mère qui brodaient dans la cuisine ou dans un coin du salon, lorsqu’elle était enfant. Je lui demande comment elles lui ont appris, elle me répond : « je les regardais faire ». Une fois encore les habitudes, les savoirs-faire, semblent inexplicables, ils sont agis, ressentis, inscrits dans le quotidien.
Ils sont la mélodie de l’enfance, ces images, ces sons, ces odeurs qui peuvent en instant vous transporter auprès de votre mère, de votre maison, bien des années après les avoir quittées. Le corps de Whilma est en soi un recueil d’archives : il porte la mémoire, inscrite dans ses mouvements, ses inclinaisons, ses rythmes. Il connaît, quand bien même on a tenté de le faire oublier de force à l’esprit de Whilma, l’héritage de ses aïeules.
En effet, ces souvenirs, Whilma n’a pas pu les transmettre à sa fille, à sa plus grande déception : cette dernière n’a jamais voulu apprendre, elle a toujours dit que cela ne l’intéressait pas, qu’elle n’avait pas le temps. Whilma ajoute que sa fille travaille, qu’elle est tout le temps pressée, mais que peut-être un jour, quand elle sera plus vieille, elle lui apprendra. Elle me dira ensuite, plus tard, que c’est également un peu sa « faute ». Lorsqu’elle est enfin sortie des residential schools, elle n’avait plus le goût à rien, et même la mémoire des siens semblait s’être effacée à tout jamais.
Alors, lorsqu’ils étaient petits, elle n’a pas brodé devant sa fille ou ses fils, elle ne leur a pas « donné le goût », elle n’a pas imprimé au fond de leurs esprits la marque de la tradition, des générations passées. Aujourd’hui, elle le regrette beaucoup.
Elle-même n’a redécouvert la broderie que tardivement, avec le mariage de ses fils, l’arrivée de ses belles-filles et de ses petits-enfants. Elle a alors ressenti le besoin de retrouver sa grand-mère en elle, de retrouver et recréer cet univers qu’elle avait tant aimé avant de lui être arraché. Et malgré les saccages, les cicatrices, les érosions, cette mémoire est revenue, par l’action.
C’est son corps qui se souvenait et avait su retrouver le chemin des images et du savoir-faire : « une mémoire iconique corporelle », comme la désigne Hans Belting 114 (nous reviendrons dans le chapitre suivant, « Tisser des liens entre espaces et temps », sur les liens entre ce triptyque corps/rêve/mémoire).
Whilma le dit, « c’était en elle », « une vraie grand-mère doit savoir faire ce genre de choses ». Alors, elle l’a fait.
Sa mère teintait les piquants dans des fruits écrasés, elle se rappelle l’odeur. Cela marchait plutôt bien, mais elle ne saurait plus faire aujourd’hui. Elle achète parfois ses piquants tout prêts, dans des magasins « pour Indiens », comme Painted Buffalo, à Regina. Mais il a fermé, encore des malversations économiques, pense-t-elle. C’était assez cher, pour peu de piquants. Maintenant, elle trouve des gens qui lui en donnent : des voisins, des amies.
Pour les peaux, c’est la même chose : rien ne vaut un animal qu’on a soi-même chassé, et dont on a tanné la peau avec attention. Elle a essayé une fois d’acheter de la peau commerciale, mais ce n’était pas la même chose : elle était trop dure, trop épaisse, moins souple. Ils ne les travaillent pas assez longtemps, tout doit aller si vite pour être rentable : elle se souvient d’avoir vu ses tantes, sa mère et sa grand-mère se mettre à quatre pour préparer une peau de bison : il faut la tordre, l’assouplir, la mouiller, la racler, la plier et replier des dizaines de fois C’est son grand-père qui se chargeait de tendre et lisser la peau. Pour se les procurer, elle a des cousins plus au nord, vers les lacs et elle envoie aussi ses fils à la chasse.
Elle me montre ensuite comment sa grand-mère faisait, avant de commencer à broder : elle plaçait les piquants sur la peau, « juste pour voir » si la couleur « irait ». Ni trop foncé, ni trop clair comparé à la couleur même de la peau. Elle saisit son aiguille, et commence à fixer et plier un piquant. Ses gestes sont précis, mais lents.
Elle relève régulièrement la tête pour commenter pour moi ses gestes. Des pauses rythment son activité, lorsqu’elle a besoin de replacer son support sur ses genoux, ou quand, péripétie malheureusement assez fréquente, un piquant casse. Malgré toute l’application et le savoir-faire de Whilma, certains piquants résistent à être « domptés » et mis à plat sur la peau. Il faut alors redéfaire le fil qui avait commencé à les fixer. J’admire sa patience…
Elle ne cesse d’incliner et de relever le buste, allant presque coller son visage à l’ouvrage pour accroître peut-être son acuité et sa précision, puis se redressant pour tirer le fil au bout de l’aiguille et constater le résultat obtenu.
Ses lèvres sont pincées, son visage serein, mais concentré. Elle a cessé de parler lorsque l’opération est devenue plus délicate : on ne peut pas bien faire deux choses en même temps. Puis elle m’a reparlé de sa voix lente : « tu vois, c’est ça qu’il faut faire. Mais ma vue baisse, et mes mains sont moins vives qu’avant ! ». Elle ne lisse les piquants qu’avec les dents, elle n’utilise pas de stylo ou de lissoir, finalement son seul outil « non naturel » est son aiguille.
Elle m’explique ensuite que sa mère réalisait toujours le même décor sur ses mocassins, qu’elle appelle le « motif classique assiniboine » (sa mère était assiniboine, son père cree, c’est pourquoi Whilma parle un peu des deux langues).
Le voici, d’après un croquis que j’avais fait sur place :
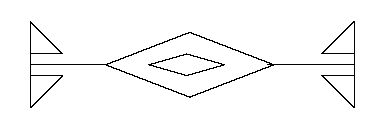
Whilma n’a pas su me fournir plus d’explications sur le nom ou la signification de ce motif. Elle savait seulement qu’il était très usité, et reconnu comme identifiant le travail d’une brodeuse ou d’un porteur assiniboine. Nous verrons dans la dernière partie de ce travail consacré aux motifs qu’il est une des composantes de décor sioux recensé notamment par C. Lyford. Elle me dit choisir également ses motifs dans les livres ou sur des costumes qu’elle voit en pow-wow, réalisés en perles. Elle m’avoue d’ailleurs être bien « meilleure » avec des perles qu’avec des piquants. Elle répète les motifs qu’elle trouve jolis, mais elle change leurs couleurs, ou leurs agencements.
Comme pour Sheila, on retrouve chez elle cette préoccupation : ne pas imiter, ne pas risquer non plus de « voler » un motif personnel, ou peut-être même sacré, qu’elle ne connaîtrait pas.
Aujourd’hui me dit-elle, les jeunes femmes sont fainéantes, elles vont vers les motifs les plus faciles, et utilisent les points les plus simples, donc leurs travaux sont moins beaux, et, surtout, résistent moins bien au temps. On ne respecte plus les anciennes traditions, me dit-elle.
Pourtant certaines étaient pleines de bon sens et évitaient les problèmes : ainsi, elle continue de ne pas adresser directement la parole à son gendre, son mari non plus ne parlait pas directement à ses belles-filles, tout comme son beau-père et elle ne se regardaient jamais dans les yeux. Ces conduites d’évitement avaient selon elle le mérite d’instaurer du respect, de la crainte, de garder une place et un rôle spécifique à chacun. Nous verrons dans la partie suivante (chapitre 2, III/ Des figures de femmes) que ces attitudes, notamment attendues des femmes comme la douceur, le regard « humble », sont toujours vivaces et participent à la transmission d’une certaine conception de la féminité et des identités féminines possibles, « acceptables ».
Au fil de la conversation, Whilma brodait toujours.
Elle avait, semble-t-il, bien conscience qu’elle était en train de se livrer à une démonstration de son savoir-faire : elle me montrait comment faire. Alors, je lui posais une autre question : est-elle différente quand elle brode seule, sans « public » ou sans élève ? Va-t-elle plus vite, écoute-t-elle de la musique, ou allume-t-elle la télévision ?...
« Ah non ! Surtout pas la télévision », me dit-elle, elle ne regarde que son émission préférée, un jeu dont elle trouve l’animateur amusant. Sinon, elle ne la regarde jamais, ce sont ses petits-enfants et ses fils qui la regardent sans cesse. Et elle n’a pas de poste pour écouter de la musique. Non, elle brode seule ou avec des amies, et avec sa belle-fille aussi, parfois. Lorsqu’elle est seule, elle s’installe plutôt sur la table de la cuisine, près de la fenêtre, car la lumière est meilleure et elle peut voir ce qui se passe dehors, regarder son jardin, lorsqu’elle fait des pauses.
Quand elle brode avec des amies, c’est autre chose, « c’est un peu comme une fête » me dit-elle, elles apportent des gâteaux, l’une d’elles fait de merveilleux muffins à l’orange. Elle aussi parfois leur prépare un peu de bannoch à remporter chez elles pour la famille.
On lui a toujours dit qu’elle faisait un très bon bannoch (il s’agit du pain dit « indien », en réalité écossais, frit ou cuit au four, avec de la farine de blé ou de maïs et de la graisse, qu’on mange à toutes les occasions, même parfois encore quotidiennement dans certaines familles). Je lui demande si elle m’apprendrait aussi à faire du bannoch : oui bien sûr, la prochaine fois quand je reviendrai. Ce que nous avons effectivement fait une autre fois.
Donc, elles se réunissent toutes au salon, chacune apporte son petit matériel, elle ont teint les piquants avant, cela fait souvent l’objet d’une autre réunion spécifique, tout comme le « dépouillement» du porc-épic si l’on a la chance d’avoir l’animal entier.
Elles passent ainsi tout l’après-midi ensemble, elles discutent, parlent de leurs familles, de leurs enfants et petits-enfants, de l’école, des soucis, et du temps qui change comme du temps qui passe.
Elles se donnent des conseils, des avis sur les compositions des autres, sur le choix des couleurs, des « recettes » techniques, même si, à force de broder toutes ensemble, elles ont chacune un style et une gestuelle particulière, qui n’a plus besoin d’être discutée par les autres. Elle me précise qu’il y a toujours les mêmes radoteuses qui donneront éternellement les mêmes conseils, et critiqueront sans relâche les gestes qu’elles ne partagent pas : mais à force, c’est une habitude, on répond les mêmes choses, ça lui manquerait plutôt si elles cessaient de le faire. Whilma évoque ainsi Lucy, qui est morte l’année précédente, à 84 ans, qui était une fameuse brodeuse, dont les motifs étaient très fins et très joyeux. Whilma aimait beaucoup son style, léger. Elle brodait surtout des motifs floraux, dans ce que l’on appelle le style « métis », des bois. Pas comme elle, qui ne sait faire que du géométrique. Elle a essayé parfois de broder des fleurs comme Lucy, mais elle n’a pas aimé, les gestes étaient différents, elle n’était pas à l’aise.
Ces réunions sont des moments privilégiés de communion et de partage, où se transmettent les savoirs-faire, où les styles et les influences également circulent entre les femmes qui s’inspirent les unes les autres, tout en gardant chacune « leur patte ». Elles partagent tout autant leurs soucis, leurs joies, se remémorent le passé et s’inquiètent de l’avenir. C’est un présent suspendu, protégé, dans un temps atemporel où passé, présent et avenir sont simultanément mobilisés.
Toutefois, leur activité n’est pas celle d’un club de broderie qui se réunirait dans une salle municipale réservée à leur usage : elles n’ont pas de date ou de période prévue pour ces réunions, qui se mettent en place selon les envies et disponibilités, et se déroulent à domicile, dans des lieux de vie, où toute la famille circule, car ces femmes âgées vivent rarement seules. Elles sont généralement installées chez leur fille, elle-même mariée et mère de famille, moins souvent chez leur fils. Ici, nous sommes chez Whilma et c’est son fils qui est venu s’installer avec sa femme et ses enfants chez elle lorsqu’il s’est retrouvé au chômage. Elle vivait, elle, avec ses deux autres fils, pas encore mariés. Dans cette petite maison vivent donc sept personnes, dont cinq adultes.
Dans ces multiplicités d’âges et de rythmes qui se croisent en un même lieu, le temps de la broderie et sa propre « musique » sont donc souvent interrompus : par le téléphone, par un voisin qui vient rendre visite, par, comme ce sera le cas ce jour-là, le retour des enfants de chez leur tante, parce qu’ils ont finalement décidé de rentrer dormir chez eux, plutôt que de rester là-bas… Et la brodeuse, à tout moment, est donc susceptible d’abandonner puis de retrouver son ouvrage et sa concentration. Nous sommes alors assez loin de la brodeuse de la légende de Shunka Sapa, qui brode éternellement sans être interrompue, même si l’art de l’attente est présent. Whilma brode lorsqu’elle n’a pas autre chose à faire : s’occuper des enfants, de la cuisine, de ses plantes…
Il s’agit de son passe-temps, d’un art de l’entre-deux, tel que le décrit Yvonne Verdier pour la couture dans les campagnes françaises : un art de l’attente. Mais attendre quoi ? La vie : les enfants, le mari, les soucis.
A la nuit tombée, nous devons nous retirer, car Whilma doit retourner à d’autres activités qui passent avant la broderie : leur mère n’étant pas rentrée du travail, elle doit s’occuper de ses petits-enfants. Je prends donc congé, Whilma me met dans la main quelques piquants pour que je m’entraîne pour la prochaine fois, ses yeux me sourient, un peu moqueurs, mais encourageants, et au lieu de me serrer simplement la main comme à mon arrivée, elle m’attire ensuite à elle, contre son épaule, en me donnant de douces petites tapes dans le dos.
Je multiplie les remerciements et, dans le miroir de l’entrée, je vois mon sourire et mes yeux qui brillent.
Je repars charmée, le cœur au chaud. Comme Whilma décrivait avec nostalgie ses souvenirs, j’ai retrouvé moi aussi avec elle un peu des visages familiers qui ont accompagné mon enfance.