2. L’écriture de la folie : confluence du dramatique et du romanesque
La difficulté technique de transposer l’écriture narrative de Giraudoux pour le théâtre réside dans la discipline de la composition dramatique exclusive du caractère polyphonique propre à cette écriture : l’auteur cherche à parler non d’une vie, mais de plusieurs vies. La mort de Geneviève Prat n’est pas une seule mort, car sa mort entraîne la disparition à jamais du souvenir d’autres gens 725 . Quand un cadavre est arrivé dans l’île de Suzanne 726 , celle-ci déchiffre la vie et les moindres manies du mort, elle décrit les moindres détails de sa physionomie et imagine les gens qu’il aurait fréquentés ; ainsi elle apprend tout du cadavre ; mais elle voit arriver après beaucoup d’autres cadavres et évoque également leurs vies sociales et leurs manies, comme si elle tournait page par page de grands volumes d’encyclopédie. Il y a un épisode concernant l’encyclopédie ailleurs : le père du narrateur de Bella a rédigé La Grande Encyclopédie. Les frères de son père sont tous très calés en science, entre autres Jacques, un des oncles du narrateur qui est spécialiste de la faune et de la flore. 727 Parler de ses parents et parler des petites choses qu’ils aiment, c’est ce que le narrateur fait dans ce roman. Si les réflexions que nous avons développées plus haut sur la manifestation du « moi » narratif sont vraiment justes, il faudrait donc que cette pluralité soit aussi transmise sur la scène.
Giraudoux évoque dans La Folle de Chaillot pour la première fois la folie comme thème principal. Il nous semble intéressant de nous demander le rapport, sans doute intrinsèque, entre la transposition théâtrale du tissu polyphonique inhérent au texte de Giraudoux et l’évocation et la mise en scène de figures de la folie au théâtre. Les réflexions qui suivent nous révéleront une chose très curieuse : la manifestation du regard rêveur de la Folle ne coïncide pas seulement avec l’apparition de l’équivalent scénique du « moi » romanesque ; il permet d’entasser dans le texte des figures métaphoriques du théâtre lui-même.
Défiée par le sergent de ville qui dit : « vous ne le rattacherez pas plus à la vie que je ne l’ai fait », la Folle persuade le jeune « noyé », Pierre, de retrouver le merveilleux de la vie et de ne pas se suicider. Toutefois elle n’emploie pas de mot de persuasion mais explique tout simplement sa vie quotidienne. En lui attribuant de longues tirades, Giraudoux fait une présentation de sa vie comme très singulière. La vie de la Folle est revêtue d’une caractéristique remarquable : elle se répète tous les jours !
‘Aurélie : Pour que vous vous sentiez appelée par la vie, il suffit que vous trouviez dans votre courrier une lettre avec le programme de la journée. Vous l’écrivez vous-même la veille, c’est le plus raisonnable. Voici mes consignes de ce matin [...] 728 ’Sa journée n’est certes pas la copie de la journée précédente. Chaque jour est agrémenté de quelques variations de détail. Si elle reprise « les jupons avec du fil rouge » et repasse « les plumes d’autruche au petit fer » ce matin-là, elle fera sans doute d’autres choses le lendemain matin. Pourtant, d’après ses paroles, le programme de sa journée peut être simplifié ainsi : le réveil, la toilette du matin, la lecture du même numéro du Gaulois, la toilette pour aller à la promenade, et la promenade. Ajoutons la sieste qui vient sans doute après la promenade, car Irma signale à la comtesse que « c’est l’heure de votre sieste. Dormez une minute ». Changer le rythme de sa vie ne l’intéresse pas tellement. Au chiffonnier qui lui demande son avis sur l’idée d’envoyer un « sidi » à la duchesse de La Rochefaucauld, la Folle répond : « Envoyez-le-lui... Bonne idée ». Pourtant à Martial qui propose de lui présenter un maroquinier, elle répond « chacun ses fournisseurs, Martial ». Elle refuse poliment la proposition du sourd-muet à propos du curé en disant qu’ « il garde son curé pour lui ».
La même observation sera faite pour son sujet de conversation favori. La première réplique de Gabrielle est : « Adolphe Bertaut demande enfin votre main. J’en étais sûre ! » ; et celle de Constance est : « On a retrouvé ton boa ? » Dans l’acte I, c’est l’histoire répétée de Bertaut et du boa qui semble la plus inopportune et infondée dans le contexte parce qu’à part la Folle, aucun personnage n’a de rapport direct avec cela. Or, les deux répliques des Folles qui commencent l’acte suivant sont révélatrices : chaque fois qu’Aurélie voit ses amies, elle évoque incessamment son souvenir d’amour et son accessoire favori, de la même façon que Constance joue interminablement avec Dicky et que Gabrielle admire son invité qui n’a pas de corps. Ainsi elle « répète » le même programme comme si une actrice répétait son rôle. Elle se prépare comme si une actrice devait se préparer et entrer en scène pour devenir quelqu’un d’autre. Elle incarne le rôle de « la Folle de Chaillot » tous les jours, en quelque sorte.
Nous ne sommes pas seuls à faire ce rapprochement entre le personnage et l’art du spectacle. Louis Jouvet compare également la comtesse Aurélie avec son choix artistique : soumission au texte :
‘ L’invention de l’auteur est première, totale, souveraine et impossible à égaler. Chacun de nous fait innocemment, ingénument, une « réinvention » de cette œuvre en l’écoutant.Pour l’entendre, il s’agit de faire taire en soi toute supériorité, tout sens critique et de s’abandonner, de se perdre dans la diversion qu’elle apporte et le bonheur qu’elle contient.
C’est exactement ce que nous propose la comtesse Aurélie. L’art de vivre, comme l’art du théâtre, est dans une attitude. 729 ’
Aurélie conseille à Pierre de laisser aller la vie sans se soucier de rien. Le principe de base de cette pensée consiste dans le rejet de l’égo. Un des propos rebattus de Jouvet metteur en scène est de laisser « respirer » le texte : sans l’interpréter à force de travail intellectuel, il faut faire entendre le texte jusqu’à ce que le « sentiment » émerge chez l’acteur. C’est ce que rappelle le changement d’humeur de Pierre : entré en scène désespéré, il se laisse prendre par le langage d’Aurélie sans l’interprêter, jusqu’à ce que l’amour pour la vie émerge en lui.
Mais l’argument le plus significatif en ce qui concerne le lien métaphorique entre le théâtre et Aurélie est l’invention du décorateur Christian Bérard, pour le décor de l’acte II. C’est lui qui eut l’idée d’ajouter le baldaquin rouge au dessus du lit. Mais pour arriver à cette idée, il se torture l’esprit, parce que l’indication scénique laissée par l’auteur pour le décor de l’acte II est trop simple :
‘Un sous-sol aménagé en appartement dans la rue de Chaillot. À demi abandonné. La Folle sur un fauteuil. 730 ’L’ambiance du sous-sol où la Folle fait la sieste aurait risqué d’être « celle de l’asile de nuit » comme le dit Gabriel Marcel 731 , si on applique le procédé du naturalisme qui s’attache à «présenter au public un portrait de l’homme avec sa laideur et ses bassesses» 732 . Bérard a besoin d’inventer un décor qui traduise l’irréalisme que le texte contient. Jouvet témoigne de la souffrance, puis de la trouvaille géniale de Bérard :
‘Ce qui inquiétait Bérard était uniquement la vérité, l’évidence de ce décor. Pendant plus de deux mois Bérard l’a cherché à l’aide de tous les documents possibles : études des plans cadastraux, caves, égouts, catacombes et carrières, visitant, scrutant partout où il le pouvait les moindres pistes. A ce point qu’on ne pouvait aller déjeuner chez un ami sans qu’il demandât au préalable à visiter les caves et les greniers. Il a feuilleté les traités d’architecture de Serlio, de Palladio, de Ledoux. A chaque fois il me faisait réciter le second acte et ses obligations. « il faut que ce sous-sol soit haut et il faut au-dessus du lit un baldaquin avec de vieux rideaux », répétait-il inlassablement. 733 ’Quand Jouvet travaille avec Bérard, il lui explique très soigneusement la pièce à monter. Bérard écoute ces explications, les oublie, reprend et au bout d’un moment il se met à dessiner brusquement en abondance et « la pièce brille pendant qu’il parle » 734 . Le travail en équipe de ces deux artistes marche tellement bien pour la création de La Folle de Chaillot que le décorateur trouve des idées originales pour le décor de l’acte II. La connotation péjorative de l’indication « à demi abandonné », qui risquerait de faire penser à la condition misérable d’un sous-sol poussiéreux, n’égare pas le génie de Bérard :
‘[...] dans La Folle de Chaillot, on me demandait une cave pour le deuxième acte. Une cave, cela évoque tout de suite un plafond bas : mais j’ai pensé qu’un plafond bas serait d’un réalisme oppressant et, justement, ce qui a fait le succès de ce décor, sa nouveauté, c’est que j’ai pris le parti opposé : j’ai fait une énorme cave, très haute, qui a surpris mais qui correspond au dramatisme de ce second acte. Et c’est plus mystérieux. 735 ’Ensuite, il ajoute « un baldaquin avec de vieux rideaux » qui couvre le lit de la Folle. Enfin, il est aussi résolu pour la couleur du baldaquin : rouge.
‘Pour créer une atmosphère dramatique, il est bon d’utiliser les rouges. Je savais que, pour LaMachine Infernale, un décor rouge produirait un effet très dramatique ; pour La Folle, le lit rouge est somptueusement dramatique. 736 ’Le décor de l’acte II est loin d’être naturaliste dans la mise en scène de Jouvet. Au milieu il y a un lit qui est couvert de ce baldaquin tout rouge dont le rideau tombe de très haut; l’espace ne ressemble pas à une cave humide, sombre et étroite. La hauteur du plafond et le baldaquin rouge dissipent la tristesse sordide que le sous-sol parisien pourrait suggérer.
Ce décor rappelle un autre travail aussi provocateur de Bérard, le praticable qui a la forme d’une scène encadrée dressé sur le plateau. Il s’agit de l’Illusion Comique de Corneille, mise en scène par Jouvet. Les spectateurs de la Comédie-Française s’en étonnaient en 1937.Dans ce petit théâtre se déroule l’histoire des aventures du fils du vieux Pridamant. La vue spectaculaire de cette représentation restait fraîche, peut-être, non seulement dans la mémoire collective des spectateurs mais aussi pour le décorateur lui-même. Huit ans passés, le décorateur conçoit pour la deuxième fois le décor selon un principe similaire : diviser l’espace scénique en deux parties, la première est enveloppée, la deuxième la cerne. Deux espaces sont séparés, dans le cas de L’Illusion par la petite structure du théâtre, dans le cas de La Folle de Chaillot par le rideau-baldaquin rouge. Nous osons faire remarquer la similitude du principe de base de ces deux décors, parce que d’abord, bâtir un petit théâtre sur la scène est, à l’époque de l’entre-deux-guerres, une idée extravagante
737
; qu’ensuite, dans les deux cas, ni Corneille ni Giraudoux n’ordonne
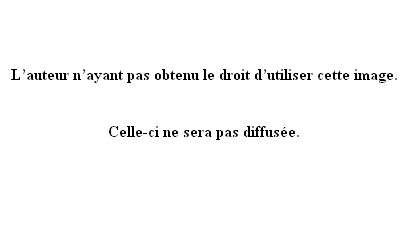
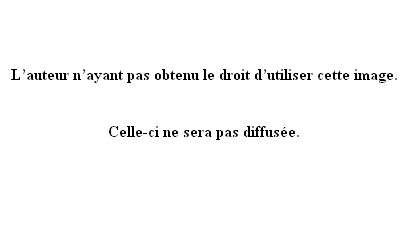
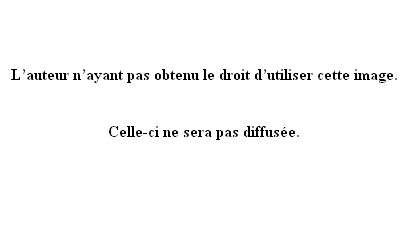
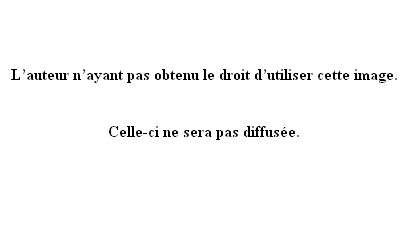
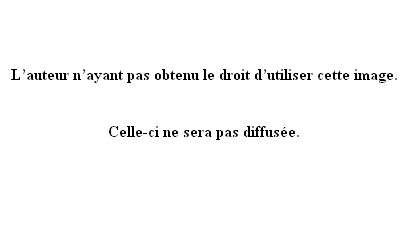
d’appliquer ce principe pour créer le décor ; et qu’enfin, le rouge est la couleur qui rappelle le plus la salle du théâtre. Dans beaucoup de théâtres à l’italienne, le rideau est rouge depuis le XIXe siècle et les sièges sont habillées de velours rouge dont le reflet ensanglante la salle.
Il faut souligner également que Bérard ajoute souvent l’image de la protagoniste devant la façade du café et le baldaquin au sous-sol quand il dessine des maquettes du décor. Quelquefois elle est avec d’autres folles.Cela semble expliquer que le décorateur pense que les folles font partie du décor 738 . Entre l’étrangeté des personnages et de la protagoniste et la singularité du décor, Bérard voit un rapprochement esthétique. Au moment où Aurélie s’allonge dans son lit à baldaquin pour faire la sieste, c’est-à-dire qu’au moment où deux métaphores du théâtre, l’une est la Folle, l’autre est le lit couvert du baldaquin rouge, se combinent, l’action bascule dans l’irréalité : c’est juste après cette scène que les « méchants » s’évaporent et que les « bons » ressuscitent. Ces derniers se prétendent ainsi :
‘Leur [=un cortège d’hommes aimables, souriants] chef : Merci, Comtesse. En contrepartie de vos envois souterrains, enfin l’on nous libère. Nous sommes ceux qui ont sauvé des races d’animaux. Voici Jean Cornell, qui a sauvé le castor. Voici le baron Blérancourt, qui a sauvé le braque Saint-Germain. Voici Bernardin Cevenot qui a tenté de sauver le dronte, cette oie de la Réunion. C’était l’oiseau le plus bête du monde. Mais c’était un oiseau. Il n’en reste plus que cet oeuf trouvé là-bas dans un marais de naphte. Ce soir nous le ferons couver. Merci, et venez tous. Nous allons dire son vrai nom au sloughi de la duchesse.’ ‘Un autre groupe sort du souterrain, aussi courtois, aussi souriant.Leur chef : Merci, comtesse, pour cette relève à laquelle nous avions bien droit. Nous sommes tous ceux qui ont sauvé ou créé une plante. C’était un contresens de nous laisser sous terre. D’autant que les plus petits végétaux possèdent les plus grosses racines et que nous y vivions dans la confusion. Voici Monsieur Pasteur, celui du houblon. Voici Monsieur de Jussieu, celui du cèdre. Il nous mène arracher la gousse d’ail qu’un criminel vient de piquer dans le cèdre du quai de Tokio. 739 ’
Dans les deux cas, Giraudoux s’attache à ce que les détails de prédilection se distinguent aussi nettement que dans ses premiers récits romanesques : ces deux chefs des « hommes aimables » insistent sur les petits détails de leurs mérites tombés dans l’oubli. Les noms propres énumérés par eux, comme Marthe Besson-Herlin le dit dans la notice de la Pléiade, sont « inventés ou liés à des souvenirs personnels de l’auteur » 740 , ce qui rappelle le principe de base de l’esthétique littéraire de Giraudoux : le respect pour les imaginaires qui ne sont pas sous la contrainte de la tyrannie de la réalité extérieure. Ce Monsieur Bernardin Cevenot existe tant que l’on y croit, de la même façon que la petite double de Lucile « tient son serment » 741 tant que Lucile le croit.
Michio Kato comprend l’importance de la scène de résurrection. Ce lecteur passionné du théâtre de Giraudoux et du Nô lit le texte d’Ondine avant de partir à la guerre en 1943, et le texte de La Folle de Chaillot dès qu’il rentre au Japon, sain et sauf. En 1948, informé de la création de la pièce à Broadway par la lettre d’un ami 742 , il s’irrite du jeu de Martina Hunt, interprète du rôle de la Folle de Chaillot, car celle-ci salue le public après la représentation comme si le personnage était un symbole de la victoire aussi éclatant que la déesse de La Liberté. Il s’irrite aussi du fait que l’on supprime la plupart des lignes de la scène de résurrection :
‘Par exemple, les scènes qui m’ont donné la plus forte impression, celles où Aurélie enterre tous les méchants dans les égouts et ensuite donne libre cours à ses imaginations illusoires, sont raccourcies et simplifiées de manière très pragmatique et très américaine à tel point qu’elles sont interprétées comme un pure délire d’aliénée. L’apparition de ceux qui ont consacré leurs vies à protéger les animaux et les végétaux et succombé inconnus n’a pas lieu ; les illusions ne sont que des symptômes d’une maladie mentale. Seulement quelques murmures fragmentés résonnent dans la salle comme s’ils n’étaient qu’une hallucination auditive. Je suis sûr que Jean Giraudoux voulait faire apparaître, à travers cette apparente illusion de la Folle, la présence de la foule anonyme qui aurait dû être récompensée pour ses mérites de son vivant, dans le but de se désoler et de réprouver l’injustice de ce bas monde... Les Américains, hélas, ne comprennent jamais cela. 743 ’La fonction que remplit le rêve de la Folle, métaphore du théâtre, est très proche de celle que l’écriture romanesque remplit depuis des années 1920 dans l’univers littéraire de Giraudoux : mémoriser le monde, ne pas le laisser oublier, le graver dans l’écriture. Nous avons certes bien vu que dans Électre et dans Ondine par exemple, Giraudoux réussit à faire ressortir des détails insignifiants et inaperçus cachés derrière l’Histoire officielle et que de cette manière son théâtre se distingue d’une simple composition dramatique traditionnelle dans laquelle est respectée l’unité d’intrigue mais nous offre au contraire une pièce considérablement romanisée. Toutefois le caractère polyphonique inhérent à l’écriture de cet auteur n’y est transposé que partiellement. D’une part, dans les premiers récits romanesques de Giraudoux comme Provinciales, Suzanne et le Pacifique, Siegfried et le Limousin, Bella ou bien quelques récits sur la guerre, la description des petites existences est renvoyée à la réalité qui entoure le lecteur, car la toile de fond de ces récits relève, à quelques exceptions près, de l’actualité contemporaine ou de la réalité personnelle de l’auteur. Il n’y a pas autant de fragments de réel dans la fiction mythique que dans le récit qui reflète la réalité extérieure. D’autre part, ni dans Électre ni dans Ondine, il n’y a de regard qui puisse encadrer l’univers fictif tout entier. La conscience rêveuse d’Aurélie a pour effet d’englober non seulement les apparitions de la fin de la pièce mais aussi toutes les petites figures qui apparaissent dans la pièce par le moyen de ce regard virtuel.
Michel Foucault fait observer que « la folie est apparue [...] comme une prodigieuse réserve de sens ». Nous nous rendons compte maintenant de l’étonnante similarité entre la folie comme « réserve » chez Foucault et l’écriture comme mémoire du monde chez Giraudoux :
‘Encore faut-il entendre comme il convient ce mot de « réserve » : beaucoup plus que d’une provision, il s’agit d’une figure qui retient et suspend le sens, aménage un vide où n’est proposée que la possibilité encore inaccomplie que tel sens vienne s’y loger, ou tel autre, ou encore un troisième, et cela à l’infini peut-têre. La folie ouvre une réserve lacunaire qui désigne et fait voir ce creux où langue et parole s’impliquent, se forment l’une à partir de l’autre et ne disent rien d’autre que leur rapport encore muet. Depuis Freud, la folie occidentale est devenue un non-langage, parce qu’elle est devenue un langage double (langue qui n’existe que dans cette parole, parole qui ne dit que sa langue) -, c’est-à-dire une matrice du langage qui, au sens strict, ne dit rien. Pli du parlé qui est une absence d’oeuvre.Il faudra bien un jour rendre cette justice à Freud qu’il n’a pas fait parler une folie qui, depuis des siècles, était précisément un langage (langage exclu, inanité bavarde, parole courante indéfiniment hors du silence réfléchi de la raison); il en a au contraire tari le Logos déraisonnable ; il l’a desséché ; il en a fait remonter les mots jusqu’à leur source – jusqu’à cette région blanche de l’auto-implication où rien n’est dit. 744 ’
De même que l’écriture de Giraudoux est l’assemblage d’innombrables murmures inconnus, équivoques, et digressifs, la folie est « langage exclu, inanité bavarde, parole courant indéfiniment hors du silence réfléchi de la raison ». Il faudrait ajouter que l’auteur d’Histoire de la folie à l’âge classique évoque l’affinité du rêve avec la folie ailleurs dans ce livre : « C’est dans l’espace de la pure vision que la folie déploie ses pouvoirs. Fantasmes et menaces, pures apparences du rêve et destin secret du monde – la folie détient là une force primitive de révélation : révélation que l’onirisme est réel [...] » 745 .
C’est en appelant à sa propre écriture que Giraudoux met en scène la folie. Et la folie qui se joint au rêve se présente comme métaphore du théâtre. Si bien que La Folle de Chaillot peut se lire comme la convergence de deux écritures : romanesque et théâtrale.