V. Les modalités de l’altérité
‘ « L’Autre est ce que nous savons de lui,et non pas ce qu’il est, ou prétend être » 2332 . ’
On sait à présent qui sont les Autres. On a vu quels sont les individus qui introduisent le trouble dans des catégories considérées comme allant de soi et désormais mises en question, ce qui pose problème. Il faut maintenant en venir aux modalités mêmes de l’élaboration d’un discours à leur sujet. L’énonciation d’un discours scientifique sur l’Autre suppose le déploiement d’outils et de concepts spécifiques. Comment dit-on l’Autre en cette fin de XIXe siècle ?
C’est la perspective objectivante d’une biologie positiviste qui sous-tend largement ce discours. Pour l’élaborer, les scientifiques de la seconde moitié du XIXe siècle se dotent en effet d’un ensemble de moyens, de notions et d’outils appartenant à la biologie. Il s’agit de dire quelle est la nature de l’Autre, et cette discipline est bien armée à cette fin. L’anthropologie étant, d’abord et avant tout, « une observation anatomique du corps humain », si l’on s’en tient à la définition qu’en donne au XVIIIe siècle la Grande Encyclopédie, élaborer une anthropologie c’est, dans un premier temps, rédiger un traité sur l’animal humain considéré dans tous ses aspects physiques en recourant à l’anatomie, la physiologie, la génétique2333, lesquelles permettent de dresser un portrait de l’Homme moyen, du représentant standard de l’espèce humaine, en quelque point du globe que l’on se trouve. Mais ce discours sur l’Autre n’est pas à strictement parler un discours biologique : on ne s’en tient en effet pas à des considérations organiques, même si les « stigmates anatomiques ont […] le mérite d’être accessibles à la mesure et au contrôle, [écartant] par leur stabilité, leur objectivité et leur permanence, les controverses qui résultent de l’appréciation de caractères variables et susceptibles d’interprétations différences [et restant par conséquent] les éléments les moins discutables, ceux qui servent de bases aux classifications »2334. C’est un discours anthropologique qui se constitue alors. Et le vocabulaire d’alors fait ici problème : en effet, le terme « anthropologie » a un sens général très vague, mais il ne saurait être considéré comme synonyme de « biologie ». Littéralement, il s’agit de « la science de l’Homme », celle qui « s’occupe de l’homme dans son entier, sans qualificatif qui en restreigne l’étendue : de l’homme physique comme de l’homme moral, de la brute comme de l’être intelligent, de l’homme dans l’état de nature comme dans l’état social, du groupe total comme de ses groupes secondaires et de leurs fractions constituantes »2335. On voit bien ici qu’un discours biologique ne saurait parvenir à un tel objectif. Une appréhension anthropologique de l’Autre relève de bien d’autres problématiques, elle requiert bien d’autres outils. Alors, « au temps actuel, à la suite des débats et des tentatives en sens divers […], au lendemain de la révolution pacifique opérée par Boucher de Perthes et Darwin, quel est le sens qu’a pris définitivement le mot anthropologie ? »2336. Il convient de préciser la définition qu’on en a initialement donné, sous peine de voir l’anthropologie recouvrir l’intégralité du domaine des sciences humaines et d’ignorer le renouvellement dont la discipline fait l’objet dans la seconde moitié du XIXe siècle. Pour Paul Topinard, qui se réclame d’Armand de Quatrefages, « le représentant officiel de l’anthropologie française »2337, l’anthropologie relève de l’histoire : le terme « signifie histoire des hommes comme mammologie veut dire histoire des mammifères, comme entomologie veut dire histoire des insectes : rigoureusement il doit être pris dans le même sens »2338. Alexandre Lacassagne en donne une définition qui adopte la même perspective :
‘« C’est l’étude de l’évolution de l’humanité, d’après l’examen des faits biologiques ou sociaux, qui ont successivement agi en modifiant et en perfectionnant le système nerveux de l’homme. Ce n’est pas l’homme isolé qui nous préoccupe, c’est surtout le genre humain »2339. ’Cette définition souligne l’autre dimension que prétend alors prendre l’anthropologie, s’affranchissant de la biologie tout en en conservant les acquis et les outils. En France, la discipline trouve véritablement ses assises institutionnelles dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans un contexte général marqué par la diffusion des théories évolutionnistes. Pour Claude Blanckært, parmi les facteurs explicatifs de l’émergence de la discipline à l’époque, il faut principalement retenir le succès de l’hypothèse transformiste de Charles Darwin, auquel s’ajoutent les voyages d’exploration et la masse documentaire sur des populations exotiques longtemps mal connues qu’ils permettent de réunir, ainsi que la découverte de l’antiquité géologique de l’Homme. L’évolutionnisme, qui « représent[e] une alternative globale, une vision du monde »2340, joue incontestablement un rôle majeur dans la construction de l’édifice anthropologique, qui s’en trouve durablement affecté. Les propos tenus par Alexandre Lacassagne le confirment résolument. Ce qui intéresse l’anthropologie :
‘« C’est [la] lente et progressive évolution [de l’homme], c’est le développement de l’esprit humain, ses étapes successives, son progrès continu »2341.’Voilà qui n’est guère favorable à une conception unitaire du genre humain, car accepter la possibilité de son évolution, c’est considérer que l’Homme n’est unique ni dans le temps, ni dans l’espace. L’« invention » de la préhistoire en France, que Nathalie Richard date précisément de 1859 et de la reconnaissance des travaux de Jacques Boucher de Perthes2342, permet effectivement d’envisager l’évolution morphologique d’un type humain [Fig.41] dans le temps, type qui s’éloigne de plus en plus de celui des singes anthropomorphes, et les découvertes de vestiges artisanaux confirment dans le même temps une évolution culturelle et intellectuelle parallèle, corroborant brillamment l’universalité de la loi du progrès défendue au même moment par les positivistes.
Quant à savoir s’il existe différents types humains contemporains sur le globe, la question ne se pose même pas tant il est vrai qu’au XIXe siècle la notion même de « race » appartient au « savoir partagé » de la société occidentale, un savoir dont l’opérativité est alors très rarement contestée. C’est même une « notion cardinale » de l’époque, pour reprendre une expression de Jean-Pierre Vernant, « tant le pouvoir d’élucidation qu’on lui confère est grand »2343.
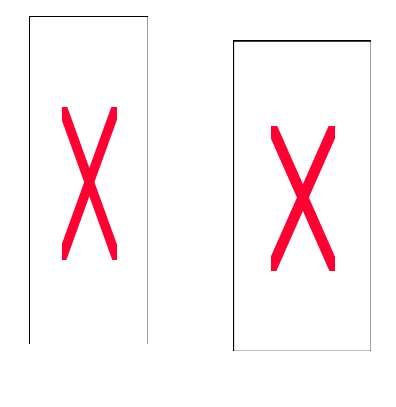
Un changement majeur de paradigme s’opère2344, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, dans l’idée même de « race » – qui se traduit par un passage de la conception monogéniste – postulant l’unité fondamentale du genre humain2345 et convergeant avec la vision chrétienne d’une humanité issue d’un seul homme, à la conception polygéniste, supposant au contraire plusieurs souches originaires de l’homme, d’où la croyance dans une pluralité d’espèces humaines2346. Le docteur Topinard l’affirme :
‘« La période de l’histoire de l’anthropologie que nous venons de traverser était une phase de transition entre la discussion du monogénisme et du polygénisme, qui a pris fin avec le livre de M. de Quatrefages sur l’Unité de l’espèce humaine, le mémoire de Broca sur l’Hybridité, et la renaissance de la doctrine française de Buffon et de Lamarck développée par Darwin et Hœckel »2347.’Entre ces deux moments de l’histoire de la conception de l’origine de l’homme, on constate un accroissement considérable du nombre prétendu de « races humaines », qui témoigne d’une obsession collective, révélant une crise des valeurs universalistes héritées des Lumières, d’autant qu’avec la multiplication des voyages et des explorations, le monde paraît davantage caractérisé par la diversité que par un quelconque principe unificateur. Les « races » constituent un formidable élément de résistance à toute tentative d’uniformisation. Dans un tel contexte, l’anthropologie ne saurait se satisfaire de la recherche d’un « Homme moyen ». Il semble donc bien que l’heure soit aux révolutions épistémologiques :
‘« Le moment [est] venu d’adapter l’anthropologie à ce nouvel état des choses. J’ai surtout pensé que la science de l’homme devait rompre avec certaines croyances, envisager certaines questions autrement, revoir ses méthodes » 2348 , écrit Paul Topinard en 1885. ’Parce qu’elle va de pair avec une acceptation des théories évolutionnistes, l’anthropologie n’est pas la science d’un seul Homme. Le présupposé évolutionniste implique nécessairement d’envisager l’humanité dans sa pluralité. De plus, ce sont tous les hommes que concerne le discours anthropologique, lequel cherche à les appréhender dans tous les aspects de leur existence. À ce titre, l’interdisciplinarité est une condition essentielle au développement de ce discours, non seulement parce que, au XIXe siècle, ce sont des naturalistes qui vont sur le terrain recueillir les informations nécessaires, leur formation polyvalente leur permettant d’embrasser d’un même « encyclopédisme factuel »2349 l’ensemble des rapports entre l’homme et son environnement2350, mais encore parce que l’ambition initiale de cette science nouvelle y prétend. L’interdisciplinarité est donc la règle pour ces observateurs comme pour les théoriciens qui analysent ensuite le matériau par eux réuni : c’est le corps de l’Homme autant que les sociétés au sein desquelles il s’organise qui les intéressent, le premier, comme les secondes, étant marqué du sceau de la pluralité. Regards multiples portés sur une humanité également diverse : l’altérité ne saurait donc que se décliner au pluriel.
Par conséquent, l’anthropologie nouvelle ne peut que procéder d’un esprit tout à fait différent, et pour tout dire antinomique du précédent : considérant moins l’individu que le groupe – groupe humain par rapport aux Primates ou groupes humains entre eux, c’est selon – elle met l’accent sur les caractères différentiels plutôt que sur ce qui est commun, sur ce qui sépare plutôt que sur ce qui unit. En un sens, cette « histoire naturelle du genre humain »2351 peut dès lors se définir comme la « science des variations humaines ». Son but final est de décrire les groupes humains et surtout d’expliquer leurs différences. Ce dernier point découle d’ailleurs de l’évolution de la science anthropologique. Il apparaît, finalement, qu’en cette fin de XIXe siècle, l’altérité est l’objet même du discours anthropologique en cours d’élaboration. Celui-ci reste, pendant longtemps, essentiellement descriptif, se contentant de faire le portrait des diverses populations humaines et de les classer. Pour notre période, la discipline n’est pas encore entrée dans sa phase « compréhensive », laquelle s’est ouverte depuis le milieu du XXe siècle seulement et implique l’analyse des variations observées, dans le but de les interpréter à la lueur des données admises sur l’évolution des êtres vivants. Il n’empêche que les descriptions qu’elle produit le sont en vertu de méthodes rigoureuses, qui sont alors définies, et dont l’analyse est l’objet de ce chapitre. Il s’agit, pour l’essentiel, d’élaborer des « populations » au sens où Michel Foucault emploie ce mot, en recourant à des stratégies de massification et de sérialisation des individus, en privilégiant le groupe face à l’individualité.
‘« La population [est] entendue au sens déjà traditionnel du nombre d’habitants en proportion de la surface habitable, mais au sens également d’un ensemble d’individus ayant entre eux des relations de coexistence et constituant à ce titre une réalité spécifique : la “population” a son taux de croissance ; elle a sa mortalité et sa morbidité ; elle a ses conditions d’existence – qu’il s’agisse des éléments nécessaires pour sa survie ou de ceux qui permettent son développement et son mieux-être. En apparence, il ne s’agit de rien d’autre que de la somme des phénomènes individuels ; et pourtant on y observe des constantes et des variables qui sont propres à la population »2352.’C’est donc une entité à part entière, qui doit présenter un certain nombre de caractéristiques spécifiques observables afin de pouvoir être objectivée. À cette fin, ce sont entre autres ses traits biologiques qui sont considérés comme les éléments pertinents pour la définir et, conséquemment, procéder à sa gestion politique. Fort logiquement les médecins, qui sont sollicités de toutes parts depuis déjà longtemps dans le cadre des politiques hygiénistes, établies en France au seuil de la période révolutionnaire, s’impliquent aussi activement dans cette démarche nouvelle. Comme il leur est demandé de prendre part à l’élaboration d’une « médecine politique » qui « est à la santé publique ce que l’économie politique est à la prospérité publique […] les deux [étant] d’ailleurs liées »2353, ils se font économistes, démographes, philosophes… et désormais anthropologues. L’élaboration de cette nouvelle démarche est le produit de la rencontre d’un désir de contrôle, émanant des pouvoirs en place, d’une part, et d’une préoccupation scientifique incarnée essentiellement par Auguste Comte. Ce dernier appelle de ses vœux une révolution scientifique. On sait l’opinion mitigée qu’il a des médecins, simples techniciens, quasi-vétérinaires même parfois à ses yeux. Mais on sait aussi qu’il entend fonder une science nouvelle, la sociologie, dans le cadre de laquelle la médecine prend une toute autre importance. Considérant la société comme un vaste organisme, auquel on peut donc appliquer les métaphores des âges de la vie (le passage de l’enfance à l’adolescence puis à la maturité) ou des comparaisons pathologiques (crises de croissance et maladies diverses scandent les exposés d’histoire sociale et politique), les positivistes se sentent investis d’une mission médicale envers le collectif. Les médecins peuvent donc devenir des membres du sacerdoce social et participer au soin de la société. Mieux, ils le doivent. En tant que professionnels du déchiffrement des corps, les médecins s’associent légitimement à la constitution de ces « populations » qui sont le produit de la pensée anthropologique du temps. Pour Auguste Comte, la médecine doit même être élevée au rang de « véritable anthropologie »2354. Nul doute qu’Alexandre Lacassagne adhère à cette idée. N’est-il pas l’initiateur2355 de l’anthropologie criminelle en France ? Or, avec l’avènement de la période contemporaine, la médecine qui produisait traditionnellement un discours sur la maladie, prend désormais également en charge la santé, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes :
‘« La médecine ne doit plus seulement être le corpus des techniques de la guérison et du savoir qu’elles requièrent ; elle envelopp[e] aussi une connaissance de l’homme en santé, c’est-à-dire à la fois une expérience de l’homme non malade et une définition de l’homme modèle. Dans la gestion de l’existence humaine, elle prend une posture normative, qui ne l’autorise pas simplement à distribuer des conseils de vie sage, mais la fonde à régenter les rapports physiques et moraux de l’individu et de la société où il vit »2356.’La posture du médecin est donc essentiellement normative. Quand le regard médical se porte sur l’Autre, et il y est alors expressément invité, il en fait un malade puisque, dans sa logique, « fonctionnement alternatif » signifie « dysfonctionnement » et « différence » « anormalité ». Il implique donc nécessairement la prise de mesures thérapeutiques pour « réduire » l’altérité, au sens où l’on réduirait une fracture : au minimum, il prononce des préconisations, à moins qu’il n’impose quelque intervention « orthopédique » plus radicale visant à la normalisation de l’Autre, autant dire à son anéantissement. Quels sont alors les processus à l’œuvre dans la construction de l’objet anthropologique ? C’est ce que nous verrons d’abord, avant de souligner les particularités de l’anthropologie élaborée par Lacassagne et l’École dite « du milieu social » et de tenter d’en réévaluer l’originalité par rapport à l’École italienne conduite par Cesare Lombroso.