10.3.1 Organisations non gouvernementales et internationales
La représentation de la situation par la chaîne permet de légitimer une forme nouvelle d’action d'ordre politique incarnée par les humanitaires. Ces acteurs ont pour objectif de venir en aide aux sinistrés à la fois matériellement et psychologiquement, pendant la phase courte d'urgence et la phase plus longue de reconstruction. Leur capacité à juguler la crise et à gérer les fonds sans qu'ils ne soient détournés est primordiale518. Ces organisations, en voyant leur action mise en lumière, contribuent inévitablement à l'instauration d'une image des pays aidés qui ne seraient pas complètement capables de se gérer seuls. Rappelons cette approche de Patrick Charaudeau : « Le discours d’héroïsation consiste à mettre en scène une figure de héros, réparateur d’un désordre social ou du mal qui affecte ces victimes[...] On voit de nouveau à l’œuvre cette stratégie discursive dans laquelle l’énonciateur tout en s’effaçant donne en pâture au public des figures de héros, l’assignant à s’y projeter et/ou à s’identifier à elles de manière aveuglante, ayant pour effet de suspendre tout esprit critique»519. Les ONG participent aux initiatives d’aide en faveur d’un développement qui prenne en compte la dimension écologique.
Les membres d'associations, d'ONG, les bénévoles sont omniprésents et filmés dans une multitude d'activités. La caméra les suit à la trace, les filme en gros plan. Ils sont dans l'urgence et cela se voit. Cette image (figure 99), diffusée le 9 janvier 2005 permet de voir un membre de l'organisme Médecins Sans Frontières en action. Comme il est filmé de dos, en plan rapproché, on ne distingue pas le visage du bénévole. Un détail attire le regard pourtant : c'est le logo de l'ONG, que l'on remarque immédiatement. L'identité du bénévole tient dans cet indice. Son mouvement se déplace le long d'une file de réfugiés dont les regards convergent et se portent vers l'élément que leur donne le bénévole. Ces autochtones tendent le bras en direction du bénévole. D'une part, on ne voit pas le visage du bénévole et d'autre part, on ne sait pas ce qu'il fournit aux sinistrés. Il s'agit donc de mettre en scène l’ONG dans l’environnement tsunami plus que de s’attarder sur les détails de l’opération. Ce mouvement est intéressant : le bénévole avance dans un sens alors que les réfugiés vont en sens inverse. Cette image traduit le clivage entre les pays du Sud « demandeurs » et les pays du Nord « salvateurs ».

20:16:28:65
Par extension, les images de lieux qui expriment la solidarité et l’entraide sont également omniprésents à l'écran. Images d'hôpitaux, d'ambulances, d'écoles et de lieux de culte se succèdent sans discontinuer et deviennent même familières au spectateur. Derniers refuges des victimes et des survivants, ils sont, au même titre que les paysages détruits, les lieux (de vie et de mort) du tsunami. La mise en scène passe aussi par la représentation des individus mobilisés à distance, le plus souvent en France. De nombreux objets deviennent alors des symboles de l'action collective et de cette volonté d'établir des ponts de communication entre les pays touchés et la France. Téléphones, ordinateurs et télévision ponctuent les sujets de notre corpus. Les personnes sont au téléphone ou attendent des nouvelles près de celui-ci. Les ordinateurs sont utilisés pour passer des messages, retrouver des gens, faire des dons. Les télévisions permettent de rester à l'affût des moindres informations ou de passer des messages. La solidarité des Français qui se mobilisent est également mise en scène. Nous retrouvons des images de chèques ou de tas de vêtements, qui permettent de faire contrepoids aux images de mort. À travers le mouvement de solidarité, les spectateurs se donnent la possibilité d'une action qui vient diminuer le sentiment d'impuissance provoqué par les images du désastre.
Plusieurs organisations françaises sont mises en avant ou s’y mettent elles-mêmes : la Croix-Rouge, le Secours Catholique, le Secours Populaire, la Fondation de France, Action Contre la Faim, Médecins Sans Frontières, Pompiers Sans Frontières, Télécoms Sans Frontières, Médecins du Monde ou encore Handicap International. Chacune a une ou des fonction(s) précise(s) concernant la santé ou la reconstruction. Le 11 janvier 2005, un reportage présente en infographie la répartition sur place de sept de ces organismes :

20:06:43:44
Les points rouges indiquent les lieux ou sont situées les ONG françaises dans la zone. Elles se répartissent en grande majorité dans les quatre pays les plus touchés : l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et le Sri Lanka. Sur le côté droit de cette infographie sont présentés les logos de ces organismes. On ne sait donc pas exactement à quel organisme correspondent chaque point rouge : ce qui est souligné ici c'est la présence de nombreuses ONG, toutes issues des pays du Nord.
Le lendemain, 12 janvier, c'est cette solidarité qui est mise en scène dans un reportage dont l'action a lieu à Chantilly, en France. La journaliste Mathilde Pasinetti présente une société qui s’occupe des dons envoyés aux ONG. La caméra filme d'abord une multitude de chèques posés sur une table pour mieux signifier leur afflux massif :

20:20:14:06
Trois femmes travaillent autour d'une grande table (elles sont réparties autour de cette table) dont le dessus est littéralement recouvert d'enveloppes et de chèques. L'une des femmes est de dos, les autres de profil : elles sont filmées en plein travail.
Alors que l'une des employées explique le procédé, « je vérifie le chèque, qu'il y ait bien la date du mois de janvier, la signature et après je les place directement par montant. Les gens donnent, la plupart, 50€. Mais on a des gens généreux des fois qui vont jusqu'à 15 000 20000 …euh…», la caméra opère un zoom sur les chiffres inscrits (figures 104 et 105). D’une certaine manière, ce plan est aussi une façon de légitimer le travail des banques.
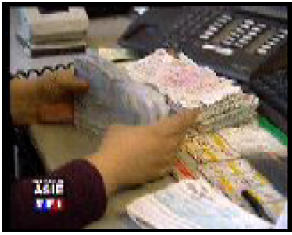
20:40:36:51
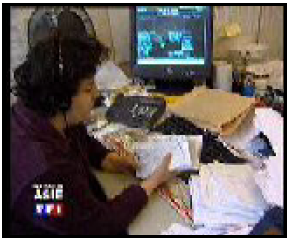
20:40:38:81
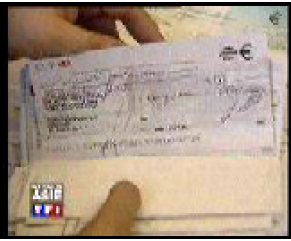
20:40:50:28
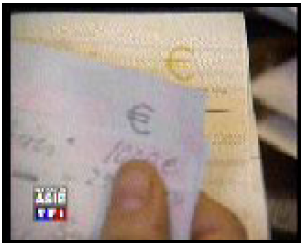
20:40:53:72
Cette médiatisation n'est pas sans conséquences puisque nombre d'entre elles reçoivent trop de dons par rapport à leurs besoins : « Des sommes qui dépassent largement les besoins sur place en Asie, l'UNICEF et MSF, ont cessé leur collecte »520. Bien que la solidarité financière dont ont fait preuve les particuliers ait largement contribué à faciliter la lourde tâche des ONG («La Croix-Rouge, sections France et internationale, a reçu, en un mois 910 millions d'€, c'est à dire la moitié des sommes récoltées en 86 ans, au niveau mondial […] Un raz de marée de dons, jamais égalé. L'UNICEF a reçu 300millions d'€, MSF 90millions, Action contre la Faim, 7 millions, Médecins du Monde, 5millions »)521, ce surplus d'argent pose des questions :
- Comment l'argent est-il utilisé ? TF1 apporte une réponse le 24 mai 2005, cinq mois après la catastrophe : «Au total, 360 millions d'€. La Croix-Rouge a reçu 105 millions d'€ et dépensé 75 millions d'€. Action contre la Faim a perçu 12 millions d'€ et engagé 3 millions. Médecins sans Frontières a dépensé a collecté 9,2 millions d'€ et dépensé 2 millions»522.
- Le surplus d'argent est-il redirigé avec le consentement des donateurs ? « Nous n'avons pas besoin de dons supplémentaires concernant l'Asie. Aujourd'hui on a besoin de l'élan de générosité du public, pour d'autres crises, pour d'autres actions qui se poursuivent aujourd’hui au Darfour, en République Démocratique du Congo…euh…ou en faveur des malades du SIDA »523.
- N'y a t-il pas risque de détournement ? L'intervention du premier Président de la Cour des Comptes, Philippe Séguin, sur le plateau de TF1, le 3 janvier 2005, est censée rassurer les Français sur ce point. Une forte attention est accordée par TF1 au sérieux des associations humanitaires et à la confiance que peuvent leur porter les donateurs. Les journalistes expliquent, par exemple, la manière dont cet argent est traité puis utilisé.
- Quel est le rôle des ONG sur place ? Dans un premier temps, « L'urgence, ce sont d'abord les soins et les médicaments […] Autre préoccupation, la situation alimentaire […] Enfin, pour acheminer efficacement tous ces moyens, il va falloir rétablir les voies de communications, routes et téléphones»524. Dans une seconde phase, «après le secours aux populations, les associations, aujourd'hui, réhabilitent, construisent routes, puis hôpitaux, maisons»525.
- Dans de telles conditions, les associations peuvent-elles être efficaces et aider tout le monde ? Plusieurs variables sont à prendre en considération : «Les associations travaillent avec les populations, en tenant compte, des modes de vie, des pouvoirs en place, du manque d'artisans, un contexte qui ralentit l'aide, mais en assure l'efficacité»526. Pour autant, prennent-elles en considération le travail des ONG locales, ou d'ONG plus petites ? Face à la machine humanitaire occidentale il apparaît que «sur place, c'est la surenchère entre ONG, qui se battent pour remporter les marchés»527. En effet, «Les organisations humanitaires sont très nombreuses sur le terrain, au risque parfois d'ailleurs, de rencontrer quelques difficultés pour coordonner leurs actions, d'autant que les associations islamistes elles aussi, sont présentes, et attendent de jouer un rôle auprès des ONG occidentales et notamment américaines»528.
- Cette aide sera t-elle durable ? C'est en tout cas la question que se pose un journaliste plusieurs mois après le drame : «installées pour 3 ou 10 ans, les associations optent pour une aide humanitaire, durable»529. Dans la phase d'urgence, elles vont mettre en place des refuges improvisés, notamment dans les églises, les écoles et les universités, parce que la plupart des victimes n'a plus de logement, ou pour éviter la menace d'un nouveau tsunami ou simplement pour avoir un lieu d’accueil transitoire. Le discours de la chaîne sous-entend que la catastrophe, qui s’est produite au lendemain de Noël, permet de soulever une chaîne de solidarité « sans précédent », quasiment dépeinte comme le recours ultime «Les avions des ONG sont le dernier espoir d'une population aujourd'hui entièrement démunie»530. C'est un discours qui fait écho à celui des personnes interviewées ou dont les propos sont rapportés. Ces refuges sont par ailleurs peu abordés dans les premiers temps suivant la catastrophe. Aucun adjectif ne vient les qualifier pour exprimer le caractère durable ou provisoire de cette situation de précarité. Il y a peu d'informations sur l'organisation de ces refuges, les conditions sanitaires ou les moyens mis à disposition. Seuls quelques chiffres nous sont donnés quant aux nombre de sans abris ou de « déplacés ». Nous apprenons ainsi par exemple qu'en Indonésie, «il y aurait un million de sans abris»531, à la date du 27 décembre 2004 «250 000 sans abris»532 au Sri Lanka le même jour. Quelques jours plus tard, ce chiffre passe à «un million de sans abris pour...euh...l'ensemble du Sri Lanka»533. Mais ces camps de réfugiés s'improvisent souvent également dehors, à l'aide de simples tentes, comme en témoigne l'exemple du camp crée à Jantho, en Indonésie. Présenté dans un reportage, le 3 janvier 2005, il apparaît comme un lieu d'espoir malgré les conditions précaires : « 6000 personnes vivent ainsi dispersées, autour de Jantho, à une heure de route, des côtes dévastées. Ils se sont retrouvés dans l'exode, et ont reformé leur quartier, leur village, dans des campements, comme celui-ci […] Aucun d'entre eux, n'envisage de revenir en bas dans la plaine». Mais, dans les mois qui suivent la catastrophe, TF1 parle toujours des camps : «Ces camps, temporaires, risquent bien d'être habités, durant plusieurs années »534.
Dans ce flot d'aide humanitaire, la place des ONG locales doit être définie. L'exemple du Secours Islamique est abordé le 15 janvier 2005. Son représentant, se montre discret quant aux éventuelles luttes politiques sous-jacentes : «Le responsable de l'équipe sur place, se défend de toute lutte d'influence avec l'aide humanitaire occidentale »535. À ses côtés, le Front des combattants pour l'islam est présenté comme plus radical : «Avant la catastrophe, ils n'étaient pas présents à Banda Aceh. Aujourd'hui, ils sont 500 fraîchement débarqués de la capitale, Djakarta, pour protéger la population, des mauvaises influences ». L'opposition entre deux temporalités dans le propos du journaliste « avant-après » traduit le changement d’attitude de la part du Front et sa volonté de contrôler les actions des ONG internationales dont l’influence est jugée « mauvaise » en vertu de la « loi islamique, la charia ». Cet exemple montre un déplacement, un développement du conflit Nord-Sud avec, d’un côté, les ONG occidentales et, de l’autre, un islamisme radical qui entend lutter contre ces premières et contre le modèle occidental en général.